No Society
La fin de la classe moyenne occidentale.
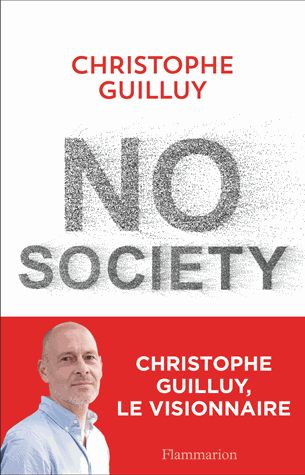
Depuis la publication en 2014 de son ouvrage La France périphérique, le géographe Christophe Guilluy a très bien compris et anticipé ce que nous avons nous-mêmes, reprenant l’analyse de Rosa Luxemburg, appelé le « ferment de grève de masse » qui se manifeste aujourd’hui à travers le mouvement des Gilets jaunes.
Pourtant, les médias lui donnent très peu la parole.
Autant de raisons pour nous de vous offrir ici une revue de son dernier livre :
No society – La fin de la classe moyenne occidentale,
Christophe Guilluy,
octobre 2018, Flammarion.
Par Bruno Abrial, militant S&P.
Le mouvement des Gilets jaunes, par une manifestation soudaine dont seul notre pays semble détenir le secret, a brusquement mis en lumière le contraste criant entre l’univers froid et techno de la mondialisation financière, dominé par la fausseté et l’arrogance, et un élan retrouvé de fraternité, de solidarité et de dignité parmi les humiliés, les offensés et les exploités.
Jamais, des deux côtés de l’Atlantique, la destruction du lien entre le monde d’en haut et le monde d’en bas n’aura été aussi flagrante ; jamais le mépris de classe n’aura été aussi ouvertement exhibé, depuis les « déplorables » d’Hillary Clinton jusqu’à « ceux qui ne sont rien » d’Emmanuel Macron, en passant par les « sans-dents » de François Hollande.
En quatre décennies, en se livrant corps et âme à l’idéologie néolibérale, ces « élites » ont engendré un véritable monstre, celui d’une mondialisation fonctionnant à rebours du bon développement intégré et harmonieux de la société, et qui, tel un parasite pompant le sang de son hôte jusqu’à l’hypertrophie, a progressivement détruit le socle des classes moyennes issues des Trente glorieuses. Ce faisant, elles ont donné corps à l’idée développée dans les années 1980 par Margaret Thatcher, selon laquelle « There Is No Society » (il n’y a pas de société), mais seulement une somme d’individus projetés dans la jungle des marchés et sa loi du plus fort.
Ainsi, après les ouvriers, les employés et les agriculteurs, ce sont désormais les retraités et les professions intermédiaires – artisans, indépendants et commerçants – qui mordent la poussière. Le problème pour les partisans de la mondialisation, c’est qu’une société périphérique, réunissant tous les perdants de la mondialisation, relégués hors des métropoles, est aujourd’hui devenue majoritaire.
Et, partout, cette « nouvelle classe populaire », comme la qualifie Christophe Guilluy, rejette le modèle établi et s’organise pour en créer un nouveau.
De la France aux États-Unis, de la Grande-Bretagne à l’Italie, de l’Allemagne à la Scandinavie, la dynamique populiste relève de la même géographie, les périphéries urbaines et rurales, de la même sociologie, les catégories modestes qui constituaient hier la majorité de la classe moyenne, écrit-il dans No Society. Ce puissant mouvement culturel révèle aussi le grand secret de la mondialisation : la disparition de la classe moyenne occidentale.
La « France périphérique »
Au cours des quarante dernières années, tandis qu’elles livraient l’économie à la loi des marchés financiers, les classes dominantes se sont appuyées sur un système de représentation statistique qui leur a permis de maintenir le mythe de l’ascenseur social et d’une classe moyenne intégrée ; c’est ainsi que le modèle des métropoles a été vendu comme le parangon de la « mondialisation heureuse ».
En effet, les cartes officielles de l’Insee – utilisées par l’ensemble de la classe politique – donnent une perception essentiellement urbaine et économique des territoires ; d’après celles-ci, 83 % des Français vivraient dans les 241 agglomérations comptant plus de 10.000 emplois, ce qui validerait l’idée que la grande majorité de la population est « urbaine » et donc intégrée. Les lieux d’exclusion se cantonneraient alors aux banlieues et à certaines zones rurales.
Selon Christophe Guilluy, cette représentation a créé un « angle mort » des classes populaires. La vraie fracture oppose non pas le monde urbain au monde rural, ou les centres-villes aux banlieues, mais les territoires les plus dynamiques, c’est-à-dire les 25 aires urbaines de plus de 370.000 habitants, à la « France périphérique », c’est-à-dire les territoires urbains, périurbains et ruraux se situant hors de ces métropoles. Aujourd’hui, cette société périphérique comprend 60 % de la population française (et 90 % des communes) et elle présente des taux de fragilités sociales – chômage, travail précaire, petites retraites, etc – largement supérieurs à ceux des métropoles.
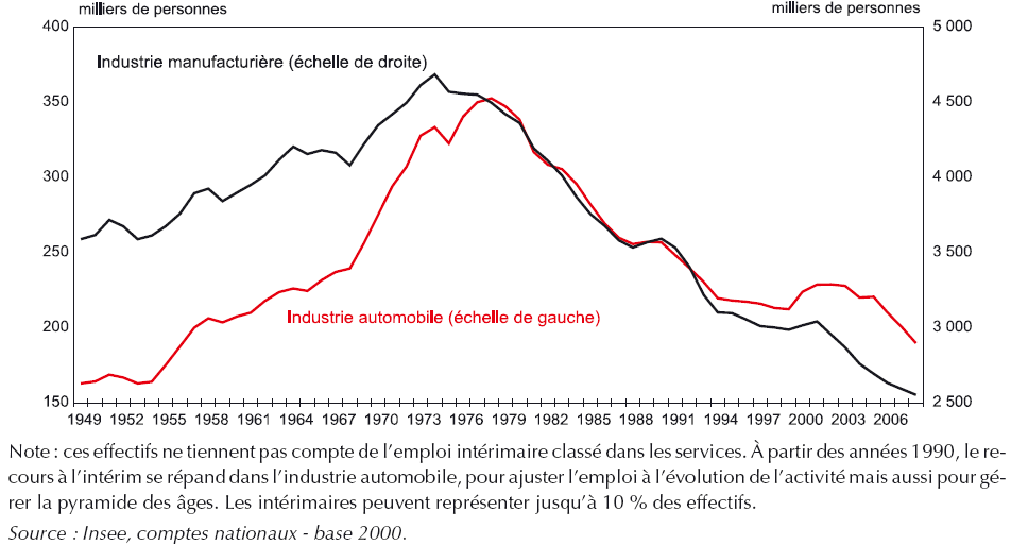
Ces territoires sont littéralement sortis du radar, tandis que les métropoles ont tout attiré à elles, dans une logique de concentration sans précédent. Entre 2006 et 2013, une douzaine de métropoles ont compté près de 46 % des créations d’emplois, dont 22 % pour la seule aire urbaine de Paris, pendant que les villes de moins de 100.000 habitants, ainsi que les petites et moyennes villes, ont toutes un solde négatif de création d’emplois.
Entre 2009 et 2014, 60 des 98 départements (soit 51 % de la population) ont perdu des emplois. Tous les secteurs sont touchés : industrie, services, commerces et même les banques (12 % des agences bancaires devraient fermer d’ici 2020). Il s’agit d’un mouvement inédit : en 1999, la croissance de l’emploi bénéficiait encore à l’ensemble des territoires.
Le même phénomène s’est développé parallèlement dans la plupart des pays occidentaux, au fur et à mesure de la désindustrialisation et de la dérégulation financière, créant les conditions du futur rejet, qui a commencé à se manifester clairement en 2016, à travers le vote Brexit, l’élection de Donald Trump, la vague populiste européenne, et aujourd’hui les Gilets jaunes.
La sécession des élites
En mai 2017, lors de l’élection d’Emmanuel Macron, les classes dirigeantes ont poussé un « ouf » de soulagement. Le Brexit et Trump n’étaient que des accidents, tout allait désormais pouvoir rentrer dans l’ordre. Bien entendu, cela n’était vrai qu’en apparence.
En réalité, cette élection a révélé le fossé béant séparant le monde d’en haut et le monde périphérique. Christophe Guilluy souligne d’ailleurs l’ironie de voir cette bourgeoisie réactionnaire ne pas hésiter à abandonner ses postures identitaires ou culturelles habituelles pour voter pour Macron :
Les partisans de la Manif pour tous ont choisi le candidat du libéralisme culturel quand les contempteurs de la finance internationale apportent massivement leur suffrages à un banquier d’affaires !
L’identité de droite ou de gauche n’est plus qu’un vernis ; l’opposition entre la gauche et la droite des quarante dernières années apparaît pour ce qu’elle est depuis longtemps : un jeu entre gens d’un même milieu, celui des winners et des protégés de la mondialisation qui ont fait le choix conscient de la rupture avec le monde d’en bas. Car, derrière la caution morale de la « société ouverte », le processus de métropolisation correspond bien à une sécession des élites d’avec le peuple.
En effet, d’abord par l’augmentation des prix immobiliers, puis par l’évitement résidentiel (on ne vit pas dans les mêmes immeubles) et scolaire (on scolarise sa progéniture dans les écoles comprenant le moins d’enfants d’immigrés possible), c’est une véritable logique de citadellisation qui s’est mise en marche.
L’arnaque de la société ou de la ville ouverte offre au monde d’en haut une supériorité morale qui lui permet de dissimuler la réalité de son repli géographique et culturel. L’Open Society est certainement la plus grande fake news de ces dernières décennies.
Désigné persona non grata, le peuple a été mis à distance afin de permettre aux classes dominantes de jouir des bienfaits de la mondialisation sans entraves, qu’elles soit nationales, sociales, fiscales ou culturelles. Une partie d’entre elles fantasme même à l’idée de se libérer des contraintes biologiques, grâce à la révolution de l’intelligence artificielle et du transhumanisme. Une sorte de fuite de Varennes, dans le sens moderne du terme...
« Ayant abandonné l’idée de faire société, écrit Guilluy, les classes supérieures cherchent logiquement à s’extraire du cadre national en rêvant à la création de cité-États », comme Athènes ou Carthage dans l’Antiquité, ou Florence ou Venise à la Renaissance. Si cette sécession géographique doit aboutir complètement, cela prendra la forme d’une prétendue résistance contre le populisme/fascisme, au nom du Bien et de l’ouverture. Cette logique est tout à fait compatible avec les mouvements indépendantistes, lesquels masquent souvent « un processus de sécession sociale et culturelle qui vise en réalité à démanteler les solidarités nationales et à valider le modèle territorial inégalitaire de la mondialisation, celui de la métropolisation ».
Le phénomène de sécession des élites, qui avait été identifié par Christopher Lasch dans les années 1990, a en réalité commencé il y a plusieurs décennies, à l’époque où l’on a de nouveau laissé le renard financier entrer dans le poulailler...
Abandon du bien commun
À partir des années 1970, la classe dirigeante a organisé elle-même sa propre impuissance politique, en abandonnant notre souveraineté monétaire et en nous rendant de plus en plus dépendants du système bancaire et des normes supranationales du modèle mondialisé. Si Christophe Guilluy se trompe à propos de la « loi Pompidou-Giscard » de 1973, pensant à tort qu’elle a forcé l’État à s’endetter auprès des banques privées en interdisant la Banque de France de faire des avances au Trésor, il n’en a pas moins raison sur le principe.
Comme nous l’avons montré nous-mêmes, c’est en réalité la loi de 1993, établie suite au traité de Maastricht, qui a interdit cette disposition ; mais, au cours des vingt années précédentes, les gouvernements successifs avaient déjà sciemment fait le choix de ne plus se servir de cet instrument du « crédit productif public » – qui fut pourtant essentiel pour les Trente Glorieuses – et de se soumettre au diktat des marchés (voir la vidéo #3 La Bulle et la Dette [Acte 2] Faut vraiment que vous compreniez).
La mise en œuvre des critères de Maastricht, de l’euro et de la Banque centrale européenne, a soumis les États membres à un véritable carcan monétaire et budgétaire réduisant à l’extrême les marges de manœuvre ; la politique d’austérité qui en a découlé, amplifiée à chaque crise financière, a créé les conditions des tensions identitaires, des processus de partition territoriale et de la montée du « populisme » ; autant d’effets que les élites déplorent aujourd’hui mais dont elles continuent de chérir les causes.
Cette intégration européenne radicale a consacré le démantèlement de l’État-providence, et l’abandon du triptyque commune-département-nation, établi en France depuis la Révolution, auquel a été substitué un nouveau paradigme de grandes intercommunalités rigides, de grandes régions souvent artificielles et d’une UE bureaucratique dominée par des milliers de lobbies.
Pour compenser l’effondrement de l’économie réelle et de la création d’emplois, et maintenir à flot la bulle financière, ce système se shoote à la dette (225 % du PIB mondial en 2018) et à la planche à billets, reportant de cette manière le poids sur les peuples et les générations futures. C’est ainsi que s’est mise en place une redoutable machine de précarisation des classes moyennes, et d’appauvrissement systématique des États, au travers d’un transfert du patrimoine public vers la sphère privée.
Relégation culturelle des catégories populaires
Pendant les Trente Glorieuses, la plupart des couches sociales de la société, de l’ouvrier au cadre supérieur, avaient le sentiment d’être intégrées ; les catégories populaires et ouvrières étaient alors au centre de l’attention politique. Au cours des quarante dernières années, elles ont progressivement perdu ce statut de référent culturel et, de passeur de l’American ou de l’European way of life qu’elles étaient, elles sont devenues l’incarnation des loosers de la mondialisation.
« Exclues du modèle économique, ces catégories allaient peu à peu devenir celles auxquelles il ne fallait plus ressembler. La figure du déplorable était née », écrit Guilluy.
Une ostracisation culturelle s’est mise en place à partir des années 1970, relayée par le monde du cinéma, de la télévision, de la presse et des universités, et façonnant une image répulsive de catégories populaires présentées comme inadaptées à la « dénationalisation tranquille », et comme une masse de racistes et de fascistes en puissance, souvent proches de la débilité – ce sont les Rednecks dégénérés (cf film Délivrance de John Boorman, 1972), les beaufs racistes de Dupont Lajoie, les Deschiens de Canal plus, etc.
En adoptant ainsi la posture moralement supérieure d’un monde d’en haut bienveillant et éclairé défendant les minorités face à un monde d’en bas belliqueux et ignorant, les classes dominantes ont réussi à évacuer la « question sociale ».
Mais cette posture a fait long feu. Les leçons de morale des milliardaires de la Silicon Valley et des bobos londoniens ne passent plus. Avec les commentaires et les petites phrases de Macron, aussi grotesques que caricaturaux, elle apparaît désormais dans toute sa fausseté et son caractère infantile. « De la chute de l’empire Weinstein à celui du ’gauchisme culturel’ français, l’imposture morale de la bourgeoisie est désormais visible », écrit Guilluy. L’ « antifascisme d’opérette » et les « c’est plus compliqué que ça » révèlent de plus en plus l’appauvrissement intellectuel du monde d’en haut, et la technique d’ostracisation des classes populaires se retourne contre ceux qui l’ont élaborée.
Les élites se retrouvent ainsi piégées dans le système d’omerta qu’elles ont elles-mêmes contribué à créer, où toute personne tendant la main aux classes populaires est immédiatement estampillé de « populiste », de « proto-fasciste », ou encore de « rouge-brun ». « Entre trouille et suffisance, entre condescendance et mépris de classe, l’enfermement du monde d’en haut, son panurgisme, son grégarisme, son extrémisme conduisent à une forme d’assèchement de la pensée et annoncent la fin de son hégémonie culturelle ».
Le soft power des classes populaires
Partout en Occident, le rêve des élites d’un monde hors-sol, peuplé d’individus sans territoire, sans histoire et sans culture se brise contre la réalité. « On peut imaginer le meilleur des mondes hors-sol, fantasmer l’homme nouveau, mais à la fin, il faut bien qu’un ouvrier construise les routes, qu’une institutrice fasse école ou qu’un paysan cultive », écrit Guilluy.
Au lieu d’évacuer la question sociale et la notion de lutte des classes, le massacre de l’ancienne classe moyenne a fait émerger une nouvelle classe populaire qui, de plus en plus consciente d’elle-même, du fait qu’elle a été sortie de l’histoire et que la démocratie s’exerce sans elle, ressent le besoin de monter de nouveau sur la scène, afin de regagner ses droits et sa dignité.
À rebours de la logique de démantèlement de l’État providence, de privatisation et de libéralisation, les classes populaires font réémerger la nécessité de préserver le bien commun et les services publics. Elles exercent une pression politique croissante, qui déconstruit progressivement les dogmes, les croyances et idéologies de la mondialisation, et impose ses propres thèmes :
À celle de déréguler, de dénationaliser, elles opposent un cadre national qui conditionne la défense du bien commun, face au mythe de l’hyper-mobilité, elles révèlent la réalité d’un monde populaire sédentaire beaucoup plus durable ; enfin, à la construction d’un monde de l’indistinction culturelle, elles opposent la préservation d’un capital culturel protecteur.
Par exemple, l’argumentaire faisant du protectionnisme un repli sur soi, et donc une forme de fascisme conduisant à la guerre, s’effondre comme un sophisme de pacotille, remplacé par l’idée que le protectionnisme n’est pas une idéologie mais une politique de protection commerciale.
De même, la posture morale hypocrite des classes dirigeantes libérales, consistant à circonscrire le problème migratoire à une question humanitaire plutôt que politique, économique et sociale, résiste de moins en moins à la demande de régulation des flux. Christophe Guilluy rappelle que, étant donné la forte pression démographique en de nombreux points sur la planète, partout les peuples réagissent de la même façon, demandant protection et régulation :
Cette demande n’est pas seulement celle des classes populaires européennes ou américaines, des petits blancs, mais concerne l’ensemble des classes populaires dans le monde.
La question de la régulation des flux migratoires n’a pas toujours été taboue en France. Christophe Guilluy rappelle qu’au début des années 1990, Georges Marchais, qui dirigeait alors le Parti communiste français, n’hésitait pas à demander l’arrêt de l’immigration.
Ajoutons qu’à l’époque, il y avait dans le monde ouvrier une telle solidarité, couplée à un certain niveau de culture – il n’était pas rare de voir un travailleur composer un poème sur un bout de papier en rentrant de la mine ou de l’usine, ou d’entendre un immigré italien réciter par cœur la Divine comédie de Dante – que le problème ne se posait pas dans les termes sulfureux et chargés de bienséance culpabilisante comme aujourd’hui. Ce n’est qu’ensuite, principalement avec la trahison de la gauche caviar, qui a troqué la défense des classes populaires et ouvrières contre une prétendue défense des minorités, que le débat a été hystérisé autour de la question du racisme.
Aujourd’hui, les Trump, Le Pen, Mélenchon, Salvini, Zemmour et autres Bannon n’influencent en rien l’opinion populaire ; ils ne font que s’en nourrir. « La théorie de la trumpisation ou de la lepénisation des esprits faibles ne dit absolument rien d’une mécanique de fond beaucoup plus puissante portée par le soft power des nouvelles classes populaires ».
L’exemple de Matteo Salvini, passé d’ultralibéral en économie à défenseur du protectionnisme, en est emblématique.
Le monde d’en haut, confronté à l’implosion des vieux partis, à l’effondrement du clivage traditionnel gauche-droite, et à cette pression croissante du monde d’en bas, se voit forcé d’envisager la seule alternative possible : protéger ou disparaître. « Soit il réintègre la communauté nationale en prenant en compte les aspirations du peuple, soit il disparaît », écrit Guilluy.
Conclusion
Nous avons aujourd’hui toutes les raisons d’être remplis d’espoir. Le système ultralibéral est en faillite. Sa vitrine, le modèle des métropoles, se trouve lui-même dans l’impasse. En effet, le chômage, la saturation des transports et de l’espace, la pollution, les tensions identitaires, etc, en font de plus en plus un repoussoir. Un sondage d’avril 2018 révélait que sept habitants sur dix souhaitaient quitter la région-métropole parisienne !
Le soulèvement populaire actuel en France représente un véritable salut pour la France et pour le monde. Comme le dit Marcel Gauchet, « c’est l’aspiration d’une collectivité intégrée dans une société qui ne l’est plus ».
Un rééquilibrage est en cours dans les rapports de puissance et de pouvoir entre les territoires, dans lequel les élus de terrain, et bien sûr des citoyens s’impliquant de nouveau en politique – comme le font actuellement les Gilets jaunes –, devront jouer un rôle fondamental pour rétablir le lien perdu entre le monde d’en haut et le monde d’en bas afin, comme le dit Christophe Guilluy avec une certaine ironie, de réintégrer les classes supérieures dans la communauté nationale et dans l’histoire.

