
Nicolas Sarkozy vient de sceller une nouvelle « Entente cordiale » avec l’Angleterre, alors même que le krach financier commence à frapper et que la City de Londres dévoie l’Europe pour qu’elle serve ses desseins de chaos.
Ceux qui connaissent l’histoire savent qu’hélas, l’« Entente cordiale » de 1904 créa les conditions d’un embrasement mondial. Hier, comme aujourd’hui, la France, dirigée par des hommes sans vision, se fit une fausse idée de sa propre grandeur, posa les jalons de sa destruction et contribua à ouvrir une ère de guerres et d’horreurs sans précédent.
C’est parce que le XXIe siècle doit être celui de la paix et du développement pour tous que nous avons décidé de rendre disponible un texte de Jacques Cheminade de 1991, « Fachoda, quand les nuées portent l’orage ». Nous sommes convaincus que cette leçon d’histoire vous donnera la ténacité si nécessaire à votre combat d’aujourd’hui.
Fachoda, quand les nuées portent l’orage
Par Jacques Cheminade
« Je n’ai jamais désespéré de la France » Léon Gambetta
Le 10 juillet 1898, le capitaine Marchand atteint le Nil à Fachoda ; le 20 septembre, après avoir vaincu les « derviches » soudaniens, Kitchener lui fait face. Ils demeurent ainsi plusieurs semaines, l’arme au pied, jusqu’à ce que le gouvernement français cède et que, le 4 novembre 1898, la mission Marchand évacue Fachoda.
Cet affrontement de deux détachements coloniaux français et britannique, autour d’une forteresse délabrée, au cœur d’un continent alors à demi exploré, paraît très loin dans le temps, plus près du rivagedes Syrtes, d’un roman de Conrad ou du désert des Tartares que des tragiques soubresauts de notre propre fin de siècle.
Pourtant, c’est autour de cet événement apparemment dérisoire que s’est noué le sort de l’Europe et du monde au XXème siècle, car il a été le marqueur d’une transformation, progressive mais déterminante, de la politique extérieure française, et donc du jeu des grandes puissances en Europe.
Après Fachoda, ces « fantômes de la nuit » dont parlait Jaurès se mettent à hanter l’Europe. Après Fachoda, Delcassé remplace Hanotaux au ministère des Affaires étrangères, pendant près de sept ans, avec pour seule obsession ce qu’il confiait dès le 29 décembre 1898 à Maurice Paléologue : « Ah, mon cher, si la Russie, l’Angleterre et la France pouvaient s’allier contre l’Allemagne ! »
Après Fachoda, la chance d’une alliance continentale européenne, fondée sur cet « édit de Nantes entre travail et industrie » que recherchait Hanotaux, autour de grands projets développant et désenclavant le continent, la faible chance s’évanouit. La politique échappe aux dirigeants, qui alors comme aujourd’hui manquent totalement de vision, et passe aux intérêts financiers qui, par le jeu des emprunts et des remboursements, se rendent maîtres des Assemblées, des Administrations et des peuples. L’idéologie dominante, unanimement acceptée, devient celle du modèle britannique : l’on joue l’un contre l’autre, l’on divise pour régner, l’on se partage l’Asie et l’Afrique, l’on n’est plus guidé que par une volonté de puissance et de possession sans dessein, le droit absolu de faire valoir sa rente, menant tout droit à la guerre. La France, en tant que République, tout comme les Etats-Unis qui entrent alors eux aussi dans le jeu, sous la présidence de Theodore Roosevelt, faillit plus que les autres en se laissant entraîner par la logique des empires, des monarchies et des oligarchies - une « logique de guerre » qui passera dans le siècle par les tranchées du Chemin des Dames, les charniers de Verdun, l’humiliation de mai 1940, l’imbécillité sanglante de nos guerres coloniales jusqu’à la soumission atlantiste d’aujourd’hui.
Après Fachoda, c’est comme une fatalité qui s’abat sur les peuples d’Europe paralysés, comme un engrenage mis en marche que rien ne peut plus arrêter, le gonflement inéluctable de ces nuées qui portent leurs nuages de fer et de feu vers le siècle à venir.
Cette machine infernale qui se met à enflammer le monde, entendons encore Jaurès en démonter le mécanisme le 25 juin 1914 au soir, à Lyon Vaise : « Si l’Autriche envahit le territoire slave, si les Germains, si la race germanique d’Autriche fait violence à ces Serbes qui sont une partie du monde slave, il y a à craindre et à prévoir que la Russie entrera dans le conflit.

|
« Et si la Russie intervient pour défendre la Serbie contre l’Autriche, l’Autriche invoquera le traité d’alliance qui l’unit à l’Allemagne, et l’Allemagne fait savoir par ses ambassadeurs auprès de toutes les puissances qu’elle se solidariserait avec l’Autriche. Si le conflit ne restait pas entre l’Autriche et la Serbie, si la Russie s’en mêlait, l’Autriche verra l’Allemagne prendre place sur les champs de bataille à ses côtés.
« Mais alors, ce n’est plus seulement le traité d’alliance entre l’Autriche et l’Allemagne qui entre en jeu, c’est le traité secret, dont on connaît les clauses essentielles, qui lie la Russie à la France, et la Russie dira à la France : « J’ai contre moi deux adversaires, l’Allemagne et l’Autriche, j’ai le droit d’invoquer le traité qui nous lie, il faut que la France vienne prendre place à mes côtés. C’est l’Europe en feu, c’est le monde en feu.
« Les responsabilités... Si vous voulez bien songer que c’est la question de la Bosnie-Herzégovine qui est l’occasion de la lutte entre l’Autriche et la Serbie, et que nous, Français, quand l’Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n’avions pas le droit de leur opposer la moindre remontrance, parce que nous étions engagés au Maroc et que nous avions besoin de nous faire pardonner notre propre péché en pardonnant les péchés des autres...
« Alors notre ministre des Affaires étrangères disait à l’Autriche : « Nous vous passons la Bosnie-Herzégovine, à condition que vous nous passiez le Maroc », et nous promenions nos offres de pénitence de puissance à puissance, de nation à nation, et nous disions à l’Italie : « Tu peux aller en Tripolitaine puisque je suis au Maroc, tu peux voler à l’autre bout de la rue, puisque moi j’ai volé à l’extrémité ». Chaque peuple paraît à travers les rues avec sa petite torche à la main et maintenant voilà l’incendie. »
Il ne manque qu’une chose au discours de Jaurès, c’est de définir le rôle de l’Angleterre, que Gabriel Hanotaux lui-même ne comprenait pas beaucoup mieux. L’élément fondamental de la situation mondiale, englobant tous les autres, est que l’oligarchie britannique ne percevait son intérêt que dans une éternelle division de l’Europe, afin que les rênes du pouvoir ne puissent jamais lui échapper. Ayant fait de Londres le centre du pouvoir financier, commercial et maritime du monde, elle espérait conserver sa mainmise par la domination des assurances, de la mer et des colonies. Cette domination était incompatible avec un développement de l’Europe, avec la continuation de l’essor industriel en France, en Allemagne et dans certaines régions de la Russie, et encore davantage avec un accord entre les nations continentales en vue d’un projet de croissance mutuelle. Aussi, l’Angleterre, le système anglais, était par sa nature même le souffle qui poussait les nuages de la guerre au-dessus des nations européennes.
Celles-ci commirent la terrible erreur, au lieu de s’allier comme le voulaient chacun à leur manière un Hanotaux ou un Jaurès, de tenter de jouer au plus fin et au plus fort sur le terrain même défini par l’Angleterre. Willy, Nicky, Poincaré et Delcassé, agent principal de cette erreur fondamentale, voulurent faire mieux qu’Edouard VII ou que Chamberlain dans un jeu dont ils n’avaient, eux, pas défini les règles. Le résultat fut que leurs nations, leurs peuples et leurs régimes furent tous ensembles perdants, et que le monde n’est pas encore aujourd’hui sorti, malgré deux guerres mondiales, de cette logique de feu et de sang.
| 1904 : La France tombe dans le piège anglais |
Ecrire sur cette époque n’a donc de sens que si c’est pour dénouer les fils qui ont alors été noués autour de nous et qui aujourd’hui encore nous paralysent. L’effondrement, dans notre siècle, des monstruosités fasciste et communiste nous ramène à Fachoda. C’est en effet là que s’est tissée la trame sanglante que nous devons reprendre de fond en comble. Si, en effet, les monstres ont pu naître et perpétrer leurs crimes, ce fut après la plus terrible des guerres qui les engendra, et dont l’on ne peut donc les accuser d’être responsables.
Ce que nous devons montrer ici, c’est la responsabilité absolue du libéralisme financier, suivant le système britannique, dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et le rôle que joua la République française faute d’avoir fait son métier de République, c’est-à-dire de l’avoir combattu. Parallèlement, dans le contexte axiomatique défini par ce système dominant, à partir des manières de voir et de juger qu’il inculque, nous devons comprendre comment ont pu se trouver progressivement perverties l’idée de nation, la conviction républicaine et jusqu’aux doctrines religieuses, transformées en facteurs d’exclusion et de division alors qu’elles étaient toutes, à des degrés divers, initialement porteuses de valeurs universelles.
Car la « machine à exclure » est aussi « machine à pervertir », à dégrader, à vider les mots de tout sens actif. Elle ne cherche pas tant à communiquer un ou des jugements précis sur les êtres ou sur les choses, mais elle crée un environnement mental qui porte à juger l’ensemble des choses d’un même point de vue, celui de la rente financière, définissant un monde d’avoir et non d’être, malthusien, en contraction, considérant le faible, le pauvre ou même l’autre comme un fardeau - « le lourd fardeau de l’ homme blanc » - et non comme une chance d’avenir, une occasion d’éveil.
Ne voyons-nous pas aujourd’hui revenir ce « vieux » monde ? Le système anglo-américain d’aujourd’hui est-il si différent du modèle britannique « d’avant 14 » ? Même machine à exclure, mêmes niveaux de taux d’intérêt favorables à la rente « perpétuelle » et défavorables à l’entreprise industrielle et agricole, même perversion générale des valeurs. Même malthusianisme triomphant partout, même conviction que l’on se trouverait mieux d’être moins pour partager le gâteau existant, au lieu de réaliser que l’humanité n’existe, n’a existé et n’existera que par sa capacité de créer des ressources et de s’accroître.
Communisme et fascisme disparus, l’histoire s’est mise à bégayer, jusqu’à répéter les mêmes noms et les mêmes mots dans les Balkans, porteurs de violences semblables. Déjà, dans les enclaves serbes de Croatie, des rues ont été rebaptisées Gavillo Principe, l’auteur de l’attentat de Sarajevo. « La petite torche à la main » parcourt à nouveau l’Europe.
Seule, cette fois encore, une grande politique européenne, franco-allemande, serait la chance d’une reprise de l’économie continentale et du monde. La différence avec l’Europe « d’avant 14 » ou « d’après 45 », c’est que l’économie américaine, cette fois trop détruite dans ses forces vives, c’est-à-dire dans son équipement de base, est devenue incapable d’être le moteur qu’elle a pu devenir deux fois dans le siècle. La responsabilité de l’Europe est donc aujourd’hui bien plus grande qu’elle ne l’a jamais été entre 1900 et 1980. L’Europe n’est plus ni une région du monde ni un rassemblement d’intérêts, mais l’humanité elle-même.
Sera-t-elle à la hauteur de sa tâche ? Est-elle capable d’assurer la survie du monde ? A voir ses dirigeants, l’on serait tenté de répondre « non ». Ils sont eux-mêmes, autant que leurs peuples, plongés corps et âmes dans le système de penser et de voir « britannique{} », loin, très loin des horizons de la simple survie mutuelle. La Guerre du Golfe a été un terrible exemple de cet aveuglement et de cette médiocrité. François Mitterrand s’est dès le départ soumis à une « logique de guerre », comme si elle était inéluctable, comme si le système anglo-américain était un puits magique dont on ne pourrait jamais sortir. La télévision a asséné son bourrage de crâne mieux que toutes les presses écrites d’hier.
Quant aux pays de l’Est, nos frères européens eux-mêmes, nous ne sommes capables de leur proposer, pour prix de leur liberté, que la fermeture de leurs usines et la baisse de leur niveau de vie. Les économistes néolibéraux y sévissent, transmettant le pouvoir à une nomenklatura « communiste » reconvertie dans des spéculations bien pires que celles des années dix ou trente.
N’ayant rien appris, semble-t-il, ni rien compris, nos dirigeants ont repris leur course à l’abîme, comme après Fachoda.
Si ce que vous allez lire maintenant vous paraît comme un mauvais rêve qui se répète, vous aurez raison. Je transcris celui d’hier en espérant que, lecteurs mesurant la ressemblance, vous ferez quelque chose pour que celui d’aujourd’hui soit interrompu avant son dénouement fatal. Car la mémoire de ces grands événements du passé, et la conscience des efforts qui ont été faits depuis pour effacer toute vérité de leurs traces, constituent des facteurs déterminants, peut-être les facteurs les plus déterminants, permettant de maîtriser l’histoire d’aujourd’hui.

Gabriel Hanotaux.
|
| Gabriel Hanotaux |
Gabriel Hanotaux fut ministre des Affaires étrangères de la France dans les cabinets Charles Dupuy et Ribot (22 mai 1894 - 1er novembre 1895) et, après l’intermède du ministère Bourgeois, dans le ministère Jules Méline (29 avril 1896 - 15 juin 1898). Ainsi, pendant 42 mois, il s’efforça de réunir les conditions de la paix en Europe. Le seul ministre dont la longévité au quai d’Orsay dépassera la sienne fut son successeur, Théophile Delcassé (28 juin 1898 - 6 juin 1905), qui pratiqua une politique opposée et marqua de façon indélébile l’orientation de la France. Ne le vit-on pas, le 30 juin 1914, se féliciter de « sa » guerre, tout comme le provocateur russe Isvolski : « La victoire est certaine ! On m’a tout montré quand j’étais en Russie. J’ai étudié tous les chemins de fer stratégiques : la concentration sera très rapide, et dans un mois ou six semaines, les Russes seront à Berlin ! »
Ainsi, ce que nous devons ici tenter de mesurer, ce sont les efforts de Gabriel Hanotaux et les raisons de son échec.
Lorsqu’il arriva au pouvoir en 1894, Hanotaux trouve la France dans une situation particulièrement difficile. Afin de détourner le pays d’un affrontement continental direct avec l’Allemagne, Jules Ferry et le « parti colonial », animé par le député d’Oran Eugène Etienne, un ancien collaborateur de Léon Gambetta, ont réorienté la politique nationale vers l’outre-mer. Ainsi, le protectorat sur la Tunisie sera proclamé le 12 mai 1881.
Cependant, sur le continent, les gouvernements allemands ne facilitent pas l’apaisement, en mesurant mal la blessure qu’a causé en France la perte de l’Alsace et du Nord de la Lorraine, et l’obligation de payer des indemnités de guerre élevées - 5 millions de franc-or - alors que l’économie nationale était exsangue et Paris endeuillé par la semaine sanglante de la Commune (21-28 mai 1871). L’opinion française se rappelait que les armées allemandes n’avaient libéré son territoire que le 16 septembre 1873, plus de trois ans après la chute de Sedan. Ces blessures dans la mémoire collective allaient, plus tard, jouer un rôle fondamental dans la dérive du nationalisme français.
Outre-mer, la France se heurte à l’Angleterre. Or, celle-ci vient de passer une série d’accords de partage colonial avec l’Allemagne. L’Angleterre, inquiète de ce réveil des questions extra-européennes qui depuis le XVIIIème siècle semblaient réglées à son profit, tente d’abord de jouer Berlin contre Paris - et trouve à Berlin des oreilles complaisantes. Un arrangement anglo-allemand est convenu dès le 1er juillet 1890, et c’est un traité en bonne et due forme qui est signé en août 1893. Par ce traité, il est convenu que « l’influence allemande ne combattra pas l’influence anglaise à l’ouest du bassin du Chaki, et que les pays du Darfour, du Kordofan et du Bahr el-Ghazal seront exclus de la sphère d’intérêts de l’Allemagne ». Ces clauses ne pouvaient avoir pour objet que de viser une puissance tierce, la France, afin de l’évincer du Haut-Oubangui et l’écarter pour toujours de la région du Nil.
Neuf mois plus tard, le 12 mai 1894, c’est avec l’Etat du Congo (sous la tutelle du Roi des Belges) que l’Angleterre signe un accord de délimitation d’influences, sans même songer à prévenir le cabinet de Paris. Cet accord attribue à l’Etat indépendant du Congo la partie du bassin du Congo située au Nord du quatrième parallèle et reconnue à la France par les Traités de Berlin. En contrepartie, l’Etat « indépendant » cède à bail à l’Angleterre une bande de terre entre le lac Tongongka et le lac Albert-Edouard, c’est-à-dire le passage pour le chemin de fer impérial anglais du Cap au Caire. Le traité contient une clause explicite par laquelle l’Etat du Congo reconnaît « la sphère d’influence britannique telle qu’elle est délimitée dans l’arrangement anglo-allemand du 1er juillet 1890 ».
L’Angleterre s’assure donc, en mai 1894, la possession théorique de tout le bassin du Nil, avec l’appui de l’Allemagne, de la couronne belge et de l’Italie.
L’Egypte, disputée depuis le début du siècle entre la France et l’Angleterre, reviendrait ainsi définitivement à Londres, qui établirait sa loi sur toute l’Afrique de l’Est et du Centre.
La France ne pourrait plus jamais accéder au bassin du Nil par chemin de fer ou par canal, et les liaisons interafricaines Ouest-Est seraient rendues impossibles.
La France, selon Hanotaux, est « mise sur des charbons ardents sur tous les plans à la fois ». La stratégie du ministre sera de tenter d’éteindre tous les feux en même temps.
Sur le continent européen, le 10 juin 1895, il déclare formellement à la Chambre - la rendant ainsi publique - l’Alliance franco-russe, signée dès le 18 août 1892 par le général de Boisdeffre avec le chef de l’état-major russe, sous forme d’une convention tenue secrète, et adoptée définitivement par le Tsar le 27 décembre 1893.
Suivant cet accord, les deux pays conviennent de procéder à une « mobilisation simultanée et automatique » sans « concert préalable » s’ils se trouvent l’un ou l’autre menacés par l’une des puissances germaniques.
Il s’agit d’une réponse au renouvellement de la « Triple Alliance » entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, en mai 1891, et à l’annonce par le gouvernement italien de l’existence, depuis 1887, d’un « {}accord méditerranéen » qui associe l’Angleterre, l’Italie et l’Autriche-Hongrie.
Certes, l’entrée en guerre simultanée de la France et de la Russie n’est formellement prévue qu’en cas d’attaque venant de l’Allemagne, mais le gouvernement français, pour obtenir la signature de la convention, a pris un grave risque - qui s’avérera fatal en 1914 - de mobilisation générale de l’armée française en cas de simple conflit austro-russe.
C’est pour désamorcer ce risque et apaiser l’Allemagne qu’Hanotaux rend public un accord jusque là tenu secret, et souligne en même temps son caractère « strictement défensif ». Il refuse de donner à la Russie un appui autre que diplomatique dans les questions balkaniques.
En même temps, il tente un rapprochement franco-allemand, qui assurerait la liberté d’action de la France outre-mer face à la Grande-Bretagne. Reconnaissant, selon l’historien P.Renouvin, la « nécessité d’une collaboration avec l’Allemagne », il fait envoyer par le gouvernement français, en juin 1895, des navires de guerre pour assister à l’inauguration du canal de Kiel. Ce geste d’apaisement suscite une violente réaction des nationalistes français et des radicaux, qui dénoncent « la violation du droit international lors de l’annexion de l’Alsace-Lorraine ». En Allemagne, l’on continue en même temps à faire preuve d’absence de sensibilité vis-à-vis d’un problème que l’on juge réglé par les armes, et l’on n’aide pas Hanotaux et ses amis car on veut là aussi, realpolitik oblige, garder plusieurs fers au feu.
Ainsi, un « parti colonial » français qui aurait pu être à l’origine facteur de paix, deviendra de plus en plus anti allemand, d’anti anglais qu’il était à l’origine, au fur et à mesure que la « question du Maroc » empoisonnera les rapports entre Paris et Berlin. Le Bulletin du Comité de l’Afrique française écrivait ainsi en 1898 : « Les Anglais... sont les vrais bénéficiaires de la situation créée par la question de l’Alsace... (il faut) chercher sur ce continent la sécurité ou même des appuis afin d’éviter de dangereuses aventures en Asie et en Afrique ». L’occasion ayant alors été perdue, c’est le même groupe qui, suivant avant tout ses intérêts financiers, soutiendra la politique anti allemande définie par Delcassé au Maroc, et suivie par ses successeurs entre 1905 et 1911.
Vis-à-vis de l’Angleterre, en même temps, Hanotaux tente aussi l’apaisement. Il entame une négociation d’ensemble avec le plénipotentiaire anglais à Paris, Phipps, et aboutit, à l’automne 1894, à un « aménagement général » reconnaissant à la France un débouché sur le bassin du Nil, à Khartoum. Mais le gouvernement français rejette l’accord, et le cabinet de Londres désavoue son plénipotentiaire : Londres hésite entre « s’accommoder avec la France, et transiger au sujet de l’Afrique du Nord, ou s’accommoder avec l’Allemagne, et transiger au sujet de l’Afrique du Sud. »
Début 1896, alors qu’Hanotaux n’est plus ministre - il ne l’est plus entre le 1er novembre 1895 et le 29 avril 1896 - l’Angleterre et l’Allemagne signent un nouvel accord, qui laisse à Londres les mains libres en Afrique du Sud et sur le Nil. L’Angleterre lance dès lors une expédition vers Dongola, et l’impérialisme anglais - avec le soutien implicite et explicite de l’Allemagne et de la Triple Alliance - s’élance vers le Soudan, afin d’écraser la rébellion du Mahdi et de s’assurer ainsi la mainmise sur l’Egypte et tout le bassin du Nil.
Le gouvernement français - ministère Bourgeois - décide alors de riposter en organisant une mission française vers le Haut-Oubangui, ayant pour objectif la forteresse de Fachoda, dans le Bahr el Ghazal. C’est cette mission qui sera confiée au capitaine Marchand, et qui est à vrai dire une patrouille symbolique incapable de faire face aux forces anglaises de Lord Kitchener.
Lorsque Hanotaux revient aux affaires, avec le ministère Méline (29 avril 1896), il décide le 25 juin 1896 de laisser s’embarquer Marchand vers son destin. Il pense pouvoir calmer les ardeurs belliqueuses des uns et des autres avant l’arrivée de Marchand à Fachoda. Effectivement, Hanotaux commence par signer, le 23 juillet 1897, un accord avec Berlin qui met (provisoirement) fin aux contestations franco-allemandes en Afrique. Avec l’Angleterre, malgré les diatribes du parti impérial (La Pall Mall Gazette écrit : « Il faut parler au Quai d’Orsay sur un ton de commandement.{} »), Hanotaux parvient à signer une « convention de délimitation générale », le 14 juin 1898, un jour avant la chute du ministère Méline, qui couvre l’Afrique dans toute sa largeur, du Sénégal au bassin du Nil. Toutes les colonies françaises d’Afrique, dès lors, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Fouta-Djalon, la Côte d’Ivoire, le Soudan français et le Congo « communiquent avec leurs hinterlands respectifs », et le Maroc lui-même se trouve dans l’hinterland de la France.
Une seule question reste à régler : celle du débouché français sur la vallée du Nil, qui a justifié l’organisation de la mission Marchand.
Hanotaux parti, c’est Théophile Delcassé qui le remplace, le 28 juin 1898, aux Affaires étrangères et y sera inamovible pendant près de sept ans - la plus longue durée de vie à son poste de toutes les Républiques françaises ! Avec lui, notre politique étrangère changera du tout au tout : il transforme l’effort d’apaisement européen tenté par Hanotaux en mobilisation anti allemande, infléchissant l’alliance franco-russe contre Berlin et nouant les fils de l’Entente cordiale avec l’Angleterre.
Fachoda sera pour lui l’occasion de cette transformation, depuis longtemps préméditée : il est très lié au roi d’Angleterre, Edouard VII, et très proche des milieux de la presse et de la finance londoniennes.

Théophile Delcassé noua les fils de l’entente cordiale.
|
| Théophile Delcassé noua les fils de l’entente cordiale |
Delcassé est un homme jeune - 46 ans lorsqu’il devient ministre - opportuniste, cynique, pour qui le pouvoir se prend là où il se trouve. Et le pouvoir dépendant de l’argent, il se trouve dans les banques et les sociétés financières de son pays, et au-delà dans les banques et sociétés financières les plus puissantes du monde : celles de la City de Londres. Delcassé est donc d’abord pro-anglais par intérêt ; il l’est en même temps par snobisme. Avec le quarteron de « grands ambassadeurs » qui l’entoure - Camille Barrère (à Rome), Jules (à Madrid) et Paul (à Londres) Cambon, Maurice Paléologue (sous-directeur adjoint des affaires politiques au Quai d’Orsay, avec pour attribution les « affaires réservées ») - il manifeste cette « anglomanie » propre aux parvenus de la République, heureux de se faire coopter par des Lords.
Enfin, sa vision du monde est purement territoriale et géopolitique ; pour lui, contrairement à Hanotaux (outre la prise du butin en Afrique), la réoccupation des « provinces perdues » d’Alsace et de Lorraine définit tout. Il mettra à profit l’incompréhension allemande de l’opinion française pour toujours gonfler cette « cause » jusqu’en 1914 - bien que, dès 1898, sur quinze députés d’Alsace-Lorraine élus au Reichstag, douze disent leur « loyalisme » vis-à-vis de l’empire allemand. Comme Clemenceau, son fatalisme et son pessimisme positiviste sur l’espèce humaine lui donnent une sorte d’énergie froide qui en impose aux politiciens « bongarçonnismes », influençables et vénaux de la IIIème République.
C’est donc avec cette énergie qu’il saisit l’occasion que lui fournit Fachoda pour liquider la politique de Hanotaux et imposer la sienne, c’est-à-dire celle de l’Entente cordiale. Marchand arrive à Fachoda le 10 juillet 1898. Delcassé ne l’a pas arrêté ; cependant, un homme de son intelligence sait d’une part la faiblesse de notre puissance de feu (il s’agissait d’une expédition symbolique, destinée à « marquer le coup ») et d’autre part la puissance bien supérieure des forces anglo-égyptiennes de Kitchener, qui viennent d’écraser le Mahdi. Et ce qui devait arriver arrive : le 20 septembre 1898, Kitchener est face à Marchand avec ses effectifs bien supérieurs. De Courcel, notre ambassadeur à Londres, fait valoir que « la France ne peut admettre que ses provinces de l’intérieur fussent seules exclues d’un débouché du Nil » ; cependant, mobilisé par la presse et le parti impérial, l’opinion anglaise s’enflamme. Chamberlain y parle de guerre, et la panique gagne une France divisée par l’Affaire Dreyfus et la question religieuse. Delcassé fait alors valoir à notre gouvernement l’infériorité de nos forces et la nécessité d’un retrait. Les hommes politiques pusillanimes ne peuvent qu’acquiescer ; « l’affaire est tranchée dans un sens fâcheux » le 12 octobre, et Fachoda évacué sans gloire le 4 novembre.
La France s’est inclinée face à l’Angleterre ; M.de Courcel est remplacé à Londres par un proche de Delcassé, Paul Cambon.
Delcassé obtient son pourboire des autorités britanniques le 21 mars 1899 : une convention annexe à celle du 14 juin 1898 est signée par Londres et Paris, consacrant pour la France la perte de la totalité du bassin du Nil, mais tout en lui reconnaissant « un accès commercial » au fleuve.
Dès lors, l’engrenage de l’Entente cordiale se met en place. Dès février 1898, Delcassé expose à ses collaborateurs qu’il ne doit plus y avoir contradiction entre la politique d’expansion coloniale et une politique continentale dirigée contre l’Allemagne. Pour cela, il faut s’allier - y compris militairement - avec l’Angleterre, renforcer la coordination de l’effort militaire avec la Russie, et dissocier l’Italie de la « Triplice ».
La crise éclatera très vite sur la question du Maroc : en 1898, le parti colonial fait du rattachement de l’Empire chérifien à la France son objectif numéro un, en raison de sa situation géographique, il complète la « masse » continentale française en Afrique - et de ses ressources minières. Cependant, les amis d’Eugène Etienne ne croient pas à la réalisation de leurs desseins sans le soutien allemand, étant donné les intérêts anglais à Gibraltar.
Delcassé, sur ce point essentiel, ne suit pas ses « amis », et réoriente leurs intérêts contre l’Allemagne.
Pour cela, il met à profit les divisions du « parti colonial ». Un violent conflit oppose en effet, en son sein, le capital industriel au capital financier. A partir de 1902, la Compagnie marocaine, création du groupe industriel Schneider, s’oppose à un syndicat bancaire sous la direction de Paribas. Le Quai d’Orsay choisit Paribas, capable de répondre à l’énorme emprunt que le Sultan du Maroc se trouve dans l’obligation de lancer. Lorsque Schneider trouve à son tour l’argent nécessaire en s’entendant avec la Banque de l’Union Parisienne, Delcassé règle très brutalement le conflit en faveur de Paribas. Le 9 mai 1904, il déclare au secrétaire général du Creusot qu’il ne peut tolérer que sa maison « se mette en travers d’une décision d’intérêt national ». Le Sultan signera l’emprunt le 12 juin, ruinant son pays, assurant au consortium bancaire d’énormes bénéfices et à la France une position prééminente au Maroc. L’imposition de « réformes » administratives et politiques au Sultan afin qu’il soit en mesure de rembourser sa dette servira désormais de prétexte à des interventions de plus en plus actives de Paris dans les affaires marocaines. Est-on loin des « ajustements structurels » du FMI et des « réformes » financières imposées aujourd’hui aux pays africains pour qu’ils remboursent ?
Delcassé a donc lié quasi-officiellement le gouvernement français aux intérêts majeurs du capital bancaire. L’Entente cordiale avec l’Angleterre, rendue publique par l’accord diplomatique du 8 avril 1904, consacre cette victoire du capital bancaire : Paribas était en effet la grande banque française la plus liée aux banques anglaises !
La politique coloniale française se trouve ainsi infléchie : l’Entente cordiale est un accord de troc colonial et impérialiste, par lequel la France s’engage à « ne pas entraver l’action de la Grande-Bretagne en Egypte » - c’est la renonciation définitive à ce rêve français - tandis que l’Angleterre reconnaît « qu’il appartient à la France de veiller à la tranquillité du Maroc ». Le concept de « protectorat » français est réservé aux articles secrets...

Après Fachoda : Une « logique de guerre » qui passera notamment par les tranchés de 1914.
|
| Après Fachoda : Une "logique de guerre" qui passera notamment par les tranchés de 1914 |
Ce partage, complété par d’autres clauses du même type, ouvre la voie à des accords diplomatiques donnant à l’Entente cordiale un caractère global.
Ce « succès » encourage Delcassé dans sa décision d’agir promptement au Maroc sans se préoccuper des réactions de l’Allemagne. Il s’agit d’obtenir dans les plus brefs délais la reconnaissance par le Sultan du protectorat français et de « mouiller » le parti colonial dans une alliance anti allemande. Il y faudra huit ans, dont sept après la chute de Delcassé, le 6 juin 1905. Aucun des successeurs de Delcassé n’abandonnera en effet un projet qui va créer progressivement une indélébile animosité franco-allemande.
Jaurès et les socialistes y dénonceront l’une des menaces fondamentales pour la paix. Jaurès écrit, par exemple, en 1908 : « Pénétrer par la force, par les armes au Maroc, c’était ouvrir à l’Europe l’ère des ambitions, des convoitises et des conflits ».
L’Allemagne, dans l’immédiat, tentera surtout de se servir du Maroc comme d’un moyen pour dénouer l’Entente cordiale en constituant une alliance continentale germano-russe à laquelle la France devrait adhérer, en échange de l’acceptation par l’Allemagne de sa liberté d’action au Maroc.
La contre-offensive allemande se manifeste alors par le « discours de Tanger » de Guillaume II, le 31 mars 1905. Convaincu que l’Allemagne « bluffe », Delcassé presse le Sultan d’accepter le protectorat, se dit certain du soutien anglais et refuse à l’Allemagne le principe d’une conférence européenne sur la question. Des préparatifs de guerre commencent à se faire, en France et en Allemagne. Le Président du conseil français, Rouvier, les socialistes et une grande partie de l’opinion radicale s’opposent alors à Delcassé. Le 6 juin, au cours d’un Conseil des ministres dramatique, Rouvier, qui vient d’avoir une entrevue secrète avec un émissaire allemand, obtient la démission de Delcassé.
Celle-ci retarde peut-être l’échéance de la Première Guerre mondiale, mais ne change rien aux rapports de force. En effet, la période Delcassé a défini les paramètres de la politique française, et les orientations profondes qu’il a mises en route continueront à se manifester sans lui. C’est l’engrenage fatal vers la guerre : de 1906 à 1913, la politique extérieure de la France va passer par des phases, des « accents » différents mais les trois piliers construits par Delcassé en forment l’essentiel : renforcement du bloc franco-anglais, lente marche vers le protectorat au Maroc contre l’Allemagne, soutien aux grandes affaires.
Cette dernière orientation, moins apparente que les autres, est sans doute essentielle. Delcassé a livré la France au capital financier, qui dirigera sa politique, quels que soient les hommes qui le représentent. Nous verrons plus loin comment marche le système ; qu’il nous suffise ici de dire que Rouvier - qui prend le ministère des Affaires étrangères à la chute de Delcassé - ou Stephen Pichon - le « favori » de Clemenceau, ministre des Affaires étrangères entre 1906 et 1909 - doivent pratiquer la même politique.
Rouvier, affairiste intelligent, compromis dans le scandale de Panama et ayant effectué un superbe numéro de rééquilibre, tente un instant de revenir sur la politique de Delcassé. Les intérêts auxquels il est lié ne le lui permettent pas.
La conférence internationale d’Algésiras (15 janvier - 7 avril 1906) donne à la France des droits particuliers au Maroc, admis par l’Allemagne. C’est une occasion éventuelle d’apaisement. Mais la logique mise en place par Delcassé est implacable : la Banque d’Etat qui va être créée au Maroc en 1907 passe essentiellement sous le contrôle de Paribas. Une partie de la presse - sous influence anglaise - présente la démission de Delcassé, en pleine crise internationale, comme un affront. Delcassé lui-même va rencontrer en Angleterre son ami Lord Northcliffe, l’unique propriétaire du Daily Mail. Une vague de nationalisme anti allemand se déclenche en France, éveillant les vieux fantômes, contre laquelle l’opportuniste Rouvier ne veut pas nager à contre-courant.
Une occasion est perdue, car aucun dirigeant politique n’a le courage et la hauteur de vue suffisants pour régler le fond du problème.
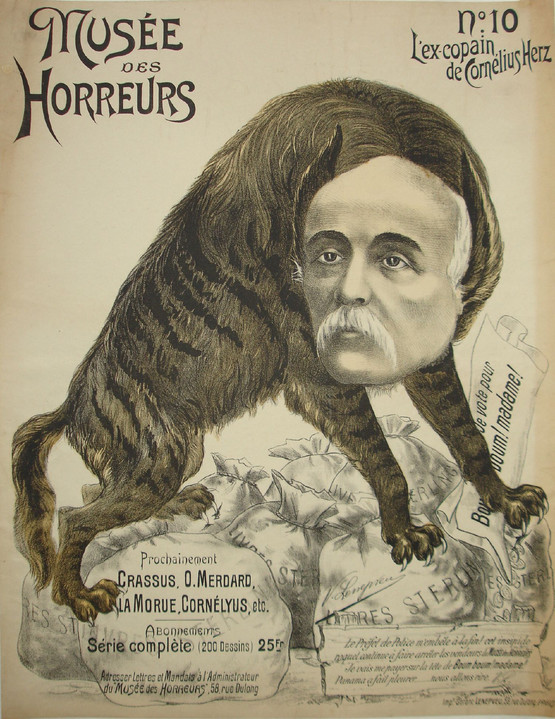
Georges Clémenceau dit le tigre.
|
| Georges Clémenceau dit le tigre |
D’autres le seront encore : après avoir couvert de redoutables initiatives militaires et diplomatiques au Maroc, Clemenceau et son ministre des Affaires étrangères, Stephen Pichon, avertissent le gouvernement russe, en février 1909, pendant la première crise balkanique, que la France ne soutiendra pas militairement ses positions face à l’Autriche-Hongrie car « les intérêts vitaux de la Russie » ne sont pas en jeu. Au Maroc, un accord financier franco-allemand est signé le 9 février 1909, pour exploiter en commun le sous-sol marocain. L’Union des mines marocaines est créée dans laquelle Schneider a 57% des parts, et les firmes allemandes 20% - dont principalement Krupp.
Cependant, là encore, rien de stable n’est bâti, rien n’est résolu sur le fond : il s’agit d’un accord local, sans envergure mondiale, dans lequel l’appât d’un gain rapide dépasse tout. Les axiomes de base qui mènent l’Europe à la guerre ne sont pas remis en cause.
Un même type d’accord réglera définitivement le différent franco-allemand sur le Maroc, en 1911. La nouvelle crise est provoquée par l’initiative que prend en avril le ministère radical Monis, de faire occuper Fez en violation flagrante de l’Acte d’Algésiras. L’Allemagne répond en envoyant le 20 juillet à Agadir une canonnière symbolique. Les deux pays sont à nouveau au bord de la guerre. C’est Joseph Caillaux, devenu président du Conseil le 24 juin, qui sauve la paix. Il engage des pourparlers secrets sans en avertir son ministre des Affaires étrangères, de Selves, comprenant que la seule chance est de court-circuiter le Quai d’Orsay.
Finalement, un accord est signé, le 4 novembre. Mais c’est un accord de troc colonial, et même s’il est passé entre la République française et l’Allemagne, il est de « modèle » britannique.
L’Allemagne accepte d’avance le protectorat français sur le Maroc qui, dès lors, n’est plus qu’une formalité, et obtient en échange une part importante du Congo, entre le Cameroun et le Congo belge. Les blocs diplomatiques et militaires ne sont pas effrités par la crise, mais en sortent renforcés. Les nationalismes se sont exaspérés, aussi bien en France qu’en Allemagne.
Certes, la question du Maroc est réglée, mais la crise européenne rebondit dans les Balkans. Finalement, c’est à partir de là, par le jeu des alliances que dénonce Jaurès et qu’Hanotaux avait tenté d’empêcher, que la France et l’Allemagne se feront la guerre. La cause efficiente, immédiate, est l’attitude russe : l’ambassadeur du Tsar à Paris, Isvolski, parle de « sa guerre ». Mais la cause finale est la fatalité d’un conflit dans un univers de prédateurs, dont les règles de fond ont été définies par le libéralisme britannique : sélection du plus apte, usure financière, malthusianisme, pillage des ressources outre-mer.
A cela, ni la France ni l’Allemagne n’ont su opposer un modèle différent, une alternative, car elles se trouvaient gangrenées de l’intérieur par les mêmes intérêts et la même idéologie.
Afin que cela puisse aujourd’hui servir de leçon, nous devons examiner de plus près la nature de cette gangrène, qui n’a pas disparu et que nous devons prévenir.
Si l’on reprend l’Education sentimentale de Flaubert, livre témoin du siècle, et que l’on examine la situation de son héros, Frédéric Moreau, l’on s’aperçoit qu’il n’est rien, ne devient rien, n’exerce aucun métier : c’est un pur rentier qui consomme sa rente, et qui trouve le plus naturel du monde de vivre ainsi. L’Ambassadeur d’Allemagne à Paris, en 1878, constatait : « Le monde de la finance gouverne Paris ».
La France, à partir du milieu du XIXème siècle et jusqu’en 1914, devient en effet un pays créancier, prêteur et rentier du monde - des créances qui vont souvent se volatiliser, des prêts cesser d’être honorés et des rentes disparaître. Entre 1904 et 1914, les banques d’affaires orientent hors de France les trois quarts de leurs placements. En 1904, les investissements extérieurs totaux de la France représentent déjà 45 à 50 milliards de francs, sur 105 à 110 au total !
A l’opposé de l’Allemagne d’alors, la France détourne ses fonds de la métropole et les déplace à l’étranger. L’industrie française en souffre, et perd ses positions dans le monde : en 1880, la France représentait 9% de la production industrielle mondiale, contre 6% en 1913.
En 1914, 25% de l’argent placé à l’extérieur de la France a été prêté à la Russie, 23% a été placé en Europe occidentale et orientale et 13% dans les Balkans et l’Empire ottoman. La politique extérieure de la France tend de plus en plus à devenir une politique de gestion et de défense du revenu de ses placements. Sa « logique » se rapproche tout à fait de celle de l’Angleterre, jusqu’à se confondre parfois avec elle.
Ainsi, la Banque de France et la Banque d’Angleterre nouent des relations très étroites - au bénéfice de la Banque d’Angleterre. Lors du krach Baring, en 1890, la Banque de France consent à son « aînée londonienne » une aide généreuse - 75 millions de franc-or - et lors de la crise de 1906-1907, 120 millions en espèces, à quoi s’ajoute un escompte libéral du papier anglais.
Des « cercles financiers » se constituent à Paris comme à Londres, dans lesquels se pratiquent des « mœurs anglomanes ». La famille Rothschild exerce, sous la République comme sous l’Empire, une influence déterminante : c’est elle qui a organisé l’emprunt pour rembourser les indemnités de guerre allemandes en 1870 - sous l’œil bienveillant de Bismarck ; c’est elle qui fait échouer, en mai 1891, un emprunt russe afin de forcer le gouvernement du Tsar à signer, en 1892-1893, l’alliance franco-russe. C’est elle enfin qui a lancé Horace Finaly, le directeur de Paribas, et examine avec lui et sa branche anglaise les orientations stratégiques de la politique française.
En 1882, c’est Léon Say, dans le ministère Freycinet, qui fera tout pour accélérer le krach de l’Union générale, banque d’affaires lyonnaise patronnée par le monde catholique et légitimiste, y compris le Vatican et le comte de Chambord, et qui avait osé se heurter aux fortes positions ... de Paribas en Europe centrale.
Ancien attaché au cabinet de Thomson, ministre de la Marine, et lié à Delcassé et Etienne, Laurent Atthalin deviendra secrétaire général de Paribas, consacrant « l’affairisme » du monde politique.
Ce « système financier », dans lequel Paribas et les Rothschild jouent un rôle moteur, repose, principalement, sur la mise en coupe réglée du Maroc et l’exploitation de l’emprunt russe.
L’on a vu l’infléchissement anti allemand organisé par Delcassé, avec le soutien de Paribas, dans les affaires marocaines. Un « Comité du Maroc » se constitue à la suite de ces événements, également appelé « cercle décisionnel » - fondé par Eugène Etienne, avec auprès de lui Stephen Pichon, les frères Cambon et E. Dupasseur, représentant le groupe Paribas. C’est ce groupe qui exerça sa tutelle sur la politique marocaine de la France.

Après Fachoda, l’Empire « nourricier » français au Maroc.
|
| Après Fachoda, l’Empire "nourricier" français au Maroc |
Sur le plan politique, son expression sera un « front » extrêmement souple, rassemblé autour de personnalités comme Rouvier, Etienne, David Raynal et Jules Siegfried (le père d’André), sous le nom d’Alliance démocratique. L’Alliance - groupe-charnière type, nécessaire à toutes les majorités - recevra le soutien de tous les grands journaux d’information distillant généralement cette idéologie anti allemande contre laquelle protestait Jaurès, et une vision assez idyllique de la monarchie anglaise. L’on y trouve Le Petit Journal de Charles Prévet, Le Petit Parisien de Jean Dupuy, Le Journal, Le Matin et aussi le très influent et quasi-officieux Le Temps, d’Adrien Hébrard.
Ainsi, peut-être pour la première fois dans 1’histoire de France, le parti financier s’organise, avec un front politique, le soutien de la grande presse et une perspective pro-anglaise qui mèneront tout droit à la guerre.
C’est également ce groupe qui négociera avec Theodore Roosevelt la présence des intérêts financiers américains en Europe. Le président américain, sollicité par l’Empereur Guillaume II d’intervenir en 1905 dans le différent franco-allemand sur le Maroc prendra en effet parti pour les intérêts financiers français, et soutiendra d’abord la France à Algésiras pour intervenir finalement à ses côtés dans la guerre en 1917.
L’on ne connaît généralement pas le fondement de ce subit sentiment pro-français d’un président qui était généralement perçu comme plus attaché à l’Allemagne, y compris par Guillaume II. Eh bien, la raison en a été longtemps connue, mais opportunément occultée : en 1899, le contrôle de la Compagnie nouvelle de Panama était enlevé au financier lyonnais Jean-Marie Bonnardel, et l’affaire entière vendue aux Etats-Unis en 1904. Comme le dit alors avec un « understatement » tout britannique Rouvier, « l’attitude américaine à la conférence d’Algésiras, à propos du Maroc, n’a peut-être pas été sans rapport avec l’heureuse cession de Panama aux intérêts de Wall Street. »
Le premier emprunt russe placé en France le fut en 1888. Si à l’origine l’usage des fonds avait un but louable et nécessaire - le développement de l’intérieur de la Russie - très vite, ils furent détournés de leur objet initial.
En effet, au départ ils servirent à la construction de chemins de fer - la construction du transsibérien - et au développement de fortes positions françaises dans les mines et dans les industries de base russes : les Forges de l’Horme s’implantèrent dans les Forges et Aciéries de Huta Bankawa et de la Koma, Schneider dans les aciéries de Saint-Pétersbourg, dans l’Oural, dans le Donetz et dans des chantiers à Reval. Cependant, les banques qui orientaient les fonds et un gouvernement russe « sous influence » utilisèrent rapidement les emprunts français aux fins de bâtir la puissance militaire russe contre l’Allemagne.
L’accord signé par Delcassé avec la Russie le 9 août 1899 modifia ainsi radicalement les finalités officielles de l’alliance franco-russe : celle-ci n’a plus pour but « le maintien de la paix », mais celui de « l’équilibre entre les forces européennes ». La portée des relations financières franco-russes se modifie également : désormais « les négociations seront autant le fait des gouvernements que des financiers » - puisque les financiers contrôlent les gouvernements...
Le résultat de cette réorientation est la construction quasi systématique de chemins de fer russes pour transporter les troupes vers le front allemand, et le développement d’industries de guerre. Réécoutons Delcassé s’exclamant, à la veille de la guerre : « La victoire est certaine ! On m’a tout montré quand j’étais en Russie. J’ai étudié tous les chemins de fer stratégiques... »
Or si l’on examine la liste des banques intéressées par les emprunts russes, l’on retrouve - aux côtés du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, d’Hottinguer, du Comptoir national d’escompte - Paribas et les Rothschild. En 1908, entre 3,6% et 5,2%, selon les calculs, de la fortune privée française s’était transformée en fonds russes.
Les « petits rentiers » constituaient dès lors la base politique de tous ceux qui, suivant l’impulsion donnée par Delcassé, avaient opté pour le tsarisme et pour l’Angleterre.
Face à cette inéluctable évolution vers la guerre, l’on doit se demander pourquoi une opposition plus cohérente défendant une alternative politique ne s’est jamais clairement levée.
La réponse, simple et tranchante, vaut pour la politique de 1991 aussi bien que pour celle de 1891 : alors, comme aujourd’hui, aucune force organisée ne s’est trouvée capable de briser le moule idéologique et financier dans lequel la France s’était enfermée. Plus que de faire un choix politique objectif, à un moment donné, Il s’agissait de transformer sa manière de penser et de voir.
Pour cela, il aurait fallu un homme fort, pensant et voyant au-delà des combinaisons immédiates, et appliquant ses vues et ses idées de manière implacable.
Hanotaux, trop homme de sérail, ne pouvait être cet homme de rupture-là.
Sa pensée est beaucoup trop prisonnière, sur les questions fondamentales de culture et de jugement, de catégories « traditionnelles », qui sont celles de l’univers défini par les arrangements de la Sainte-Alliance de 1815.
Il voit dans la « paix » un accord avec chacun, qui peut être obtenu par des négociations préservant les intérêts des uns et des autres. Certes, il conçoit la menace britannique, contrairement à Delcassé, qui cherche à s’accommoder d’avec elle - mais il ne mesure pas son caractère, en profondeur, ce qui fondamentalement la définit.
Ainsi, Hanotaux, par exemple, comprend très bien l’importance des chemins de fer à l’aube du XXème siècle.
Alors qu’en Chine, c’est sur la base de l’Entente cordiale qu’est constitué, en avril 1911, un consortium bancaire dont le seul but avoué est de mettre totalement les mains sur les finances chinoises, Hanotaux pense, lui, en termes d’une entente économique et industrielle, en construisant des chemins de fer Tonkin-Yunnan-Fou et Nanning-Fou-Pakoi.
En Russie, il admire et soutient le projet du transsibérien, de même qu’il admire l’effort des compagnies américaines, et conçoit la ligne vers Vladivostok comme un « axe de développement ».
En Afrique, il voit dans le chemin de fer le « véritable conquérant » et envisage trois tracés d’une ligne transsaharienne :
– à l’Est, une liaison Bizerte-Brazzaville, par Bougrara, Ghadamès, Rhat, Belma, le lac Tchad, Songha et le Congo - c’est le projet de M. Bonnard ;
– au Centre, une liaison Biskra-Ouargla-Assiout-lac Tchad, rejoignant la précédente - c’est le projet de M. G. Rolland ;
– et, enfin, à l’Ouest, un tracé sud-Oranais-Tombouctou, visant à unir le Sénégal à l’Algérie.
Sa conception du « profit » à attendre de la construction de ces voies ferrées est même extrêmement intéressante ; c’est celle d’un « profit-infrastructure », considérant l’effet d’impact du projet, qui rompt avec la conception britannique du « profit-butin » lié aux revenus immédiats du transport.
Il écrit : « La dépense est immense, dit-on, et la rémunération sera nulle. Le trafic du désert, quelle plaisanterie (...) Que le désert ne paye pas, d’accord. Mais qu’est-ce que le désert ? C’est un obstacle, c’est une séparation. Prétendre lui demander une rémunération, c’est prendre la question à rebours. La mer aussi est un obstacle, une séparation. On n’hésite pas à la franchir, pourtant, pour relier des pays qui, sans l’initiative et l’audace des premiers navigateurs, auraient été pour toujours séparés. Et la mer non plus ne paye pas (...) Partout où le chemin de fer pénètre, la paix s’établit (...) S’il économise sur les frais d’installation, s’il économise sur les frais de ravitaillement, s’il protège militairement l’Algérie et le Sénégal, s’il dispense d’établir dans le Sud les postes échelonnés qui coûtent si cher ... s’il rend de tels services, sa création peut se justifier. »

L’Empire français expose ses « trouvailles ».
|
| L’Empire français expose ses "trouvailles" |
Cependant, Hanotaux ne parvient pas à comprendre que le « système britannique » va à l’opposé de ce qu’il écrit, et que l’Angleterre doit être combattue dans la mesure où elle est le lieu d’implantation de ce système. Dès que son jugement est politique, historique ou culturel, Hanotaux retombe dans les catégories de la Sainte-Alliance et dans la vieille admiration que « son » ministère éprouve pour le Français de la Sainte-Alliance, Talleyrand.
Ecoutons-le parler, dans Le Partage de l’Afrique, en 1909, des « nobles qualités de la race anglo-saxonne (...) grande et noble race », et nous comprendrons que ses catégories mentales ne sont, hélas, pas différentes de celles de Londres, et de celles de toute l’oligarchie européenne marquée par le darwinisme social de Spencer. « Les plus aptes » ont triomphé, et c’est justice ; les races inférieures n’ont vocation qu’à être « prises en main » par les « nobles colonisateurs » français et britannique, qui ont certes une querelle à vider ensemble, mais une querelle de « gentlemen ».
Ecoutons-le s’exprimer dans Fachoda, article publié par La Revue des deux mondes du 1er février 1909 :
« Depuis des siècles que la France et l’Angleterre travaillent ensemble au progrès de la civilisation, il semble que les deux peuples devraient se bien connaître et se comprendre aisément. Il n’en est rien : le détroit oppose les esprits comme les rivages. La mer, qui unit d’ habitude, disjoint ici. Pourtant, la similitude des origines, des idées, des intérêts, maintient, entre les deux maux, une habitude, une recherche de rapports cordiaux dont les alternatives créent un drame, parfois décevant, mais toujours animé.
« La négociation franco-anglaise est l’épreuve suprême des diplomates et le gage le plus assuré d’une paix heureuse dans l’univers : pour les hommes du métier, il est normal, et pour ainsi dire fatal, que Talleyrand ait achevé sa carrière à Londres. Entre Londres et Paris, la conversation doit être constante, si elle est parfois laborieuse ».
Et Hanotaux de se défendre d’avoir contribué à un affrontement franco-anglais : « On a attribué au ministre des Affaires Etrangères de ce Cabinet (c’est le cabinet Méline, et il parle de lui-même ...), une politique systématique, un parti pris de se rapprocher, en Europe, des combinaisons hostiles à l’Angleterre : c’est radicalement faux. »
Hanotaux n’est donc pas l’homme d’une rupture avec le système britannique ; il l’est d’autant moins qu’en matière de politique coloniale, et vis-à-vis de la population africaine, il partage les pires préjugés de son époque - à la différence d’un Faidherbe, d’un Brazza ou même d’un Livingstone.
Ecoutons-le encore - et cela en dit long sur les « républicains » de l’ époque - parler de l’Afrique, de la « barbarie de ces régions immenses » peuplées par « des pauvres races inférieures » : « ... des populations hagardes et stupides, n’ayant ni art, ni luxe, et par conséquent inaptes au commerce et à l’industrie, des agglomérations mobiles, faites et défaites selon les hasards d’une chasse heureuse ou d’une conquête éphémère, des démons noirs allumant en quelque clairière, le feu d’ un festin de cannibales, des faces sinistres apparaissant ou disparaissant au coin d’un buisson, des tribus vacantes s’empiffrant de nourriture à l’aubaine de quelque bonne proie, puis, le lendemain, décimées, réduites à rien par la misère et la faim, errant le ventre creux ou plein de terre et d’insectes immondes, telle était la vie sur cette terre maudite. Et c’était cela qu’il s’agissait de coloniser ! »
Nous sommes évidemment bien plus près du « lourd fardeau de l’homme blanc » de Kipling que de l’humanisme de l’Abbé Grégoire...
Alors que l’esclavage sévit encore en Afrique, que les grands colons français en Tunisie ou en Algérie « dépossèdent les indigènes » ( « l’affaire Couitéas », où Stephen Pichon, résident général en Tunisie de 1900 à 1906, n’a pas le beau rôle) et que l’armée française occupe Madagascar et écrase les troupes courageuses mais mal équipées de Samory, comment peut-on écrire, sans être un peu de tempérament anglais, tranquillement enfoncé dans son fauteuil ministériel ou académique : « Je ne sais rien de plus réconfortant que le spectacle de la lutte engagée, depuis un siècle : par les fils de l’Europe civilisée contre le système barbare (sic) qui veille sur le système africain » ?
Hanotaux est un homme conscient des intérêts immédiats de la France, féru de progrès économique, concevant assez bien les questions de la guerre et de la paix en Europe, mais c’est l’homme du Quai d’Orsay, pas l’homme d’une rupture, ou celui d’un grand dessein d’ensemble à opposer à la force impériale britannique.
Jaurès l’est bien davantage, qui voit tout de suite l’inflexion apportée par Delcassé à la politique coloniale française, et que la « question du Maroc » mène directement à la guerre. Guidé par une immense compassion humaine, il ressent - bien que défendant « l’œuvre civilisatrice de la France » lorsqu’elle se manifeste, l’outrage fait aux petits propriétaires indigènes, la mise en coupe réglée des peuples, et voit très bien se gonfler les nuages au-dessus de l’Europe.
Cependant, il est trop isolé sur la scène politique, et il sera constamment en butte, jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’a son assassinat, à une campagne de presse qui en fait un agent allemand désigné à plusieurs reprises par la furie « nationaliste » aux balles des assassins.

Léon Gambetta : « le seul homme qui eût été capable d’éviter le pire ».
|
| Léon Gambetta : "le seul homme qui eût été capable d’éviter le pire" |
En réalité, l’on peut dire que le seul homme qui eût été capable d’éviter le pire était Léon Gambetta. Dirigeant du Parti républicain et de la résistance nationale en 1870-1871, il ne pouvait être soupçonné d’être pro-allemand. Fortement attaché à la paix, il veut, lorsque l’affaire d’Egypte se présente, fin 1891, « remettre l’Angleterre à sa place ». Il constitue le fameux « grand ministère » le 14 novembre 1881, et se déclare contre un contrôle unilatéral de l’Angleterre sur l’Egypte.
Le gouvernement de Londres se dresse contre lui, et fait courir par ses agents dans la presse française le bruit que « Gambetta, c’est la guerre ».
Le 26 janvier 1882, il est « abattu par les partis des financiers ». Ceux-ci forment un groupe parlementaire, dirigé par Maurice Rouvier - déjà - qui s’oppose à l’autre grand dessein de Gambetta, la nationalisation des compagnies de chemin de fer. S’érigeant en défenseur des « compagnies » avec Eugène Etienne - le futur dirigeant du parti colonial, ce qui est significatif, Rouvier, soutient plus tard un projet, dit « projet Raynal », qui donnera un avantage absolu aux intérêts privés, liés à la haute banque. Suivant ce projet, rédigé par David Raynal, Léon Say, l’homme des Rothschild - et Rouvier lui-même, l’Etat laissera aux compagnies le soin de continuer l’exploitation et l’extension du réseau, et plus encore, donnera sa caution aux emprunts qu’elles émettront - avec la diligence de Paribas, de Rothschild et de leurs confrères - et garantira leurs dividendes !
A noter qu’en 1896, c’est également Maurice Rouvier qui, avant d’être généreusement compromis dans le scandale de Panama fera échouer l’impôt sur la rente, pourtant modéré, présenté par le ministère Méline.
Léon Gambetta tombe donc sous les coups des « affairistes » proches, à travers leurs combinaisons financières, des intérêts britanniques. Il mourra dans des conditions extrêmement suspectes, le 31 décembre 1882, livrant ainsi la République à des hommes sans caractère ou faisant le jeu du libéralisme financier.
Pourquoi cet acharnement contre Gambetta ? Précisément parce qu’il est, lui, un homme de caractère. C’est une fois qu’il est éliminé que la « douloureuse abstention de la France laissa (dans les affaires de l’Egypte) les mains libres à l’Angleterre ». Gabriel Hanotaux est un homme qu’il a recruté et formé, un collaborateur du Journal qu’il dirige, la République française.
Il est vrai, dira-t-on, que Delcassé et Etienne ont fait également partie de l’équipe de la République française, auprès de Gambetta. Mais c’est pratiquement tout ce qui comptait sous la IIIéme République qui avait été formé dans le proche entourage de Gambetta ! Il est arrivé aux Etienne, aux Delcassé ou aux Poincaré un peu ce que l’on a vu arriver aux barons du gaullisme et aux dirigeants du RPR : le général disparu, il ne reste que l’opportunisme et la connaissance des affaires, sans la flamme.
Léon Gambetta menaçait constamment les situations acquises ; avant de tomber, le 31 janvier 1882, sur une question relevant dans les apparences immédiates du mode de scrutin, il avait déclaré : « Ils passeront sous les fourches caudines, ou je les abandonnerai à leur irrémédiable impuissance ».
Comme De Gaulle après 1969, il les livra à leur « irrémédiable impuissance ». Sa culture était celle d’un « bourgeois républicain » de l’époque - Descartes, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Proudhon, Auguste Comte.
Il détestait cependant le « rousseauisme démagogique », et entendait faire, comme il le répétait souvent, « l’éducation de la démocratie » en lui fournissant un dessein et un programme cohérent.
Il ne put donner sa mesure, mais fit passer dans la politique française de l’époque le souffle de Jeanne d’Arc, de Rabelais et des volontaires de 1792, de l’an II que, comme De Gaulle ou Malraux, il admirait.
Avec lui, il n’y aurait pas eu de place pour la folle aventure du boulangisme, à travers laquelle l’idée de nation fut d’abord pervertie, pas de brisure entre l’Eglise et l’Etat et peut-être pas d’affaire Dreyfus tant, comme son ami Scheurer-Kestner, qui joua dans l’Affaire un si grand rôle, il était passionné de justice.
Gambetta, c’était, au début de la République, le seul homme de proue. Après lui, les impuissants et les notables, obéissant à des intérêts acquis, triomphent. Là est le problème fondamental.
Car le « mal libéral », qui n’a jamais atteint Gambetta, se glisse partout après lui.
Après lui, Hanotaux, serviteur mais non dirigeant, ne peut faire que de la résistance. Pourquoi ? Parce que la dégradation idéologique, dans le climat d’affairisme et de compromission avec les forces financières qui se crée, corrompt les valeurs les plus fondamentales, l’idée de nation, la conviction républicaine et jusqu’aux croyances religieuses.
Il serait trop long de refaire l’histoire de la contre-culture qui se répand à la fin du siècle : à un nationalisme satisfait, médiocre et repu s’oppose un néo-spiritualisme qui véhicule toutes les formes d’irrationnel.
Comme aujourd’hui, ce sont les Institutions et les valeurs qui se trouvent elles-mêmes détruites, privant les hommes de repères dans leur combat pour la justice.
L’histoire de cette gangrène - dont nous ne pouvons ici que tracer les grands traits - est indispensable pour comprendre les paramètres du monde qui se met en place, ce qui détermine les choix, en fait poser les termes.
Alors que l’alliance franco-russe a pu être complètement changée de sens par le parti des financiers et la stratégie de Delcassé, c’est, au-delà de l’événement transitoire, l’idée même de nation qui bascule à la fin du XIXème siècle. De son avilissement, le XXème siècle subira toutes les atroces conséquences, dont nous ne sommes, aujourd’hui encore, toujours pas guéris.
D’idéologie républicaine qu’elle était, la « religion de la patrie » s’infléchit, à travers la période boulangiste et l’affaire Dreyfus, vers l’exaltation d’un Etat à composante ethnique ou raciale homogène, reposant sur son armée, au détriment de l’universalité du respect de la vie et des droits de l’Homme. La nation se dissocie du principe républicain.
D’abord, tout au long de la période boulangiste, entre janvier 1886 et le 1er avril 1889 - lorsque Boulanger fuit à Bruxelles - c’est toute une opération de manipulation de masse qui se déroule. Le nouveau « nationalisme », un montage plus ou moins synthétique qui réunit des hommes de gauche, anciens communards, et des hommes de droite, royalistes ou bonapartistes, se pose en défenseur de l’Armée nationale, instrument d’unité, et en adversaire de l’étranger en général et du judaïsme « traître par nature ». Rappelons que la France juive d’Edouard Drumont fut publiée le 11 décembre 1886, au moment où le mythe boulangiste prend corps.
C’est en 1890 que Drumont fonde la Ligue antisémitique. En mai 1892, la Libre Parole, le journal de Drumont, commence sa provocation en publiant une enquête intitulée les juifs dans l’Armée et réclamant bien entendu leur élimination. En septembre 1892 c’est aussi la Libre Parole qui s’empare la première, dans une suite d’articles signés Minos, du scandale de Panama. Les journaux antisémites utilisent le fait que les intermédiaires (Reinach, Arton, Herz) étaient d’origine juive pour développer leur propagande. Les scandales nourrissent l’antiparlementarisme ; et l’on note que la Libre Parole et ses semblables publient des listes de parlementaires corrompus qui s’auto-gracieront - car les habitudes sont toujours les mêmes pour les hommes d’habitudes - mais sans jamais mentionner le véritable scandale, qui est celui des immenses profits faits par les banques ! Certaines preuves existent du financement de la Libre Parole et de ses consœurs par ces dernières ...
Quoi qu’il en soit, l’utilisation que fait de Panama la presse antisémite et « nationaliste » prépare le levain d’où sortira l’affaire Dreyfus.
Là aussi, coïncidence significative, la première information publiée dans la presse sur « l’affaire » le fut dans la Libre Parole du 29 octobre 1894. Dès le 1er novembre 1894, elle titrait sur toute la longueur de la page : « Haute trahison. Arrestation de l’officier juif Alfred Dreyfus »
Et l’affaire Dreyfus servit de « toile de fond » à toute la période, entre fin 1894 et le 19 septembre 1899, lorsque le président de la République signe enfin la grâce de Dreyfus. Elle exacerbera les passions, et contribuera à pervertir l’idée de nation en France.
C’est dans ces années-là, en effet, que le « nationalisme » ou le patriotisme ne sont plus l’expression d’un vouloir-vivre en commun œcuménique, fondé sur le grand dessein d’une nation, au progrès de l’histoire universelle, mais deviennent l’adhésion a des valeurs irrationnelles de sang, de sol et de race. L’antidreyfusisme est une sorte d’ersatz de l’idée républicaine de nation, fondé sur « le culte du terroir », la « mystique de la race » et le pouvoir « offert aux militaires ».
C’est dans ce contexte « national » synthétique, fabriqué, très évidemment fabriqué, - en France, mais aussi en Allemagne - que l’Alsace-Lorraine, part du sol français pour les uns, extension légitime de l’Empire allemand pour les autres, devient une question insoluble qui ne peut être dénouée que par la guerre. Au-delà de l’intervention nécessaire en faveur d’un innocent qui « représente l’humanité bafouée », le vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner, alsacien et protestant, est l’un des rares à mesurer cette dimension historique de l’affaire.
Quant au Consistoire, loin de soutenir le courageux combat de Bernard Lazare, il décide, sous l’influence d’Alphonse de Rothschild, qu’il est urgent de ne rien faire...
L’Affaire Dreyfus - rappelons que Dreyfus est accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne, par un faux assez grossier de lettre entre l’attaché militaire italien Pannizardi et l’attaché militaire allemand von Schwartzkoppen - entretient donc le climat anti allemand, divise la France en deux à un moment où une grande politique continentale aurait été possible et jette la majorité des catholiques dans le même camp politique que les antisémites.
| "Outre la terrible injustice faite à un homme, l’affaire Dreyfus est un immense désastre politique et moral" |
Outre la terrible injustice faite à un homme, c’est un immense désastre politique et moral. Le curieux commandant Esterhazy, très vraisemblablement auteur du « faux » incriminant Dreyfus, ne travaillait certainement pas que pour lui-même. Si l’on s’en tient à l’adage « à qui profite le crime », il semble bien qu’il faille répondre « aux bellicistes français et à leurs amis britanniques ». Il a pu être ainsi soutenu que les provocateurs de l’époque - Esterhazy comme Drumont - auraient été stipendiés par le « parti britannique », voire par la banque Rothschild elle-même, thèse qui a pour mérite d’être tout à fait cohérente.
C’est en effet pendant les années de l’affaire Dreyfus que se tient le premier congrès sioniste mondial, en 1897 à Bâle. Or l’on sait le rôle joué dans ce mouvement par les services britanniques, qui espèrent tour à tour jouer la carte juive et la carte arabe au Proche Orient, et pour cela, encouragent les juifs d’Europe à s’installer en Palestine.
Les pogroms de Russie suscitent cette émigration vers une terre qu’on a décrit aux émigrants comme « déserte », et qui est l’une des - relativement - plus peuplées du Proche Orient. Mais l’on oublie la peur créée par les déchaînements racistes en France même, jusqu’aux véritables pogroms d’Alger, pendant la honteuse semaine du 18 au 25 janvier 1898.
Ce sont ainsi tous les paramètres du XXème siècle qui se mettent en place, et parmi eux le pire, celui d’une « nation » qui se définit nécessairement contre les autres, par exclusion, un « volks » irrationnel qui contribuera à jeter les nations d’Europe continentale les unes contre les autres - suivant le vœu de l’oligarchie britannique.
En même temps, dans ces années-là, sévit en France un affligeant bric-à-brac pseudo scientifique, issu du darwinisme revu par Spencer, de l’anthropologie et de la linguistique. L’anthropologie, partant de Broca et avec Vacher de Lapouge (L’Aryen, son rôle social, écrit en 1899) s’acharne à classer les races suivant les traits physiques, et la linguistique fournit le modèle de la « bipartition » entre Sémites et Aryens. L’élégant Paul Valéry fréquente les cimetières de la région de Montpellier, dont son maître Vacher de Lapouge mesure les crânes pour justifier ses thèses et répéter que « la plus belle conquête de l’homme ne fut pas le cheval mais l’esclave ». Sinistres années, où le « juif Dreyfus » travaille bien entendu pour l’Allemagne, où « Herr Jaurès mérite douze balles » et où l’on oppose les dolichocéphales aux brachycéphales, « inertes, médiocres, noirauds, courtauds, lourdauds ». On parle « d’empire mondial », de « race supérieure », de « teutons blonds » et de « fiers gaulois à tête ronde ».
L’irrationnel « nationaliste » - d’où naîtront les fascismes, rejoint alors le « militarisme », qui jouera un rôle si grand dans la grande illusion de 1940. L’on oppose le « soldat », qui « obéit d’instinct », à « l’intellectuel ratiocineur », à l’universitaire « toujours soumis à la culture germanique ».
Pour faire bonne mesure, un professeur à Sens, agrégé d’histoire, Gustave Hervé, popularise un anti-militarisme forcené au sein du parti socialiste. Ses articles dans le Pioupiou de l’Yonne et, à partir de 1906, dans La Guerre sociale, et son « antipatriotisme » lancé fin avril 1905 avec les procédés publicitaires les plus modernes, déchaînent la « réaction nationale » et le soutien à l’Armée dans le camp opposé. Ce provocateur deviendra d’ailleurs l’ennemi virulent de Jaurès et va-t-en guerre enragé en 1914...
A l’université, un retour à un spiritualisme « mystique » - par opposition au matérialisme affairiste « rad-soc » et « opportuniste » joue son rôle dans le grand orchestre « nationaliste » dont la musique reprend en 1905, s’amplifie à partir de 1911 et se déchaînera en 1914.
Blondel et Bergson en sont les figures de proue ; Bergson commence son cours au Collège de France en 1897 avec un extraordinaire succès mondain et un énorme battage journalistique : il promeut « l’élan vital » et réhabilite l’irrationnel, ouvrant la voie, comme Jaurès le pressentait, à toutes les aventures.
En même temps, un fort courant malthusien se développe et s’étend ; Bergson lui-même défend, après la guerre, en tant que président de l’institut international de coopération intellectuelle (IICI) la thèse suivant laquelle « la cause de la plus grave des guerres » est le surpeuplement. Il proposera de « frapper de taxes plus ou moins lourdes l’enfant en excédent, dans les pays où la population surabonde », de « rationaliser la production de l’homme ». C’est une erreur dangereuse, dira-t-il, « de croire qu’un organisme international (la SDN, nda) obtiendra la paix définitive sans intervenir, d’autorité, dans la législation des divers pays, et peut-être même dans leur administration ». Conception d’un impérialisme antinataliste et d’un droit d’ingérence qui incite à des rapprochements avec des faits hélas récents...
L’on est loin, très loin de « l’éducation de la démocratie » que voulait faire Gambetta. La préoccupation principale, au début du siècle, et de plus en plus au cours de ses premières années, est de ne pas briser le lien « sacré » qui rassemble les Français d’opinions différentes « au pied de la statue de Strasbourg ».
Le « parti financier » et ses tuteurs britanniques sont parvenus à créer le culte de masse qui soutient leur pouvoir, et qui mènera à la guerre.
L’offensive idéologique lancée en France contre l’esprit du christianisme revêt une portée plus fondamentale encore que celle ayant finalement perverti l’idée de nation. En comprendre l’objet suppose que l’on sorte du cadre institutionnel du débat - dans lequel il est habituellement posé - et que l’on aille à l’essentiel de l’engagement humain, politique, moral et religieux.
Léon XIII, dès son avènement, en 1878, tente justement de dépasser ce cadre institutionnel, et d’instaurer une entente entre l’Eglise et la République française : il s’agit de définir, pour les catholiques, une position à partir de laquelle ils acceptent clairement le cadre de la République tout en luttant vigoureusement pour les droits de l’Eglise.

Le Pape Léon XIII.
|
| Le Pape Léon XIII |
Si cette politique avait durablement réussi, c’en était fait de l’influence du libéralisme britannique en France, sinon en Europe.
Pour deux raisons : d’abord, la doctrine sociale de l’Eglise, telle qu’elle sera définie dans Rerum Novarum, était totalement incompatible avec le libéralisme économique et définissait un point sinon d’accord, du moins de convergence possible sur la « question sociale », entre chrétiens et socialistes. Le danger, pour un régime « affairiste » et probritannique, était immédiat : détaché de son enveloppe monarchiste et conservatrice, le message de l’Evangile redevenait « révolutionnaire ».
Ensuite, le message chrétien ainsi revivifié était résolument et absolument anti-malthusien ; or, le malthusianisme était une doctrine et une politique essentielle au libéralisme britannique. Remarquons, là encore, que la grande majorité des dirigeants socialistes, Jaurès en tête, étaient eux aussi résolument anti-malthusiens, contrairement aux « républicains opportunistes », aux radicaux et au mouvement de « libre pensée » triomphant dans le Grand Orient.
Plus profondément encore, comme Jaurès l’avait bien vu, la référence « chrétienne » - institutionnalisée ou pas - permet, au nom de principes fondamentaux et de l’existence en soi-même d’un « dieu intérieur », de contester les ordres et les opinions établies, et de ne pas se laisser entraîner par l’irrationnel des sectes ou des mouvements d’opinion. Or c’est bien sur la manipulation de cet irrationnel - avec toute la renaissance du spiritisme, du pseudo mysticisme et de l’occultisme - que comptaient, à Londres, à Paris et ailleurs en Europe, ceux qui entendaient imposer leur « culte de masse » permettant un contrôle social rigoureux.
Aussi, du point de vue de l’idéologie britannique, il fallait absolument empêcher cette « entente » entre la République française et l’Eglise catholique - ou du moins prévenir la diffusion d’un christianisme authentique en France.
La stratégie utilisée pour détruire l’effort de Léon XIII joua à la fois au sein de la République et au sein de l’Eglise. Au sein de la République, en excitant violemment l’esprit anticlérical, en faisant de l’anticléricalisme, pendant plusieurs années, une question obsédante et fondamentale. Une « base de masse » à cette agitation : le radicalisme, animé par le Grand Orient - qui avait supprimé dans sa constitution, en 1876, toute référence à l’existence de Dieu et à l’immortalité de l’âme - et relayé par des « sociétés de pensée » dont les buts sociaux légitimes s’unissaient à des « rituels » ridicules mais populaires : on faisait gras le Vendredi Saint pour affirmer sa liberté de conscience et on mangeait la tête de veau à l’anniversaire de la mort de Louis XVI !
Au sein du catholicisme, c’est la carte de l’irrationnel mystique qui était joué - dans lequel le bergsonisme tint un grand rôle - et des formes de dévotion populaire tout aussi irrationnelles que les laïques : miracles et prophéties, reliques et visions. En même temps, la Bonne Presse - dont le journal assomptionniste La Croix était le fleuron - dérivait dans l’antisémitisme et le militarisme forcené. Pierre Bailly y écrivait, par exemple, le 6 novembre 1894, « qu’ils (les juifs) sont maudits si nous sommes chrétiens (. . .) C’est un peuple déicide, qui a tué le Christ ». Cela ne pouvait que servir le projet de coupure de la France en deux, la déviation de l’idéal religieux se conjuguant à la promotion d’un nationalisme haïssant « l’autre » - juif ou allemand.
La France tombe dans le piège, après la mort de Léon XIII et la chute du ministère Méline. L’histoire mérite d’être rappelée, pour mesurer le mérite et la clairvoyance du pape, dont Jean-Paul II a repris le message aujourd’hui, en subissant des attaques venant de même origine.
A plusieurs reprises, entre 1878 et 1889, le pape avait laissé entendre que les catholiques français devaient accepter les institutions républicaines. Au lendemain des élections législatives de 1889, il intervient. Son objectif est d’affirmer la distinction du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel - que traditionnellement les catholiques français ne font pas - rompre la solidarité des catholiques français et de la monarchie et sauvegarder le Concordat et le budget des cultes menacés par l’agitation radicale.
Léon XIII ne parvient pas, pendant plusieurs mois, à trouver un membre de l’épiscopat français qui prenne une initiative d’ouverture.
C’est finalement le cardinal Lavigerie, archevêque d’Alger et de Carthage, très actif dans les missions outre-mer, fondateur des pères blancs qui, au terme d’entretiens avec le pape, accepte de parler.
Le 12 novembre 1890, accueillant l’état-major de l’escadre de la Méditerranée, il invite, à l’énorme surprise des officiers de marine monarchistes, les catholiques à accepter la République :
« Quand la volonté d’un peuple s’est nettement affirmée, que la forme d’un gouvernement n’a en soi rien de contraire, comme le proclamait dernièrement Léon XIII, aux principes qui peuvent faire vivre les nations chrétiennes et civilisées, lorsqu’il faut, pour arracher son pays aux abîmes qui le menacent, l’adhésion sans arrière-pensée à cette forme de gouvernement, le moment vient ( ... ) de sacrifier tout ce que la conscience et l’ honneur permettent, ordonnent à chacun de nous de sacrifier pour l’amour de la patrie. »
Le « toast d’Alger » esquisse les grands thèmes du ralliement : acceptation du suffrage universel et des institutions, refus de la politique du pire, lutte contre la désagrégation sociale, et patriotisme.
Au sein du monde catholique français, et notamment bien entendu, des monarchistes, l’hostilité l’emporte. C’est à partir de ce jour-là qu’une partie du clergé français - les évêques jugent pour la plupart l’intervention du cardinal Lavigerie dangereuse et inopportune - s’engage à rester sourde au message de Léon XIII.
L’archevêque de Paris, le cardinal Richard, en donne d’abord une interprétation tout à fait détournée de son sens. Puis se crée une « Union de la France chrétienne » dont les candidats s’identifient aux comités monarchiques du comte d’Haussonville, le représentant du comte de Paris.

« La doctrine sociale de l’Église, telle quelle sera définie dans Rerum Novarum, était totalement incompatible avec le libéralisme économique. »
|
| "La doctrine sociale de l’Église, telle quelle sera définie dans Rerum Novarum, était totalement incompatible avec le libéralisme économique" |
Léon XIII doit pousser les feux. Il nomme à Paris un nouveau nonce, Mgr Ferrata, ami du cardinal Lavigerie. Les monarchistes, tout comme les radicaux, veulent faire échouer l’apaisement escompté. En février 1892, les cardinaux français récidivent : ils publient une déclaration condamnant « le gouvernement de la République » tout en « acceptant les institutions ». Le pape, pour s’adresser aux Français, décide d’avoir directement recours ... à la grande presse. Le 14 février 1892, il reçoit Ernest Judet, rédacteur au Petit journal, et lui fait d’importantes déclarations. Le 20 février est publiée, datée du 16 et rédigée en français, l’encyclique Au milieu des sollicitudes : l’Eglise n’est liée à aucune forme de gouvernement ; accepter la République n’est pas se soumettre à une législation hostile à la religion. Le 3 mai, le pape met en garde « ceux qui subordonneraient tout au triomphe préalable de leur parti respectif, fût-ce sous le prétexte qu’il leur paraît le plus apte à la défense religieuse ».
A partir de là, l’extension d’un catholicisme social, fondé sur l’enseignement de Rerum Novarum (15 mai 1891), devient possible en France.
D’autant plus que Jules Méline rejette l’anticléricalisme, où il voit - justement - « une tactique des radicaux pour tromper la faim des électeurs », car anticléricaux, les radicaux n’en sont pas moins, dans leur majorité, opposés à toute réforme sociale conséquente. Accusé alors de « pactiser avec le cléricalisme », il réplique le 10 octobre 1897, dans un discours prononcé à Remiremont, son fief : « Je désire l’apaisement dans le domaine religieux (...) car les querelles religieuses sont toujours une cause d’affaiblissement. » Louis Barthou déclare le 3 octobre 1897 à Bayonne : « Si nous respectons la religion et admettons son libre exercice, nous ne souffrons pas que la religion soit l’instrument plus ou moins déguisé des agitations et des ambitions politiques ».
L’apaisement allait-il l’emporter ? Non, car il sera rapidement balayé avec le reste, la « querelle religieuse » contribuant à cet « affaiblissement de la France » prédit par Méline, et y faussant tout le débat politique, l’égarant dans un nationalisme destructeur.
A la mort de Léon XIII et après la chute de Méline, les relations entre la République française, les catholiques et le Vatican s’enveniment une fois de plus.
Il ne fait aucun doute qu’une majorité de la franc-maçonnerie attise la querelle, celle que Léon XIII avait dénoncée en 1884, dans l’encyclique Humanum genum, comme « le parti de Satan ». L’on assiste en effet à de bien curieuses choses en France à la fin du siècle : l’intérêt pour les « mondes obscurs » grandit, et c’est en 1889 qu’Edouard Schuré publie Les Grands Initiés. Le bouddhisme est à la mode, ainsi que l’occultisme et l’hypnotisme ; au goût morbide, ésotérique et sataniste de Huysmans ou de Gustave Moreau répondent, dans le domaine de la « décoration », une prolifération d’incubes-chandeliers et de chauves-souris-porte-manteaux. Le mage Papus triomphe dans le beau monde, et Jaurès jugera son rôle assez dangereux pour devoir le confondre. Jaurès qui, lorsque sa fille Madeleine fera sa première communion, sera mis en accusation devant tout son propre parti pour « lâcheté » et « cléricalisme » !
Ce n’est qu’en septembre 1899 que le Grand Orient s’épure de ses loges antisémites, notamment algériennes, pour bien s’insérer dans la logique de rupture entre les « deux France » ; d’un côté républicains, anciens dreyfusards, anticléricaux, libres-penseurs, et de l’autre catholiques, anciens antidreyfusards, antisémites et « nationaux ». La catastrophe, que Léon XIII avait voulu éviter et Méline vu venir, se produit, pour la plus grande satisfaction du parti britannique. Car le seul point commun de ces deux France est, comme le voulait Delcassé, l’anti-germanisme, l’irrationalisme et un militarisme cocardier - les ingrédients de la guerre.
Dans le camp qui se dit « catholique », les provocateurs ne manquent pas non plus. Nous avons vu La Croix se lancer à corps perdu dans l’antisémitisme pour servir de diversion à l’anticléricalisme, et alimentant la vague militariste et antidreyfusarde. La Bonne Presse surexcite les prêtres - malgré les efforts d’un abbé Pichot, d’un abbé Lemire ou d’un abbé Naudet - et les entraîne dans des chemins contraires aux intérêts de l’Eglise. Léon XIII et le cardinal Rampolla désavouent d’ailleurs des extrémistes comme le général des Chartreux ou le supérieur des Assomptionnistes - qui exploitent les passions sans mesure.
Après 1900, Delcassé étant ministre des Affaires étrangères, et les gouvernements du « Bloc des gauches » - dominé par les radicaux et la franc-maçonnerie - exerçant le pouvoir, l’affrontement devient inéluctable.
Le Bloc des gauches, sous le gouvernement Waldeck-Rousseau, dans sa loi sur les Associations du 1er juillet 1901, s’en prend d’abord aux congrégations religieuses. A la différence des autres associations dont la liberté de constitution est entière, la simple déclaration permettant d’obtenir la capacité civile, les congrégations religieuses ne peuvent se former sans autorisation législative ; les membres de congrégations non autorisées n’ont pas le droit d’enseigner et les préfets ont un pouvoir annuel de contrôle sur les biens de toutes les congrégations de leur ressort. Combers, anticlérical forcené, remplaçant Waldeck-Rousseau le 6 juin 1902, de nombreux établissements congréganistes sont fermés et les demandes d’autorisation de congrégations, jusque-là non officiellement acceptées, sont rejetées. La loi du 7 juillet 1904 supprime tout enseignement congréganiste.
A partir de là, la France et le Vatican vont vers la rupture : celle-ci est consommée le 30 juillet 1904 lorsque la France rompt ses relations diplomatiques avec Rome.
Deux choses sont intéressantes à constater. D’une part, Delcassé ne se préoccupe aucunement de cette rupture, et même s’en félicite. C’est son rapprochement avec l’Italie - qui n’a pas alors de relations diplomatiques avec le Vatican et que le président Loubet visite, ce qui est perçu à Rome comme une insulte - qui constitue l’une des causes principales du conflit. D’autre part, l’attitude de Pie X est certainement différente de celle de Léon XIII. Admirateur de l’Allemagne et Guillaume II, il est sous l’influence de son cardinal secrétaire d’Etat Merry del Val, dont la mère est anglaise, et qui est extrêmement conservateur. Pour ce dernier, la France n’est pas la « fille aînée de l’Eglise », mais un pays d’hérésie. Les milieux catholiques français que Léon XIII avait tenté de modérer, le cardinal Merry del Val les encourage. La France et le Vatican se heurtent ainsi de plein fouet, jusqu’à la promulgation de la loi du 11 décembre 1905 déclarant que « la République française assure la liberté de conscience » et « ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte ». C’est la fin du régime concordaire mis en place par ... Bonaparte.
L’agitation atteindra son apogée avec la mise en œuvre des inventaires en application de la loi de Séparation. Dès février 1906, et surtout dans la première quinzaine de mars, les fidèles assemblés manifestent leur volonté de ne pas céder à la force légale. Leur volonté de résistance est enflammée par un ordre de la Direction générale de l’Enregistrement à ses agents, du 2 janvier 1906, les enjoignant de demander aux prêtres d’ouvrir les tabernacles. Ce document, rendu public dix jours plus tard, est vu par toute la presse catholique comme une incitation à la profanation. L’on sait aujourd’hui qu’il a probablement été le fait d’un provocateur.
Le 11 février 1905, après un long silence, le pape rend publique l’encyclique Vehementer Nos qui condamne la Séparation comme « profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu qu’elle renie officiellement en posant le principe que la République ne reconnaît aucun culte ». La « véhémence » du propos encourage des réactions énergiques, le catholicisme ultramontain s’en saisit, et c’est alors les efforts du clergé français qui évitent une véritable guerre civile.
La chute du « Bloc des gauches », en 1907, et l’incroyable férocité de la répression des viticulteurs du Midi par Clemenceau mettront la question religieuse au second plan.
Toutefois, le mal est fait. Une partie active des catholiques rallie les monarchistes de l’Action Française, de Charles Maurras, athée pour qui l’Eglise et le catholicisme ne font que répondre au besoin d’une « religion d’Etat ». Et lorsque Marc Sangnier tente, avec le Sillon de lancer un mouvement catholique audacieux, dans la perspective de Rerum Novarum, il sera condamné le 25 août 1910 par Pie X, sous la pression de deux intégristes français liés à l’Action Française, l’évêque de Nancy, Mgr Turinaz, et l’abbé Barbier. Toute une partie des milieux catholiques actifs s’intègre dans les réseaux anti-républicains de La Sapinière.
La « matrice » des années 1890 aura eu un effet terrible et durable sur la France, avivant toutes les vieilles plaies et empêchant le grand dessein de Léon XIII de porter ses fruits.

Jules Méline.
|
| Jules Méline |
Revenons maintenant au ministère Méline. D’une durée exceptionnelle pour l’époque - près de 26 mois - il est habituellement dépeint comme celui du « plus petit commun dénominateur ». Certes, on lui reconnaît l’ambition d’avoir voulu « la défense du travail national », mais c’est immédiatement pour ajouter que le tarif protecteur instauré par Méline constitua « une rente de situation pour les industriels et les agrariens français ».
Et si c’était faux ? Ne serions-nous pas en train de répéter, en traitant Méline avec commisération, toute l’argumentation des libre-échangistes du parti financier ? Outre sa volonté d’apaisement et l’attitude personnelle d’Hanotaux, le ministère Méline n’aurait-il pas été - potentiellement - un bien plus grand danger pour l’Angleterre qu’on a voulu le dire ? Pour comprendre tout l’enjeu, il faut se reporter à l’époque : en 1896, les jeux ne sont pas encore faits, le capital français n’est pas encore inéluctablement orienté vers la rente et les investissements à l’étranger. Une grande mobilisation industrielle et agricole est encore possible, qui aurait orienté la France vers des productions de paix et un système de développement mutuel sur le continent européen. Les chemins de fer de Gabriel Hanotaux, au lieu de devenir moyens d’amener rapidement les troupes vers les fronts à venir, auraient pu être vecteurs de croissance jusqu’au cœur de l’Europe.
Regardons de plus près qui était Jules Méline. Cet homme, si souvent moqué comme le représentant d’une agriculture de petits propriétaires rétrogrades, était président de la Commission des douanes à l’Assemblée Nationale, et, président de l’Association de ... l’Industrie française. A lire ses discours, l’on voit apparaître un homme très au fait des problèmes de l’industrie, et en particulier de la concurrence étrangère - notamment britannique. Examinons, par exemple, le discours qu’il prononça le 19 mai 1893 au palais des Consuls à Rouen. C’est un plaidoyer vigoureux et documenté contre le libéralisme et le libre-échange !
Jules Méline explique comment le tarif général de 1881 et les tarifs conventionnels de 1882, qui ont introduit presque partout des modérations de droits, ont menacé de ruiner l’industrie et l’agriculture française. « C’est une nouvelle édition, explique-t-il, des traités de 1860 » - les traités de libre-échange avec l’Angleterre. « Les industries sacrifiées par les traités ont continué à végéter misérablement » constate-t-il.
Il montre ensuite comment, au nom de la production nationale, lui-même et ses amis industriels et agrariens viennent de réussir « à arrêter la marche toujours ascendante du libre-échange ».
En effet, pour « sauver l’agriculture nationale d’un désastre irréparable », ils ont fait passer d’abord une loi protectrice sur l’industrie sucrière, puis en 1884 le relèvement des droits sur le bétail et en 1885 celui du droit sur le blé.
En 1892 ils sont parvenus à mettre en place un nouveau « tarif de sauvegarde » qui a fait pour l’agriculture et l’industrie la même chose que « précédemment vis-à-vis du sucre, du blé et du bétail ».
Le tarif de 1892 opère en effet « une majoration d’environ 25 à 30% du tarif minimum sur les tarifs conventionnels antérieurs ».
Et qui résiste, tentant d’imposer le maintien du tarif libre-changiste de 1881 ? Léon Say et Raynal - les deux hommes de la haute banque, l’un servant quasi-officiellement les intérêts des Rothschild, l’autre ceux des compagnies de chemin de fer, l’homme qui organisa en 1882 la chute de Gambetta !
A Rouen, Jules Méline dénonce virulemment « l’état-major du libre-échange qui est à Paris. Il se compose des gros bonnets de la finance, des grands importateurs et des spéculateurs qui opèrent sur les produits étrangers. » Pour un homme habituellement décrit comme « opportuniste », « modéré », « médiocrement compétent », les attaques qu’il mène contre « les chefs du libre-échange » et « les maîtres du marché financier » sont extrêmement révélatrices.
Le Jules Méline de 1881-1898, c’est l’anti-Rouvier, l’anti-Etienne, l’anti-Raynal, le défenseur de l’économie nationale.
S’il avait pu consolider son pouvoir, la force qu’il aurait constituée aurait touché aux vraies questions, en profondeur, et ne se serait pas égarée dans les conflits qu’il jugeait lui-même « affaiblissants » de l’anticléricalisme, du monarchisme, du militarisme ou du colonialisme. Il aurait pu définir un grand dessein pour la nation balayant tous ces conflits secondaires. Exagère-t-on, pris par le goût de la contradiction ? Ecoutons encore le Méline de 1893 :
« Les maîtres du marché financier, les libre-échangistes (...) se sont emparés de la grande presse pour opérer sur l’opinion publique (...) C’est leur force (...) Notre association de l’Industrie française se trouve en revanche dans un état misérable. » Il propose alors de créer un grand organe quotidien, politique et économique, capable de défendre « l’économie nationale », une « République de travail et de progrès ».
Ses paroles nous rappellent quelque chose. Un examen plus attentif confirme alors notre intuition : Méline et le parti industriel qui l’entoure ont bel et bien repris les idées du grand économiste allemand Friedrich List. Leur inspirateur est un professeur d’économie politique, Paul Cauwès, dont le souvenir a été effacé. Cauwès est président de la Société d’Economie politique nationale dont Jules Méline est le président d’honneur.
Loin d’être des esprits arriérés, « agrariens » - comme disent péjorativement les financiers de la City - il s’agit des hommes de l’époque pensant et voyant le plus loin, à qui la France doit en grande partie son essor - relatif - du début du XXème siècle. Ils sont aussi les pires ennemis du libéralisme britannique, et sans doute parmi ceux qui le comprennent le mieux en Europe.
L’œuvre de Paul Cauwès, son Cours d’Economie politique, ses notes dans la Revue d’Economie politique, en portent le témoignage. En reprenant ce qu’il défend avec passion, nous parlons pour aujourd’hui, alors que la politique de Pierre Bérégovoy, de libre-échange et de dérégulation financière, a non seulement produit tous ses ravages, mais continue à se prétendre la seule possible.
Dans sa note publiée par la Revue d’Economie politique du 12 janvier 1898 - au moment du ministère Méline - Cauwès situe brillamment les idées de List dans le contexte européen et français.
Il attaque d’emblée le « doctrinarisme » qui nous vient d’Angleterre pour qui « l’économie politique est une science des choses et non de l’homme ». Cette « école libérale », continue-t-il, a commis l’erreur « d’appliquer le raisonnement purement logique à la science de l’économie ». Il voit son origine dans les œuvres de Quesnay et d’Adam Smith, avec une tonalité optimiste au départ, lorsque la rente foncière ou financière est bonne. Puis, nécessairement, cette manière de penser devient « pessimiste » car elle ne prend pas en compte la création de biens, la vie, mais le revenu sur des choses déjà existantes, qui nécessairement diminue avec le temps. Cauwès, avec un sens très clair de l’histoire, voit deux écoles « pessimistes » naître de la matrice initiale. L’une plus proprement libérale et financière, celle de Ricardo et de Malthus, conduisant directement au « malthusianisme contemporain » (de la fin du XIXème siècle, Ndlr). L’autre part également de l’analyse de Ricardo et de Smith et aboutit à un combat pour la possession des choses, qui détruit la solidarité entre producteurs ; c’est « l’école de Proudhon, de Lassalle et de Marx ».
| Friedrich List a inspiré Paul Cauwès |
A ces deux écoles apparemment opposées, mais en fait rameaux d’une même branche, il oppose au XIXème siècle les efforts de « Carey et de List ». C’est le « principe d’union et de solidarité des forces productives », et « en même temps celui que les gouvernements ont la mission de les protéger contre tout péril du dedans ou du dehors ». Cauwès souligne que cette « école de l’économie nationale » a pour nom « mercantilisme, tenu aujourd’hui en si médiocre estime », bien qu’il soit « à la source de l’existence de nos industries et de notre agriculture ».
Dans un siècle où Jean-Baptiste Say a tellement vulgarisé le libre-échangisme et le libéralisme en France qu’il en a fait « la seule doctrine possible » - comme c’est le cas aujourd’hui pour « l’économie de marché » - Cauwès montre que notre tradition, la vraie, se situe à l’opposé, précédant et alimentant l’œuvre de Friedrich List : « l’économie politique nationale est, en effet, la reprise d’une tradition bien française. La France est le pays de Sully et de Laffemas, de Henry IV, de Richelieu et de Colbert. » Il cite ensuite Galiani et l’enquête d’Antoine de Montchrestien sur les diverses branches de la production, soulignant que cette démarche prend appui sur deux notions :
- « l’unité économique nationale », la perception de la nation comme une entreprise productive unique ;
- et la « nécessité de l’intervention de la puissance publique dans l’intérêt de la production du pays ».
Car, pour Cauwès, « les initiatives libres et l’action gouvernementale ne sont pas antagonistes. Il restera un rôle toujours assez large à l’Etat, celui d’arbitre et de modérateur entre les intérêts opposés, celui de protecteur de nos industries contre les concurrences inégales, de centralisateur des informations économiques, de créateur d’organes complémentaires propres à stimuler et à soutenir les courages entreprenants. »
C’est cette conception qui est fondamentale - celle d’un Etat « défenseur du travail national » et qui doit « maintenir les travailleurs dans un état continuel d’entraînement » - car elle s’oppose totalement à la thèse libérale, cette « école libérale qui a semé chez nous l’idée que l’Etat est un mal nécessaire. »
Le débat était particulièrement vif à l’époque, rappelons-le, sur la question des chemins de fer. Raynal, Rouvier et Say les livrèrent aux compagnies, les concevant comme un « service » ponctuel, comme le transport tarifé de marchandises et de passagers d’un lieu à un autre lieu, revenant « naturellement » à des intérêts financiers.
Cauwès va au fond du débat, même si pour cela il doit contredire Carey, à qui pourtant il reconnaît « le titre de meilleur économiste du travail ». Pour lui, « l’industrie des transports » n’est pas un « service », mais bel et bien une « industrie productive », car « la production consiste dans toute action dont l’effet est de mouvoir la matière ». Il assimile en cela le transport aux industries extractives, qui vont chercher le minerai au sein de la terre, et le « transportent » vers l’usine.
Aussi, pour lui, les transports ne doivent pas être abandonnés à la finance qui ne peut en comprendre la « rentabilité » à long terme, l’impact infrastructurel. Dans une chronique de novembre décembre 1895, Cauwès précise que « la nationalisation d’une branche déterminée d’industries » peut devenir nécessaire à condition que « se trouvent en elle les caractères d’un service d’intérêt collectif ». Lorsqu’il y a menace de contrôle financier, l’Etat doit donc intervenir pour assurer la priorité industrielle, diffusant ses effets dans toute l’économie. Nous retrouvons ici les raisons de fond qui justifièrent l’attitude de Gambetta en 1882. Sa chute consacra donc bien le règne du « parti affairiste » lié au capital bancaire et à la coopération avec la City de Londres.
Cauwès conclut en proclamant son opposition absolue à « l’école de Smith » : « l’économie nationale a d’autres perspectives et d’autres prévisions que le programme d’acheter au meilleur marché et vendre le plus cher possible ».
Dans son Cours d’Economie politique, imprimé en 1893, il définit l’objet de son étude comme « la science ménagère des particuliers et des Etats » - la notion de Volkswirtschaft que l’on retrouve chez List. Le but de cette science est de réaliser « la puissance productive du travail » qui « n’est pas la conséquence des qualités inhérentes aux choses » mais « varie non seulement d’après l’état de l’art industriel, l’avancement des procédés mécaniques, mais aussi d’après l’énergie individuelle, les mœurs de famille, les traditions nationales, enfin d’après les combinaisons sociales - division du travail, association - tout ce qui peut resserrer ou renforcer les rapports industriels. »
C’est du point de vue de cette notion active, qui n’identifie pas l’économie à une « science des choses », à une logique morte, mais à une science de la production des choses, de la « création humaine », que Cauwès attaque H. Spencer, Huxley et Bagehot, « les chefs de cette nouvelle école en Angleterre dont les précurseurs furent Cabanis et Gall ». Il montre que la théorie de Spencer - l’idéologue du « darwinisme social » victorien - se ramène à une « sociologie biologique », à un pur « déterminisme social » qui « ne fait aucune part au libre-arbitre ». « Une théorie moderne, dit-il, qui se rattache d’un côté à la doctrine utilitaire de Bentham et de J. Stuart Mill, de l’autre à la thèse darwinienne de l’évolution, assimile la science sociale à la biologie, ce serait une simple science naturelle régie par les lois de la matière ». Il constate alors simplement que cette école britannique en vient, quoi qu’elle en dise, à assimiler le comportement humain à celui des animaux.
Cette critique - lorsqu’on pense aux ravages faits aujourd’hui par la sociobiologie de Wilson et le néo-malthusianisme social américain - est d’une absolue actualité.
Cauwès montre la mauvaise foi des malthusiens suivant leurs propres termes : « La doctrine absolue du libre-échange se rencontre chez les mêmes économistes que la théorie de la population de Malthus, si étroitement nationale… Pour les échanges, les limites territoriales des Etats ne comptent pas, tandis que pour les moyens de subsistance, l’on doit trembler devant la menace de l’over-population ».

Jean-Baptiste Colbert.
|
| Jean-Baptiste Colbert |
Finalement, analysant l’antinatalisme systématique de Stuart Mill, il va droit au but, dévoilant tout le fondement du système britannique : « Pénaliser la croissance de la population ... est une opinion excentrique, si l’on admet que la population n’est plus réglée par les volontés libres, il n’y a logiquement qu’une seule institution qui puisse en contenir ou en activer le mouvement, c’est l’esclavage ! » (Tome II, page 63 de son Cours d’Economie politique, 1893, Larose et Forcel, éditeurs).
A l’opposé de ces conceptions « fixistes », esclavage entre êtres humains ou entre pays, Cauwès élabore sa conception auto-développante des nations :
« Les nations sont en continuel travail de transformation, de développement, il est donc inexact de les supposer passives et immobiles (…)
« Les nations normales (au sens dans lequel List emploie cette expression) sont des organisations complètes, leur système économique ressemble à la physiologie des êtres animés les plus parfaits, les parties multiples qui les constituent, ainsi les cultures, les fabriques et le commerce, sont intimement associées et soumises à une loi de croissance intérieure (inters susception) : comme les organes d’un même corps, elles languissent ou se fortifient en même temps ».
Le but du dirigeant est de « développer d’une manière harmonique les forces productives » et « de garantir l’indépendance nationale » en « augmentant les emplois productifs au profit du travail national ». Il y a donc un travail généralisé à organiser, une « grande fabrication nationale » qui n’est jamais réalisée à un moment donné, mais qui est « création continue » ; et « elle ne peut naître sans protection ».
Nous en venons donc maintenant à la nécessité et à la justification du protectionnisme tellement attaqué par les libéraux, qui prétendent n’y voir que la « sauvegarde malsaine d’intérêts », le désir de maintenir des entreprises « artificiellement », « sans concurrence ». Cauwès leur retourne l’argument en partant de l’essentiel c’est-à-dire de la nécessité de produire, de la nécessité économique et morale de ne pas laisser une population sans emploi : « sans doute, les nations doivent s’enrichir par le commerce réciproque, mais avant tout elles ont à vivre et à progresser, or, dans ce but, il faut arriver au moyen de développer les forces productives dont la nature les a douées. La vraie question est donc de déterminer quel est le régime d’échange le plus favorable à la croissance industrielle des sociétés. » Or la « liberté commerciale » risque de « dépeupler les pays dont les industries ne sont pas en état de soutenir la concurrence parce qu’ils deviennent tributaires de l’étranger ». Alors, inéluctablement, « le libre-échange aboutit à la ruine des concurrents » moins forts ou trop neufs, « donc au monopole ».
Les libre-échangistes, sous leurs théories « généreuses » et leur version fallacieuse de la liberté, ne sont donc que des hypocrites désireux de « tenir les marchés ».
Cauwès n’est cependant pas un partisan absolu de la protection opposé aux absolutistes du libre-échange ; il conçoit la « protection » comme un moyen nécessaire et non une fin ; la fin est le développement des forces productives, l’essor du travail. « La protection des industries nationales, souligne-t-il, ainsi comprise, n’est pas le plus souvent perpétuelle, c’est un régime de transition propre à favoriser l’éducation industrielle, c’est une tutelle qui doit cesser naturellement à l’âge du plein développement économique… »
Cauwès dénonce enfin, du point de vue qu’il a défini, la voie dans laquelle s’engage l’économie française à la fin du XIXème siècle : « un dernier mot, dit-il, sur l’illusion qu’il y aurait à vendre l’enrichissement en capitaux pour l’équivalent d’un accroissement de puissance ».
Il est erroné, insiste-t-il, de juger l’influence du commerce sur la richesse nationale au seul point de vue de la valeur en échange et de l’accumulation des capitaux. « Les nations ont d’autres visées que de faire fortune par la voie la plus directe ; or, un accroissement de richesse serait peu de choses s’il devait être acquis au détriment du développement progressif de la puissance industrielle. »
Rappelons que la France, grand investisseur dans le monde entier en 1914, pays dominé par la « rente » et l’idéologie du rentier, pays dont entre 3,6% et 5,2% de la fortune privée s’était en 1908, transformé en « front russe », a vu sa part dans la production industrielle mondiale passer de 9% en 1880 à 6% en 1913...
Cauwès, en défendant « un système de tutelle et d’éducation industrielle progressive », définissait donc bien la voie juste, celle qui permet d’éviter les guerres - qui aurait dû être suivie par la France, et par l’Europe à la fin du XIXème siècle, et qui devrait être suivie aujourd’hui, à l’opposé du « néo-libéralisme » des Jeffrey-Sachs, des Allison ou de leurs semblables. Le drame est que les mêmes causes nous portent vers les mêmes effets...
L’importance de relire Cauwès, à la lumière des tendances profondes de l’économie et de la politique mondiale qui se sont malheureusement définies a la fin du XIXème siècle - dans le moule auparavant construit par la Sainte-Alliance - se trouve là dans la conscience qu’il donne qu’une perspective différente, opposée existait alors, comme elle existe aujourd’hui.
A relire l’histoire de cette époque, ce qui frappe peut-être le plus est l’étonnante suffisance, la fatuité satisfaite des politiques, des économistes, des juges et des « savants éminents », amplement démontrée dans l’affaire Dreyfus ou, à un autre niveau, dans l’affaire Deprat. C’est, dans ce contexte, la marche inéluctable à la guerre, voulue par des dirigeants prédateurs, dont l’aventure coloniale témoigne de l’aveuglement et de la férocité, et acceptée progressivement par des peuples manipulés, réduits à la haine, car les valeurs positives de nation, de République et de religion se trouvaient systématiquement avilies.
C’est surtout, dans l’ordre économique et culturel, l’immense ignorance de tous, portant sur les conceptions fondamentales de la science, de la morale et de la philosophie, et l’absence de compassion quasi-absolue des « élites » vis-à-vis des conditions de vie des populations : Clemenceau, supposé progressiste, faisant tirer sur les viticulteurs et les petits fonctionnaires du Languedoc, les travailleurs outragés de Chalon-sur-Saône, de Courrières ou de Fourmies sont autant de symboles.
C’est enfin la rupture totale qui est faite entre la politique intérieure, le « bourrage de crâne » du peuple par la grande presse et la politique radicale - dans lequel l’anticléricalisme joua un rôle fondamental - et la politique extérieure, livrée aux affairistes, aux banques et aux Delcassé.
Si, marqués par ces profondes impressions et conscients du sang par lequel tant d’aveuglement et de médiocrité allaient être finalement payés, nous portons maintenant nos regards sur notre époque, une angoisse légitime nous saisit.
De Croatie, de Bosnie-Herzégovine et de Serbie monte une rumeur terrible et familière. L’on dira que les moyens de destruction accumulés sont trop grands, que deux guerres mondiales ont appris aux peuples et aux dirigeants à être moins aveugles, que la prédation est limitée par des règles, que les Empires sont morts et que l’on ne se baigne jamais deux fois dans les mêmes eaux. Outre que de semblables paroles, tout aussi rassurantes, s’entendaient déjà en 1913, nous ne pouvons qu’être frappés - au-delà des différences de forme - par les similarités de fond.
Le libéralisme britannique - sous les couleurs anglo-américaines et le nom « d’économie de marché » - triomphe une nouvelle fois dans le monde. Les Etats-Unis, comme la France, et bien pire que la France de 1914, ont laissé ruiner leur économie intérieure au profit d’aventures extérieures, et transformer leur économie en machine prédatrice, en machine à exclure, incapable de développer ou même de maintenir sa propre infrastructure nationale. « L’économie financière » domine le monde, du Japon au Portugal, et de l’Argentine à l’Australie. En France même, M. Bérégovoy a pratiqué une politique de dérégulation financière et de combinaisons affairistes qui le fait ressembler non à M. Pinay, mais à M. Rouvier. Et M. Balladur est son double.
Les valeurs de nation, de République, de morale et de religion se trouvent, une fois de plus, bafouées et une contre-culture s’impose, plus abêtissante encore que celle d’avant 1914, avec le naufrage des instituteurs et des corps enseignants non seulement en France, mais dans le monde, et avec le règne de la télévision. La guerre du Golfe nous a donné un avant-goût de ce que peut faire la machine lorsqu’elle se trouve en état de fonctionnement politique.
Bertillon et Broca examinaient hier les crânes, espérant y trouver une réponse à la vie, et Spencer, Haeckel ou Vacher de Lapouge répandaient leur « sociologie biologique » qui allait enfanter les monstres du siècle suivant. Aujourd’hui, nous avons aux Etats-Unis, en Angleterre, en Russie et ailleurs, des équipes de recherche qui examinent le cerveau avec le même désir dérisoire de manipulation et de domination que les Broca ou les Bertillon, mais avec des moyens techniques autrement plus développés. La sociobiologie devient sociogénétique, et l’homme se met, une fois de plus, à jouer à Dieu.
Le malthusianisme l’emporte, avec les mêmes perspectives raciales qu’à l’époque.
Les intérêts financiers tentent, comme alors, d’imposer leur monopole par l’abaissement des tarifs, cette fois au sein du GATT.
Un système mondial d’usure financière, lié à la gestion des dettes et à la concentration du capital de l’assurance et de la banque est lui aussi dominant.
Dans la science elle-même apparaît, après un matérialisme borné, un courant néo-spiritualiste semblable à celui de la fin du XIXème siècle, qui coupe la réflexion et la recherche fondamentale de ses réalisations technologiques et industrielles pour l’avantage du plus grand nombre.
Les « élites » politiques, aujourd’hui comme à la fin du XIXème siècle, ont perdu tout sens de compassion pour les humiliés et les offensés du monde. Le « charity-business » aura été la flèche du Parthe, précédant l’abandon.
Alors, il reste Cauwès, il reste Colbert, il reste - plus profondément - Leibniz, il reste la chance immense d’un plan de développement de l’« hinterland » est-européen, le plan que nous défendons, celui du Triangle européen Paris-Berlin-Vienne.
Hier, le capitaine Marchand ne reçut pas les moyens de réaliser la liaison Dakar-Djibouti, qui aurait coupé la ligne anglaise du Cap au Caire.
Aujourd’hui, nous avons l’instrument stratégique qui permet de couper la ligne anglo-américaine de New York à Londres et à Moscou. Ce sont nos transports ferroviaires rapides, notre technologie moderne, permettant d’unir Lisbonne à Vladivostok, et d’abord Paris à Varsovie, coupant les lignes anglo-américaines.
Chassons pour incompétence les Sachs, les Allison et leurs semblables.
De nouveaux Marchand sont prêts à partir ; de leur succès, tout le siècle à venir dépend.
Contre la Sainte-Alliance, contre un monde défini par le monopole financier, Cauwès déjà s’exclamait : « unis dans une même idée, dans une commune aspiration, notre devise sera : par la science, pour la patrie ».
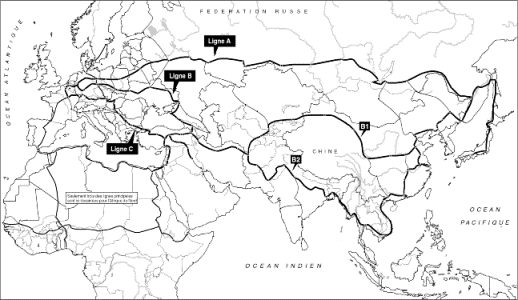
Vers un un XXIe siècle de développement mutuel ?
|
| Vers un un XXIe siècle de développement mutuel ? |



