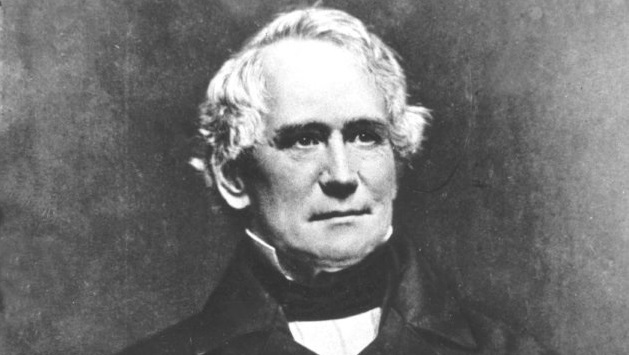
Principal conseiller économique du président Abraham Lincoln, partisan du système américain d’économie politique contre le système anglais du « laissez-faire », Carey réfute ici l’assertion de David Ricardo selon laquelle la qualité des terres diminuerait avec l’accroissement démographique.
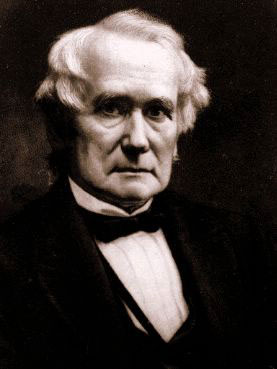
Les premiers colons américains d’origine anglaise s’établirent sur le sol désertique du Massachusetts, fondant ainsi la colonie de Plymouth. Le continent s’étendait devant eux, mais ils ne pouvaient prendre que ce que leurs maigres moyens leur permettaient d’entretenir. D’autres colonies furent formées à Newport et à New Haven, et peuvent ainsi être retracées en suivant le cours des rivières, mais en prenant les terres les plus élevées et en laissant le défrichage et le drainage des marais à leurs successeurs. Les sols les plus productifs de la Nouvelle Angleterre sont ceux qui furent récupérés au cours du dernier demi-siècle.
Dans l’état de New York le processus a été le même. Les sols improductifs de l’île de Manhattan, et les terres plus élevées sur la rive opposée, attirèrent très vite l’attention alors que les terres plus riches, et plus accessibles, restaient encore incultivées. Il y a des traces de colons le long de l’Hudson jusqu’à la vallée de la Mohawk, où ils s’établirent près de la source des cours d’eau, là où il fallait peu de débroussaillage ou de drainage. Geneva, et d’autres villes et villages maintenant situés sur les riches terres de l’Etat, n’existaient presque pas il y a soixante ans, alors que les terres bordant la Pennsylvanie étaient déjà colonisées depuis bien longtemps, celles de Coshocton Creek ayant été décrites de très grande valeur en raison de l’« absence de tout désordre périodique, en particulier la fièvre et la pestilence. »
Dans le New Jersey, nous voyons les Quakers occuper de hautes terres en amont des rivières, ou sélectionner des sols légers le long du Delaware où croissent les pins, évitant ainsi les sols les plus lourds situés sur la rive opposée, en Pennsylvanie, et négligeant de riches terres qui demeurent aujourd’hui couvertes d’essences les plus nobles. Passant par les districts sablonneux de l’Etat nous trouvons des centaines de petits lots défrichés, mais depuis longtemps abandonnés, attestant du caractère de la terre cultivée lorsque la population était peu nombreuse et la terre très abondante.
Sur les sols sablonneux du Delaware, les Suédois fondèrent Lewistown et Christiana ; et dans les villages maintenant décadents d’Elkton et Charlestown, dans le fond de la Chesapeake Bay, nous trouvons l’évidence de la pauvreté des terres occupées au début de la colonie, tandis que les belles prairies, aujourd’hui les plus riches fermes de l’Etat, ne valaient absolument rien. [...]
Les premiers colons de l’Ouest choisirent tous les hautes terres, évitant les vallées des rivières et des fleuves en raison de la fièvre qui même aujourd’hui balaie tant d’émigrants. Cherchant un endroit sec pour s’établir, le colon choisissait toujours les crêtes, lui offrant la possibilité de faire facilement et rapidement de petites récoltes ; la même raison qui l’empêcha de tenter de drainer les alentours de sa maison lui interdisait instamment de dégager la terre requise pour la culture. [...]

Arrivé au confluent de l’Ohio et du Mississipi, nous ne trouvons que le pauvre bûcheron, qui risque sa santé en fournissant le bois pour les multiples bateaux à vapeur qui passent par là. Sur des centaines de miles, nous traversons des terres fertiles couvertes des essences les plus nobles, des terres qui jusqu’à maintenant ne sont d’aucune valeur pour la culture, parce que l’air environnant est plein de gaz qui sont dommageables à la santé et à la vie.
Descendant un peu plus bas, nous rencontrons la civilisation et la richesse qui remontent le Mississipi, depuis les rives du Golfe du Mexique. Des digues ou des levées gardent le fleuve à distance, et les plus belles plantations sont vues sur les terres correspondantes, avec les régions non cultivées laissées derrière elles, alors que les habitations des premiers colons se trouvent en haut des collines. [...]
Les faits sont partout les mêmes : pour la même raison, le colon se construit une maison à partir de troncs d’arbre jusqu’à ce qu’il puisse en avoir une en pierre, il commence à cultiver là où il peut obtenir une modeste récolte. Toute colonie établie sur des terres riches a, soit été un échec, ou a progressé de manière très lente. Nous voyons cela dans les échecs répétés des colonies françaises en Louisiane ou à Cayenne, comparé à la croissance régulière de celles situées dans la région du Saint-Laurent ; et dans le lent progrès des colonies implantées sur les riches terres de Virginie et de Caroline, comparé à la croissance rapide de celles installées sur les sols stériles de Nouvelle Angleterre. Les premières ne peuvent combler l’homme qui travaille pour lui-même, et nous trouvons par conséquent les colonies plus riches en train d’acheter des noirs et de les forcer à travailler pour elles, pendant que le cultivateur libre cherche les terres légères et sablonneuses de Caroline du Nord. Aucun homme, laissé à lui-même, ne commencera à cultiver les terres riches, parce que ce sont elles qui offrent le rendement le moins généreux ; et c’est sur ces terres que les conditions du travail sont les pires, lorsque le labeur est entrepris avant toute association entre l’accroissement de la richesse et de la population. Le colon des hautes terres obtenait, au moins, de la nourriture ; s’il avait tenté de drainer les riches sols du marais Dismal il serait mort de faim, comme ceux qui ont cherché à occuper l’île fertile de Roanoke.

Passant maintenant au Mexique, nous trouvons une illustration supplémentaire de l’universalité de cette loi de l’occupation de la terre. Près de l’embouchure du fleuve, mais à quelque distance de ses rives, il y a Matamoros, une ville récente. Montant plus loin, à travers les riches terres toujours inoccupées, le voyageur arrive à l’embouchure de la San Juan, en amont de laquelle il trouve un pays assez peuplé, ayant pour capitale Monterrey. Plus au nord, sur les hauts plateaux de Chihuahua, il trouve des terres cultivées loin des rives des rivières ; plus à l’ouest, à partir de Monterrey, après Saltillo, la route est située sur des plaines sablonneuses encore inoccupées. Arrivé à Potosi, il se trouve dans un pays dans lequel le dérèglement des périodes de pluie est suivi de la famine et de la mort ; pourtant, plus bas sur la côte, il existe un territoire magnifique, arrosé de nombreuses rivières, où le coton et l’indigo croissent spontanément, et qui pourrait approvisionner en sucre le monde entier ; mais il n’existe en cet endroit aucun signe de population. La terre n’est pas défrichée, et ceux qui entreprendraient une telle tâche, avec les moyens actuels, mourraient probablement de famine ou bien périraient à cause des fièvres qui y dominent. [...]
La vallée de Mexico, à l’époque de Cortes, abritait quarante villes ; mais la population déclina, et le reste des habitants s’est retiré sur les hautes terres des environs, pour cultiver les sols plus pauvres à partir desquels la cité qui reste encore comble ses besoins en nourriture. La terre fertile y est très abondante, mais les gens la fuient ; tandis que, selon M. Ricardo, elle aurait du être réclamée la première. [...]
[Au] Brésil, arrosé par les fleuves les plus importants du monde, on peut récolter avec une abondance indescriptible tous les produits des régions tropicales, avec les métaux précieux situés tous près de la surface ; mais il n’y a que des étendues sauvages. Comme il n’existe aucun plateau élevé, il n’y a aucun endroit propre à la colonisation européenne. Sur les pentes raides du Chili, on trouve au contraire un peuple en train d’avancer en termes de population et de richesse, la vallée fertile de la Plata restant quant à elle plongée dans le barbarisme.
De l’autre côté de l’océan, en atterrissant dans le Sud de l’Angleterre, le voyageur se retrouve dans un pays où les cours d’eau sont courts et les vallées limitées, elles sont, par conséquent, propres à une culture précoce. Là, César y trouva le seul peuple de l’île qui avait progressé dans l’art du labourage, les tribus situées plus à l’intérieur des terres vivant des produits de la chasse ou du lait de leurs troupeaux. Dans le Cornwall aride, il trouve des marques d’agriculture très anciennes, d’origine inconnue ; et dans une partie aujourd’hui très peu visitée il trouve les ruines de Tintagel, le château du roi Arthur. Il trouve les fondements d’une agriculture très ancienne dans des régions décadentes, ou dans ces parties du royaume où des hommes ne sachant ni lire ni écrire vivent dans des maisons construites à partir de terre séchée, et qui ne gagnent que six ou huit schillings par semaine en échange de leur labeur. Il y voit le palais des rois normands à Winchester, et non dans la vallée de la Tamise ; alors que dans le South Lancashire, avec ses riches champs de blé, il trouve un pays où les morasses faillirent engloutir l’armée du Normand conquérant, à son retour de ses tournées dévastatrices dans le Nord ; et qui découragèrent l’historien Camden aussi tard qu’à l’époque de Jacques Ier. Cherchant les terres les plus récemment cultivées, il va être conduit vers les marécages de Lincoln et du Cambridgeshire, produisant aujourd’hui les plus belles récoltes d’Angleterre ; mais qui n’avaient aucune valeur monétaire avant que l’engin à vapeur ne vienne assister l’agriculteur dans son travail. [...]
En France, à l’époque de César, nous trouvons les tribus les plus puissantes sur le flanc des Alpes, et les carrefours d’échange dans les riches villes de Bibracte, Vienne et Noviodnum ; la Belgica, aujourd’hui si fertile, ne contenant au contraire qu’un seul lieu digne d’être mentionné, au passage de la Somme, là où se trouve aujourd’hui Amiens. Pour ce qui est des Alpes, les Helvètes habitaient une douzaine de villes et presque quatre cents villages. Cherchant les villes de l’époque de Philippe Auguste : Chalons, Saint-Quentin, Soisson, Reims, Troyes, Nancy, Orléans, Bourges, Dijon, Vienne, Nîmes, Toulouse ou Cahors, cette dernière étant alors le centre des opérations bancaires de toute la France, nous les trouvons loin en amont des cours d’eau sur lesquelles elles sont situées, ou sur les plateaux entre les rivières. Les centres du pouvoir se trouvèrent par la suite dans la Bretagne sauvage, où les loups étaient encore nombreux ; à Dijon, sur le flanc des Alpes ; en Auvergne, récemment devenue un « asile secret et sûr pour les criminels » ; dans le Limousin, qui donna à l’Eglise tant de papes que les cardinaux du Limousin dictaient les procédures du conclave ; ou sur les pentes des Cévennes, où la littérature et les arts fleurirent, tandis que les sols plus riches, dont de larges parts ne sont pas encore drainées, étaient entièrement gâchés.
En Belgique nous trouvons les pauvres Luxembourg et Limbourg, qui étaient cultivés depuis les temps les plus reculés ; la fertile Flandre restant jusqu’au XVIIe siècle un désert impénétrable. Même jusqu’au XIIIe siècle, les forêts de Soignies couvraient le site de Bruxelles, et le Brabant fertile n’était presque pas cultivé. [...]
En Hollande, nous voyons un peuple misérable, vivant sur des îles de sable et subsistant principalement grâce à la pêche, et dont la pauvreté l’exemptait même des lourdes taxes habituellement exigées par Rome. Peu à peu, les Hollandais arrivèrent à accroître leur nombre et leur richesse. La plus importante d’entre les provinces était l’étroite et aride Hauptland, qui donna son nom à l’entière région. Incapables d’obtenir de la nourriture par l’agriculture, les Hollandais s’orientèrent vers les manufactures et le commerce ; mais avec la croissance de leur nombre et de leur richesse, ils acquirent la capacité de défricher les terres et de drainer les marécages, et nous les voyons devenir la nation la plus riche d’Europe.
Plus au nord, nous trouvons un peuple dont les ancêtres, émigrant des environs de la Don à travers les plaines de l’Allemagne du Nord, choisirent les montagnes dénudées de Scandinavie comme terre correspondant le mieux à leur condition. Partout à travers ce pays, des marques de culture du sol très anciennes surgissent de terres élevées et pauvres qui ont été abandonnées il y a déjà longtemps. Qu’il en soit ainsi est confirmé par la croyance que cette région a du être le berceau à partir duquel les hordes du nord allaient se lancer à la conquête de toute l’Europe du Sud. Les faits ne sont toutefois qu’une répétition de ceux décrits dans le cas de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Angleterre, de l’Ecosse, de la France et la Belgique, et qui se répètent de nouveau en Russie, où un voyageur anglais dit à ses lecteurs, « nous voyons les sols les plus pauvres consacrés à l’agriculture, tandis que les plus riches autour demeurent négligés. » [...]
En Italie, une population nombreuse occupait les hautes terres de la Gaulle cisalpine alors que les riches sols de Vénétie restaient inoccupés. Plus au sud, le long du flanc des Apennins, nous trouvons une population qui s’accroît graduellement et des villages dont l’âge peut être presque déduit par leur situation géographique. Les collines Samnites étaient peuplées, l’Etrurie occupée, et Veii et Alba construites avant que Romulus ne rassemble ses aventuriers sur les rives du Tibre. [...]
En Grèce, nous rencontrons les mêmes faits universels. Sur les collines de l’Arcadie, il y avait des colonies qui précédaient de loin celles des terres de l’Elis, arrosées par l’Alphée ; et les maigres sols de l’Attique étaient occupés depuis longtemps, tandis que la riche Béotie suivait loin derrière. Sur les sommets des collines, dans plusieurs régions, les sites de cités désertées présentaient à l’époque de la Grèce historique, des signes d’occupation très ancienne. Sur les courtes pentes de l’Argols oriental, abandonné depuis bien longtemps, on trouve les ruines du palais d’Agamemnon ; et au nord du Golfe de Corinthe, nous voyons les Phocéens, Locréens et Etoliens rassemblés sur les terres hautes et pauvres, tandis que les riches plaines de Thessalie et de Thrace restaient dépourvues de population. [...]
Le long du Nord de l’Afrique, les parties les plus civilisées de la population sont regroupées sur les pentes de l’Atlas ; et plus au sud, la capitale de l’Abyssinie est trouvée à l’altitude de huit mille pieds au-dessus de la mer, alors que les terres de la plus grande fertilité n’étaient pas cultivées. [...]
Entrant en Inde depuis le Cap Comorin, et suivant l’enchaînement de hautes terres, nous trouvons les villes de Seringapatam, Poonah et Ahmedmugger ; tandis que nous trouvons, plus bas, près de la côte, les villes européennes plus récentes de Madras, Calcutta et Bombay.
L’Indus suit son cours sur des centaines de miles sans rencontrer ville ou village le long de ses rives ; les plus hautes contrées, à gauche et à droite, sont au contraire très peuplées. Le riche delta du Gange est inoccupé, et beaucoup plus haut en amont du fleuve nous rencontrons Delhi, la capitale de l’Inde lorsqu’elle était aux mains des souverains autochtones. Ici, comme partout, l’homme évite les sols riches requérant un drainage, et produit sa nourriture sur les terres plus élevées qui se drainent par elles-mêmes ; et ici, comme toujours lorsque seul le sol est cultivé, le rendement est modeste ; et nous trouvons par conséquent les Hindous travaillant pour une roupie ou deux par mois, qui ne suffisent qu’à leur donner une poignée de riz par jour, et qu’à acheter un morceau de coton leur permettant de cacher la nudité. Les sols les plus fertiles existent en quantité illimitée près de ceux que le cultivateur gratte avec un bâton à défaut d’une pelle, rassemblant sa récolte avec ses mains à défaut d’une faucille, et transportant jusqu’à chez lui son maigre butin sur ses épaules à défaut d’un cheval et d’un chariot.
Montant vers le nord, par Kaboul et l’Afghanistan, laissant sur la gauche la Perse, dont les sols secs et dénudés ont été cultivés depuis des siècles, nous trouvons au milieu de l’Himalaya des villages situés à flanc de montagne, où l’on obtient de maigres récoltes de millet, de maïs et de sarrasin. Ici nous trouvons le berceau de la race humaine, et pouvons par conséquent retracer le parcours des tribus successives cherchant des sols plus fertiles, s’arrêtant parfois pour cultiver ces terres montagneuses de manière à obtenir de petites quantités de nourriture ; et puis traversant la mer Egée pour se retrouver sur de petites îles pointues, cultivées depuis si longtemps. Certaines de ces tribus atteignent la Méditerranée, où l’on trouve puis perd la civilisation au gré des vagues successives d’émigration ; d’autres, allant plus à l’ouest, entrent en Italie, en France et en Espagne, pendant que d’autres encore atteignent les îles Britanniques. Après quelques siècles de repos, nous les voyons traverser l’Atlantique, escaladant les pentes de l’Alleghany, avant la montée et le passage de la grande chaîne divisant les eaux du Pacifique de celles de l’Atlantique.
Dans tous ces cas nous voyons les pionniers saisir les terres sèches et parsemées le long des flancs des montagnes puis, lorsque la population s’accroît, redescendre vers les riches terres du fond des vallées ; ou pénétrer vers les sols situés plus bas, combinant la couche supérieure d’argile ou de sable avec les marnes inférieures ou le limon et composant ainsi un sol capable de donner de larges rendements pour un travail donné. Partout, avec le pouvoir accru de l’union, l’homme arrive à exercer un pouvoir accru sur la terre. Partout, alors que de nouvelles terres sont mises en activité, nous trouvons un accroissement rapide de la population, produisant une tendance accrue à la combinaison de l’effort, grâce à laquelle les pouvoirs de l’homme sont souvent multipliés cinquante fois, lui permettant ainsi de mieux pourvoir à ses besoins immédiats, pendant que sont accumulées de nouvelles machines nécessaires à la mise en exploitation des vastes trésors de la nature. Partout, nous trouvons qu’avec l’accroissement de la population, l’approvisionnement en nourriture devient plus abondant et régulier, l’habillement et le logement sont obtenus avec plus de facilité, la famine et les maladies tendent à s’éloigner, la santé devient plus générale, la vie est prolongée et l’homme est plus heureux et plus libre.

Ainsi en est-il pour les besoins humains, à l’exception de celui, unique, de la nourriture ; tel est ce qui est communément admis. Nous voyons qu’avec la croissance de la population et la richesse, l’homme obtient l’eau, le fer, le charbon et les textiles, et l’usage de maisons, de bateaux, de routes en retour d’un moindre travail. Il ne fait aucun doute que les gigantesques travaux par lesquels les rivières sont amenées à traverser nos villes permettent à l’homme d’obtenir de l’eau à un coût moindre que lorsque chaque homme prenait un seau et se servait lui-même dans la rivière. Nous voyons que la mine, laquelle a demandé des années pour être creusée, fournit du combustible à un coût bien moindre que lorsque que le colon transportait chez lui des bouts de bois à moitié décomposés, à défaut d’une hache lui permettant de couper des bûches ; que le moulin fait le travail de milliers de bras humains ; et que la gigantesque manufacture fournit des vêtements pour bien moins cher que ne le faisait le métier mécanique ; mais on nie cela dans le cas de la nourriture. Pour ce qui concerne tout le reste, l’homme commence avec les pires machines et progresse vers le haut ; mais pour ce qui concerne la terre, et pour cela seulement, il commence, selon M. Ricardo, avec le meilleur pour ensuite régresser vers le pire ; et à chaque stade de ce processus on voit le rendement diminuer, amenant ainsi la menace de la famine et décourageant tout homme à avoir des enfants capables de l’aider dans son vieil âge, à moins que, comme en Inde ou dans les îles du Pacifique, ils ne décident de l’enterrer vivant ou de l’exposer sur les rives du fleuve, pour ensuite diviser entre eux ses maigres réserves de nourriture.
Jusqu’où cela peut-il être vrai, le lecteur pourra en juger par lui-même. Toutes les autres lois de la nature sont universellement vraies ; et il peut nous accorder qu’il n’y a qu’une seule loi pour la nourriture, la lumière, l’habillement et le combustible - que l’homme, dans tous les cas, commence avec des instruments modestes et va vers l’avant ; une fois renforcé par la croissance de la richesse et de la population, et par le pouvoir de l’association, il obtient avec un travail sans cesse diminuant, un approvisionnement croissant de tout ce qui lui est nécessaire, toute la convenance, le confort et les richesses de la vie.
Quand on permet à la population, à la richesse et au pouvoir de la combinaison qui en découle de s’accroître, on assiste à une tendance à l’abandon des terres plus pauvres cultivées au début, comme le prouve l’expérience de l’Angleterre, de l’Ecosse, de la Suède et de certains de nos Etats du Nord [des Etats-Unis]. Quand on décline, au contraire, ce sont les terres riches qui sont abandonnées, les hommes s’enfuyant vers les terres plus pauvres pour obtenir des moyens de subsistance. A chaque pas dans la première direction, il y a un accroissement dans la valeur de l’homme, comparé aux denrées nécessaires à son usage, accompagné d’une facilité croissante pour l’accumulation ; à chaque pas dans l’autre direction, il devient au contraire de plus en plus l’esclave de son prochain, avec un accroissement constant dans la valeur des denrées, comparé au déclin de sa propre valeur.
