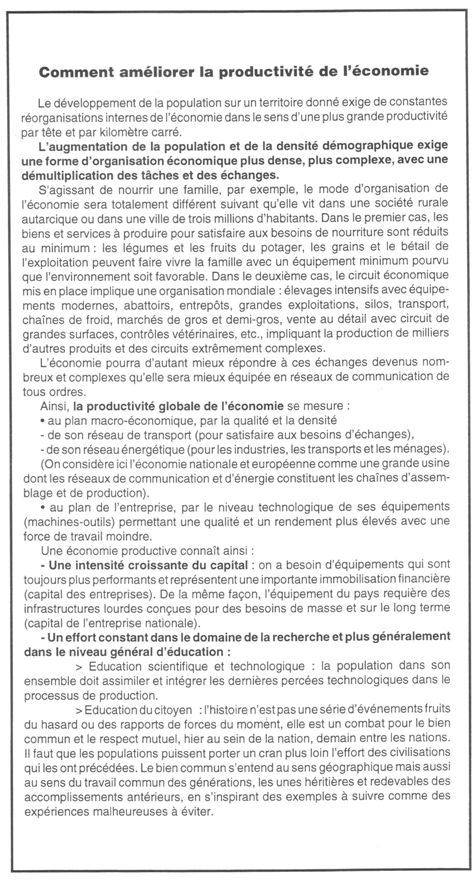[sommaire]
L’objectif de cette étude, réalisée en mai-juin 1997 par Jacques Cheminade et Christophe Lavernhe, consistait, après avoir recensé les maux du système économique de l’époque et montré leurs causes principales, de déterminer les moyens par lesquels les États peuvent retrouver la maîtrise des choix économiques en émettant la monnaie et le crédit nécessaires à des projets d’équipement. L’étude répond à une question fondamentale, toujours d’une actualité brulante : comment l’État peut-il se donner des instruments pour faire exister un « espace public » - ce qui n’est pas une question technique, mais implique bel et bien un choix de société.
I. Introduction
Nous voulons donc la mise en valeur en commun de tout ce que nous possédons sur cette terre et, pour y réussir, il n’y a pas d’autres moyens que ce que l’on appelle l’économie dirigée. Nous voulons que ce soit l’État qui conduise au profit de tous l’effort économique de la nation tout entière et faire en sorte que devienne meilleure la vie de chaque Français et de chaque Française.
Charles de Gaulle, le 1er octobre 1945, à Lille
Depuis la chute du système de Bretton Woods, en 1971, la « déréglementation » - l’abandon progressif des règles d’entente économique et des disciplines monétaires - a introduit, à l’échelle mondiale, une logique financière de profit à court terme qui s’est substituée à une logique à long terme d’investissement et de formation de l’emploi. Les États ont passé la main, pour ce qui concerne leurs politiques monétaires et industrielles, aux « forces du marché ». L’ordre financier et monétaire international ainsi transformé est dominé par la loi du plus fort et par des intérêts particuliers, l’intérêt collectif ne trouvant plus vraiment de défenseurs. Là est la cause fondamentale de la crise profonde que nous vivons : les moyens qui permettent d’assurer un avenir économique à la société, c’est-à-dire de l’équiper, ne sont plus mis en place.
L’appellation de « néolibéralisme » désigne improprement ce nouvel état des choses. Il s’agit en fait d’une dictature du profit financier à court terme sans création de richesses physiques. L’attribut essentiel des États, qui est l’émission de monnaie en vue de projets correspondant à l’intérêt général (grands équipements, recherche et développement, santé publique ...) leur échappe quasi totalement au profit d’agents financiers privés. Ces agents ont établi un circuit qui leur est propre, dans lequel « l’argent va à l’argent » sans produire de richesse physique, jusqu’à former une bulle financière spéculative de plus en plus « virtuelle ».
Aucun amendement au sein de ce système n’est de nature à constituer une solution. En effet, ajouter sans orientation impérative de la monnaie à la monnaie ou du crédit au crédit n’y fait que gonfler la bulle financière - les profits rapides sur papier ou sur écrans électroniques - au détriment du travail et de l’équipement productifs qui ne sont pas, eux, rentables à court terme.
L’impératif incontournable est donc que les nations se réapproprient l’instrument monétaire et émettent du crédit productif dans les secteurs vitaux : recherche, infrastructures (énergie, transports, communications) et machines-outils. L’épargne doit en même temps être réorientée vers la reconstruction et la réhabilitation du cadre de vie urbain (logement, aménagement de la ville) et de l’espace naturel (reconstitution du sol et du paysage).
II. Le gâchis du travail et de l’investissement créateur
Faute d’avoir voulu s’attaquer à la spéculation monétaire tout en imposant une politique monétariste, l’Europe et la France ont laissé se créer une situation dans laquelle la substance même qui les compose se trouve gravement atteinte. Nous nous bornerons ici à fournir quelques repères de la déperdition, qui concernent la « force de travail « (la population active mobilisable) et l’entreprise (la technologie accumulée mobilisable). Ils se trouvent rarement rassemblés dans notre pays, tant la tendance naturelle y est de segmenter les données. Nous les considérons donc comme d’autant plus révélateurs.
A. La force de travail
1°) La première source de déperdition est le chômage et la précarité : une part de la substance humaine qui aurait pu contribuer à édifier le pays se trouve ainsi exclue.
Les chiffres officiels indiquent une population active totale d’environ 25,6 millions de personnes, parmi lesquelles seules environ 22,4 millions sont occupées. Il y aurait donc près de 3,2 millions de chômeurs, soit un taux se rapprochant de 12,5% de la population totale.
Tous les experts reconnaissent cependant que ces chiffres officiels sont faux.
Dans un rapport rendu public le lundi 17 février 1997, les membres de l’ancien Centre d’études des revenus et des coûts (CERC), dissous par Edouard Balladur, suggèrent au gouvernement d’élaborer une batterie d’indicateurs « lisibles et fiables » afin de mieux refléter la situation du marché du travail. En fonction de ces critères, ils chiffrent à 5 millions le nombre de personnes privées d’emploi. Ce chiffre recoupe nos propres estimations, nécessairement approximatives puisque la notion même de chômage est devenue plus floue avec la multiplication des situations intermédiaires entre l’emploi et l’inactivité, le développement de la flexibilité et l’émergence de la précarité.
C’est pourquoi à la notion même de chômage, il faut ajouter celle de précarité. Si l’on fait la somme des emplois peu sûrs (contrats à durée déterminée, intérimaires, stagiaires, titulaires de contrats aidés ...), du temps partiel subi (40% des salariés à temps partiel) et des RMIstes, on obtient un total d’environ 5 millions de précaires. Parmi ceux-là, les taux de rotation les plus élevés sont pour les salariés les moins qualifiés ...
Ainsi, sur la population active totale, environ 20% des travailleurs français sont au chômage et 10% précaires (ce taux recoupe celui de l’INSEE, qui est d’environ 9%).
Trois Français sur dix sont donc chômeurs ou précaires au sein de la population active totale. Ce chiffre est encore bien plus grave et significatif si l’on prend la population active non protégée, c’est-à-dire l’ensemble des travailleurs n’ayant pas un statut protecteur du secteur public ou semi-public. Sur les vingt millions de personnes concernant cette population active non protégée, dix millions sont au chômage ou précaires - c’est-à-dire un sur deux.
2°) Signe de la crise, la situation des jeunes se dégrade par rapport à l’ensemble de la population.
Non seulement les années 90 ont continué à être plus favorables aux inactifs qu’aux actifs, mais aussi plus aux personnes âgées qu’aux jeunes. Quelques chiffres sont particulièrement frappants (source : rapport du Conseil supérieur de l’emploi, du revenu et des coûts - CSERC - rendu public le 7 janvier 1997) :
- Pour les ménages de moins de 25 ans, le niveau de vie a baissé de 15 à 20% entre 1989 et 1994. Les jeunes, selon l’INSEE, dépendent donc toujours plus des diverses aides que leur versent parents et grands-parents. Cependant, si la solidarité familiale permet de réduire les écarts entre générations au sein d’une même catégorie sociale, elle accentue les écarts entre les jeunes issus de milieux favorisés et les autres.
- Le taux de pauvreté défini par l’INSEE - sont pauvres les ménages dont le niveau de vie est inférieur de moitié au niveau de vie médian - a fortement crû chez les jeunes depuis le début des années 90, passant de 11% à 18%. « La pauvreté en début de cycle de vie est un phénomène nouveau », observe le CSERC, qui ajoute que la proportion des moins de 34 ans parmi les sans logis se trouve en forte augmentation.
- Aujourd’hui, huit nouvelles embauches sur dix relèvent de dispositifs précaires ; les contrats à durée déterminée et les missions d’intérim sont devenus la principale forme de recrutement.
- Un nombre croissant de jeunes diplômés quitte la France pour entamer une vie professionnelle ailleurs, alors qu’en France même, de plus en plus de jeunes diplômés perçoivent le RMI.
3°) Les inégalités sociales s’accroissent au sein des détenteurs de patrimoine et entre revenus du patrimoine et revenus salariaux.
Le rapport du CSERC le constate brutalement : « Entre 1898 et 1994, les inégalités de niveau de vie s’accroissent clairement. »
- L’édition 1996 des données sociales de l’INSEE (document publié tous les trois ans) montre qu’à une extrémité de l’échelle, 10% des ménages (les plus fortunés) se partagent 28% des revenus et surtout 50% du patrimoine. A l’autre bout de l’échelle, 50% des ménages (les moins fortunés) se partagent à peine 25% des revenus distribués en France et détiennent moins de 8% des patrimoines !
- Depuis 1989, les revenus nets de la propriété (patrimoine) ont cru à un : rythme annuel bien supérieur à celui de la rémunération des salariés.
Ainsi, une double inégalité se creuse en même temps que le « filet social » des plus pauvres commence à être remis en cause (l’évolution à la baisse du ticket modérateur de la Sécurité sociale en est un symptôme facile à suivre).
4°) L’endettement des ménages progresse rapidement.
Il représentait à peu prés sept mois de revenu disponible au début des années 70, alors qu’aujourd’hui il est l’équivalent de neuf à dix mois de revenus.
L’accélération de l’endettement des personnes privées s’est donc accrue parallèlement à celui de l’État, et pour la même raison : crédits offerts à des taux d’intérêts très élevés (avec l’effet de la cumulation d’intérêts mal mesurée ou volontairement ignorée au départ) mais crédits nécessaires pour compenser une insuffisance de revenus (les salaires nets ont diminué en francs constants en 1993 et 1994, tout comme les rentrées fiscales...).
5°) L’interdiction de chéquier - repère incontestable de la précarité - concernait 1,8 millions de personnes il y a un an.
6°) La scolarité s’allonge, mais la démocratisation de l’enseignement supérieur est un échec : l’école ne réduit plus les inégalités sociales.
Le niveau général des diplômes de la population s’est élevé (dans les années 60, un jeune sur dix obtenait le baccalauréat, aujourd’hui la proportion est supérieure à six sur dix, mais cette démocratisation est artificielle. La réalité est que l’on retrouve encore plus d’inégalités qu’auparavant à des niveaux supérieurs. La statistique la plus frappante est celle de la part d’étudiants d’origine populaire (paysans, ouvriers, employés, artisans ou commerçants) dans les quatre très grandes écoles françaises (polytechnique, ENA, HEC et Ecole normale supérieure). Selon Michel Euriat et Claude Thélot (Le recrutement de l’élite scolaire depuis quarante ans, éducation et formation, juin 1995), cette proportion des étudiants d’origine populaire était de 29% dans les années 1951-1955 et tombe à 8,6% dans les années 1988-1993.
En France, si les deux tiers des sondés estiment que l’un des principaux rôles de l’école est de réduire les inégalités sociales, 42% pensent que l’école n’a pas d’effet sur ces inégalités et 32% qu’elle les augmente même.
Il y a donc bien non seulement gâchis, mais prise de conscience de ce gâchis par ceux qui en sont victimes. Cela crée un effet psychologique démoralisant dans l’institution scolaire, particulièrement visible et constaté par les enseignants depuis quelques années. L’effort pour apprendre n’est plus motivé par le goût d’une culture, mais par la peur d’être exclu en l’absence de tout diplôme ou en n’ayant qu’un diplôme médiocre.
B. L’entreprise
1°) La précarité touche ainsi directement les petites et moyennes entreprises, alors que les grandes investissent peu mais ont des taux d’autofinancement qui dépassent souvent 100%.
Ainsi, après cinq ans d’existence, deux entreprises créées sur trois ont fait faillite en France. De plus, si le nombre de faillites a relativement baissé, bien que demeurant élevé (autour de 60.000 par an), la proportion des entreprises moyennes par rapport aux petites tend à augmenter.
En outre, à la précarisation des embauches correspond une insécurité de l’emploi des jeunes mais aussi l’absence d’esprit de fidélité à l’entreprise, de désir de s’identifier à elle ou d’y constituer des équipes. Ainsi le CDD, manifestation et expression d’une politique de non engagement de l’entreprise, génère des positions symétriques de non engagement des salariés.
C’est finalement la nature profonde du contrat entre l’employeur et l’employé qui se trouve appauvrie, un contrat qui se réduit progressivement à un échange simplificateur entre du temps de travail et du salaire.
Oublier ainsi que la réussite de l’entreprise ne repose pas uniquement sur ses capacités financières mais aussi sur la contribution des personnes ne peut que pénaliser les résultats et, in fine, retarder la performance.
2°) La nécessité du profit immédiat induit les entreprises à privilégier la main-d’œuvre « mûre » et formée (30-49 ans) au détriment de la main d’œuvre jeune et non formée ou âgée et moins productive (ou censée l’être).
Ainsi, les entreprises se privent de la mémoire et du rôle de conseil joué par la main-d’œuvre de plus de 55 ans, ainsi que du dynamisme des jeunes engagés. A terme, une pyramide des âges trop étroite à la base et trop mince au sommet, avec un renflement entre les deux, correspond à une structure sans avenir.
Le « gâchis » produit par l’impératif du gain financier immédiat se répercute donc dans la structure même de nos entreprises, au niveau de leur capacité de réflexion et de leur vitalité.
3°) Les entreprises n’investissent plus à moyen ou long terme.
En effet, compte tenu de l’absence de perspectives claires pour l’avenir, de l’évolution rapide des marchés et du coût relativement élevé des crédits, alors que les gains sur les marchés financiers apparaissent par contraste faciles, élevés et rapides, les entreprises françaises n’investissent plus au-delà d’un taux de retour espéré de trois ans.
Ce choix élimine tous les projets collectivement les plus utiles.
Le cas le plus absurde d’un point de vue économique, bien que logique du point de vue financier, est celui des grandes surfaces qui ne font plus de bénéfices d’exploitation, mais se bornent à rentabiliser leur trésorerie constituée par la différence entre une vente immédiate sur leurs rayons (la gestion des stocks à flux tendus permet pratiquement un approvisionnement au jour le jour) et un achat à 60,90 ou 120 jours imposé à leurs fournisseurs (qui repose sur un rapport de force). L’on peut dire que ces grandes surfaces sont devenues ainsi des entités financières qui, de par leur poids, mettent en difficulté leurs concurrents et leurs fournisseurs moins puissants, détruisant le tissu économique dont elles-mêmes vivent.
4°) Les « gains de productivité » récents effectués par les entreprises l’ont été principalement par l’informatisation des tâches, et non par un renouvellement des technologies productives.
Ainsi, on a basculé d’une société fondée sur la production et la transformation de la nature à une société fondée sur les services et les échanges financiers.
En adoptant cette démarche, les entreprises prises dans leur ensemble réduisent leur masse salariale et se privent des marchés futurs en contribuant à réduire le potentiel de consommation général.
5°) Les fonds mutuels anglo-saxons s’introduisent dans un grand nombre de nos entreprises et y deviennent actionnaires de référence, y amenant une logique de profit rapide satisfaisant pour l’actionnaire mais incompatible avec des stratégies « longues ».
Les éléments que nous avons ainsi rassemblés ne trompent pas : la force de travail et l’esprit d’entreprise se trouvent actuellement tous deux sacrifiés en France.
La raison principale en est que le crédit et la monnaie - sous forme d’investissements et de revenus - ne viennent pas suffisamment et pas assez profondément les irriguer.
En 1993, comme éclatait la plus grave crise économique de l’après-guerre, la France et l’Allemagne réagirent de la pire manière, en faisant une politique monétaire restrictive et en essayant à coups de hausse d’impôts de contrôler des déficits publics qui s’envolaient, le tout agrémenté d’une surévaluation des changes.
Paris et Bonn, les deux promoteurs du projet de monnaie unique « à la Maastricht » et de ses critères restrictifs font aujourd’hui bien piètre figure. Leur économie en berne (n’assurant plus, comme nous l’avons vu, les conditions de sa propre reproduction), leur société démoralisée et leur alliance distendue, ils commencent à se demander s’ils n’ont pas commis, chemin faisant, une erreur fondamentale. Et si la gestion de la crise des années 90 ne rejoindra pas, grâce à eux, dans les manuels d’économie, celle de la crise des années 30 pour l’aveuglement, l’obstination et l’irresponsabilité économique et sociale de leurs dirigeants.
C’est donc le moment, face à leurs doutes, d’analyser les causes de cette situation, c’est-à-dire la logique perverse du système financier et monétaire mondial qui y a conduit, de déterminer ce que doit être l’émission de crédit et de monnaie à l’opposé de cette logique actuelle et de proposer les mécanismes concrets permettant d’y parvenir. Il s’agit d’aller entièrement à l’opposé de ce qui s’est passé depuis les années 70 et, en particulier, de revenir à un système de « banque nationale »garant de choix politiques collectifs : de se donner les moyens d’un redécollage.
III. La cause du gâchis : un système qui atteint son point de rupture
Le système de Maastricht et ses critères d’austérité monétariste ne sont pas la cause de la crise, mais bien sa courroie de transmission en Europe (cf. Annexe 1 : juin 1997, l’impasse « européenne »). Ils paralysent l’action des pays européens face aux marchés financiers et les enferment dans une camisole de force monétaire et budgétaire.
La cause, comme nous l’avons dit précédemment, est la soumission de l’économie mondiale à une priorité financière, « néolibérale » et « postindustrielle ». Une « bulle » spéculative se développe de plus en plus rapidement, sous l’effet d’une émission monétaire et de crédit financier devenue sans obstacles, détournant les flux monétaires du travail et de la production. L’on peut, à juste titre, la qualifier de « bulle cancéreuse » : elle prolifère au détriment du corps physique où elle se fixe, jusqu’à le détruire. De ce système, nous sommes cependant arrivés aujourd’hui au point de rupture, car il se trouve en faillite virtuelle.
A. Une bulle financière « cancéreuse »
Le schéma suivant (dite "triple courbe" de Lyndon LaRouche) montre cette situation :

Les échanges d’argent (devises) augmentent de manière hyperbolique. Aujourd’hui, chaque jour ouvrable, 1.595 milliards de dollars (environ 9.000 milliards de francs - source : Financial Times du 20 septembre 1996) sont négociés sur les marchés des changes dans les devises des principaux pays du monde. Sur cette somme, 0,25% à 1% seulement correspondent à des échanges de biens physiques réels. Le reste est, au sens pascalien, « pari ».
Le schéma suivant illustre la monétarisation et la financiarisation forcenées des économies occidentales depuis, en particulier, la fin des années 60.
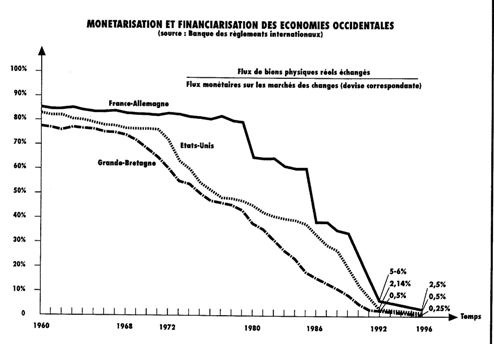
La spéculation financière, sur des marchés à forts effets de levier, atteint environ 3.500 milliards de dollars par jour ouvrable (environ 18.000 milliards de francs-source : Survey of disclosures about trading and derivatives activities of banks and securities flJ711S, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et IOSCO). Sa croissance hyperbolique est donc bien plus rapide encore que celle des échanges de monnaie.
La production physique de biens par tête diminue (c’est la troisième courbe, celle du bas), elle, dans les principaux pays industrialisés, de plus en plus rapidement depuis une vingtaine d’années. Certes, les produits intérieurs bruts (PIB) de ces pays augmentent encore, mais c’est la part services (« utiles » et « prédateurs ») qui s’accroît, non celle des biens de consommation, d’équipement et de production. Cette dernière part, que nous appellerons ici « part physique », se trouve bel et bien en déclin parallèlement à l’accroissement des échanges de devises et de la spéculation financière.
L’on est donc en droit d’affirmer que les « bulles » monétaires et financières croissent de plus en plus au détriment du travail et de la production. Nous sommes aujourd’hui dans une situation de déflation des actifs physiques et d’hyperinflation du monétaire et du financier. Si cette hyperinflation n’apparaît pas dans les statistiques officielles des comptabilités nationales, c’est parce que les formes nouvelles de monnaie et de spéculation financière (positions à terme) sont considérées, comptablement, comme s’équilibrant, suivant le principe qu’à tout acheteur correspond un vendeur. Il n’en reste pas moins que si des défaillances se produisent sur le gonflement des positions spéculatives, toujours susceptibles d’effets de contre-tendance, le « virtuel comptable » deviendra très rapidement « réel » par effet domino de défaillances en chaîne.
Trois éléments viennent aggraver cette situation :
1) La hausse effrénée des capitalisations et transactions boursières, devenues fondement des anticipations spéculatives.
La Bourse de New York a vu ainsi sa capitalisation totale multipliée par sept au cours de ces quinze dernières années [1982-1997], et les échanges à la Bourse de Paris se sont, eux, multipliés par six (séances passant de 1,5 milliards de francs à 6-9 milliards de francs actuellement).
Le point que nous devons ici souligner est que la tendance des Bourses n’est plus déterminée par l’achat ou la vente d’actions ou d’obligations proprement dites. En fait, ce sont des opérations sur les marchés à option (à Paris, le MONEP pour les actions et le MATIF pour les obligations) qui font la tendance.
Les marchés à terme, grâce à leur effet de levier - une mise minimum, appelée « déposit », permet un gain potentiel ou une perte énorme [1]
Les produits financiers dérivés sont l’élément moteur de cette spéculation, car ils permettent l’effet de levier maximum.
La part du jeu est ici aggravée par le recours au crédit : les deux tiers des fonds actuellement investis par les ressortissants américains en Bourse le sont avec des fonds empruntés.
C’est ce « couplage » d’investissements sur produits financiers dérivés avec des fonds empruntés qui permet l’énorme effet de levier sur les Bourses actuelles : l’on peut ainsi « jouer » jusqu’à cent fois sa mise !
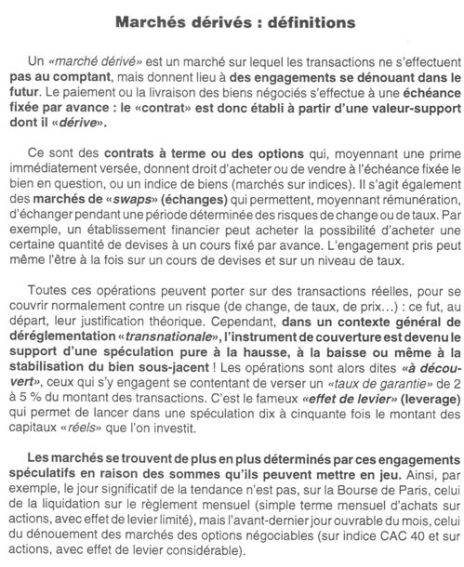
2) La part déterminante d’opérations sur produits financiers dérivés de plus en plus opaques.
Ces produits financiers dérivés concernent en effet principalement des « opérations de gré à gré », se déroulant sur des marchés pratiquement incontrôlés. Les engagements sont si complexes que seuls quelques experts peuvent en mesurer la nature et la portée. La véritable (captation » de l’économie physique par l’économie financière est démontrée par le fait que, pour ces montages sur produits dérivés, les plus importants opérateurs anglais et américains ont engagé les meilleurs mathématiciens disponibles, en débauchant notamment ceux « laissés sur le carreau » par le démantèlement des programmes militaires et spatiaux.
Ainsi, un levier financier s’est substitué au levier technologique dans les principales économies du monde, à l’exception partielle de l’économie chinoise, les autorités de ce pays s’étant constamment efforcées d’entraver les spéculations de cette nature.
3) La criminalisation du système.
Le chiffre d’affaires mondial des organisations criminelles, dans un contexte de libre circulation des capitaux financiers et d’émissions sans obstacles de monnaie et de crédit financier, ne cesse de croître et atteint, selon l’ONU, environ 1.000 milliards de dollars (5.800 milliards de francs) par an. Selon d’autres experts, le chiffre réel serait bien supérieur.
Le FMI, pour sa part, évalue à 500 milliards de dollars (environ 2.900 milliards de francs) de « revenus nets des dépenses » les fonds « blanchis » dans le monde chaque année (trafic de drogue, d’armes, prostitution, corruption ...). Il s’agit de 2% du PIB mondial.
Ainsi, tant au niveau du chiffre d’affaires que des revenus, l’on peut parler d’une véritable force de frappe qui peut, à elle seule et en utilisant les effets de levier des marchés, déstabiliser un pays, une devise ou un marché.
Notons que le recyclage en liquide est chez nous encouragé par la Banque de France puisque depuis 1987, on peut ouvrir un bureau de change sans autorisation préalable de la Banque centrale. Ces « minis boutiques » pullulent (1.300 points de change) jusqu’à supplanter les banques sur ce créneau et constituent « un maillon important de la chaîne du blanchiment ».
Le schéma ci-dessous montre l’évolution des dépenses dans les jeux et la drogue, en milliards de dollars à l’échelle mondiale :
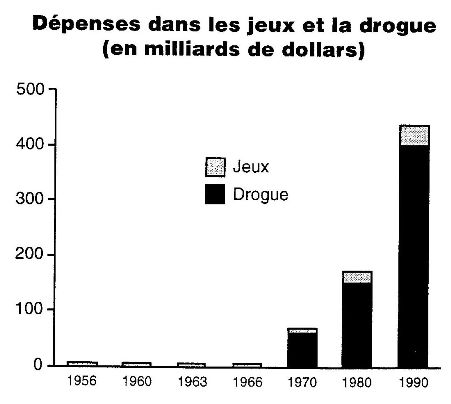
On notera, dans ces deux domaines, une progression hyperbolique parallèle à celle des exportations de devises et des spéculations financières.
Il faut ajouter que la mafia s’est implantée sur les Bourses américaines (cf. un article de Business Week reproduit dans Le Point-Edition Affaires -le 14 décembre 1996). Les activités de la pègre semblent se limiter pour l’instant presque exclusivement au marché hors cote (over the counter) et au Nasdaq, c’est-à-dire aux marchés des « petites » actions (à faible capitalisation) - qui sont, cependant, celles des grandes sociétés de demain. Le plus inquiétant est la peur, le silence et la passivité des pouvoirs publics. L’autorité de contrôle, la NASD, s’est montrée étrangement timide. La pègre a mis cependant en place un réseau de commerciaux, de courtiers et, surtout, l’indispensable « chaufferie », c’est-à-dire un réseau de vente des actions par démarchage téléphonique couvrant tous les États-Unis. Quatre clans et certains éléments de la pègre russe détiennent ou contrôlent, par l’intermédiaire de prête-noms, environ 25 sociétés de courtage.
Ce phénomène ne s’est pas encore produit en France. Cependant, il faut bien noter qu’avec la mise en place récente du nouveau marché, l’équivalent du Nasdaq américain, et l’existence plus ancienne d’un hors-cote et d’un second marché, les criminels disposent à Paris de marchés propices où les volumes de capitalisation sont relativement faibles et où il est donc plus facile de manipuler les mouvements des titres. Rappelons à cet effet que la mafia russe est déjà installée en France, en particulier dans la région méditerranéenne.
Ajoutons, pour finir, que la fraude annuelle sur le budget européen s’accroît chaque année, et qu’elle est actuellement estimée à 100 milliards de francs par an.
Les éléments que nous avons décrits ci-dessus, accélèrent l’évolution divergente d’une part des échanges monétaires et de la spéculation financière, d’autre part de la production physique de biens, et créent une situation de rupture.
B. Les menaces concrètes de rupture
Le système monétaire et financier international, concrètement, se trouve menacé en de nombreux points :
- Pertes importantes sur les marchés de produits dérivés ayant un effet déstabilisateur pour certains des joueurs : la multiplication des contrats et des prises de risque crée sur ces marchés une situation de plus en plus inextricable.
- Vulnérabilité des pays émergents, sur lesquels des capitaux spéculatifs ont réalisé d’énormes gains à court et moyen terme, mais sont prêts à se retirer aussi rapidement qu’ils sont venus en cas de crise (Mexique, Thaïlande). Ces mêmes pays, dont la stratégie était fondée sur des exportations à bas prix de biens de consommation - grâce à une économie informelle et à l’absence de législation du travail - vers les pays industrialisés, se heurtent actuellement à la contraction des marchés de ces derniers, due à la politique monétaire restrictive qui y est poursuivie. Ainsi, « l’effet de levier » qui avait favorisé la croissance de ces pays émergents est en train de s’inverser.
- Guerre des taux d’intérêts entre pays industrialisés et crise japonaise à l’horizon. Le point essentiel à considérer ici est que le Japon, par sa politique récente de bas taux d’intérêt, a irrigué de capitaux la « planète financière ». Les achats de bons du Trésor américain par les investisseurs japonais ou, plus généralement, par des emprunteurs en yens, se sont multipliés, stabilisant l’ensemble du système : les investisseurs japonais ou les emprunteurs en yens avaient avantage à le faire avec un dollar plus fort que le yen (gain en devises) et des taux plus élevés aux États-Unis qu’au Japon (gain en rentabilité). Ce mouvement a été accéléré par deux éléments : l’utilisation de produits financiers dérivés à effet de levier (achats sur les marchés à options d’obligations) et le crédit (emprunts réalisés en yens à bas taux d’intérêt).
Cependant, aujourd’hui, le faible niveau des taux d’intérêt japonais affaiblit le yen, menace la rentabilité du système bancaire du pays (crise des banques japonaises d’investissement à long terme) et la Bourse de Tokyo, sur laquelle les investisseurs n’ont plus intérêt à aller, en raison de la moindre rentabilité par rapport aux Bourses américaines et des pays émergents, et des plus forts risques de crise systémique Bourse-banques (les banques japonaises sont le soutien du Nikkei ; si elles vacillaient, toute la Bourse en souffrirait).
Dans ces conditions, il est quasi inéluctable que les taux d’intérêt japonais augmentent pour soutenir le yen, le système bancaire et la Bourse du pays - ou, au moins, pour éviter sa chute. Cependant, dès lors, le coût des capitaux empruntés au Japon s’élèverait, la rentabilité de l’opération emprunt en yen/investissement en bons du Trésor libellés en dollars diminuerait brutalement et la source principale de fonds du système financier international se tarirait, avec les conséquences que l’on imagine sur la bulle financière.
De plus, un accroissement des taux d’intérêt au Japon pourrait entraîner à tout moment des rétorsions américaines (hausse des taux d’intérêt en dollars pour maintenir les capitaux dans le circuit dollar en le rendant encore plus attractif) - ce qui risquerait de conduire de proche en proche à une véritable « guerre des taux d’intérêt ».
Notons en passant qu’environ 40% de la dette publique allemande est financée par des investisseurs étrangers, européens pour la plupart, et qu’une hausse du dollar inciterait ses derniers à arbitrer en faveur de placements plus rentables outre-Atlantique si les taux d’intérêt américains s’élevaient, en délaissant les émissions allemandes. Alors, pour garder ces capitaux, l’Allemagne utiliserait à son tour l’arme des taux.
Les marchés d’actions et d’obligations internationaux ne pourraient pas, alors, résister à un resserrement monétaire quasi simultané dans deux ou trois des plus grandes puissances financières du monde.
Cet « effet d’enchaînement » n’est pas fatal, mais reste l’un des éléments majeurs qui constituent le « risque systémique » de l’ordre - ou plutôt du désordre - financier et monétaire international actuel.
- La crise générale des systèmes bancaires, dont le japonais n’est qu’un « flanc » particulièrement menacé, mais nullement une exception. Cette crise a été reconnue dans le dernier rapport de la Banque des règlements internationaux ; elle frappe les organismes émetteurs de monnaie, ce qui est « logique » puisque c’est tout le système actuel d’émission de monnaie qui se trouve en cause (cf. plus loin).
C. La rupture est inéluctable
A ces réalités incontournables, les défenseurs des marchés dérivés et de ce système actuel rétorquent que le « jeu » financier est un jeu à somme nulle, donc un jeu théoriquement à durée infinie, dans lequel les gains des gagnants compensent les pertes des perdants. Il y aurait donc un jeu que rien ne saurait arrêter, même s’il a pour conséquence la faillite de certains de ses participants ou d’insupportables souffrances sociales.
Cette thèse est absolument fausse.
Tout d’abord, en termes financiers mêmes, le combat finit dans tout jeu - faute de combattants. L’économie casino repose sur une logique d’élimination et de monopolisation : comme autour d’une table de roulette, si le jeu continue, tous les joueurs finissent par perdre et c’est la banque qui, seule, gagne - mais sans partenaires ou clients pour continuer à jouer.
L’on assiste aujourd’hui à cette monopolisation sur les marchés financiers et à l’apparition du risque d’effet domino : les pertes des uns entraînant les pertes d’autres, les faillites risquent de se multiplier en chaîne. Il n’y a donc pas d’assurance algébrique ou arithmétique contre l’implosion du système, parce que sa réalité est celle d’une dépendance mutuelle entre gagnants et perdants potentiels.
Surtout, en termes physiques et sociaux, l’on voit que le système actuel vit au détriment de la production et du travail : en durant, il favorise de plus en plus le court terme et exclut les investissements « lourds » et à long terme. Il ne crée donc que des emplois de service associés au jeu financier et à son instrument, l’informatique, sans développer en profondeur l’économie.
Dans les pays émergents, par exemple, les industries exportatrices - nous l’avons vu - s’appuient sur de bas salaires, l’absence de législation sociale et un pillage « informel » du travail humain. Elles parviennent à enregistrer d’importants bénéfices à court terme mais ceux -ci engendrent des capitaux à leur tour instables (cherchant du profit « court », sans constituer une « assiette fiscale » permettant les investissements nécessaires dans l’éducation, la santé publique et la recherche et développement. La logique spéculative ne permet donc pas à ces pays - dans lesquels se développe certes une croissance physique apparente - de bâtir le socle réel, les bases d’un développement économique et social intégré et cohérent. De plus, le marché des pays développés vers lesquels ils exportent se contracte ou stagne en raison des politiques restrictives qui y sont pratiquées : une crise des débouchés y apparaît donc en même temps qu’un risque de fuite des capitaux, sans qu’une économie en profondeur ait pu y être bâtie.
La bulle spéculative est donc, par sa nature même, destructrice des fondements de l’économie. Les résistances sociales et la fermeture des sites de production provoquent des « ondes de choc » au sein de la bulle : celle-ci, privée de ressources financières par ces résistances et par un manque croissant de centres d’économie réelle à piller, perd le « levier » qui la maintenait en vie ou, plus exactement, épuise son corps-hôte (l’économie physique) et se condamne elle-même en le condamnant : c’est la « logique » des métastases cancéreuses.
Ainsi, on ne peut plus se voiler la face ou nier la réalité : la bulle financière du système actuel est condamnée à imploser. L’état de l’économie mondiale tel qu’il est aujourd’hui et, au sein de l’économie mondiale, celui de la France, permet d’affirmer que cette implosion est proche.
En effet, toute la pyramide financière tient par le levier d’instruments financiers spéculatifs, démultipliant les effets des interventions à la hausse : à l’opposé de la crise des années 1929-1930, les agents financiers ont cette fois - en 1987 et après - injecté de la monnaie dans le système pour tenter de prolonger sa durée.
Cependant, une telle stratégie ne peut continuer éternellement, car elle creuse le fossé entre le « réel » et le « virtuel ».
Ainsi, lorsque le levier de la hausse que nous vivons depuis environ vingt ans commencera à s’inverser - par exemple, sous l’effet d’une hausse des taux d’intérêt rendant l’argent plus cher (scénario de la « guerre des taux d’intérêt » précédemment décrite), les conséquences seront rapidement dévastatrices. Ce qui hier assurait la démultiplication de la hausse assurera brutalement -après, sans doute, de nombreux sursauts financiers à venir- la démultiplication à la baisse.
Lorsque se produira cette implosion, il faudra empêcher ce qui reste de sain - de productif - dans le corps économique de se trouver emporté avec le cancer. C’est pourquoi nous devons dès aujourd’hui définir l’horizon d’une autre logique, d’autres priorités, d’une autre règle du jeu.
D. La « mondialisation » anglo-américaine
Pour le faire, il faut d’abord identifier l’ennemi - à qui profite la « bulle » - et ensuite établir une stratégie pour combattre cet ennemi et définir un dessein commun, un objectif commun, susceptible de réunir des alliés, de rassembler autour de ce dessein et de cet objectif des forces hétérogènes, de qui peuvent nous séparer de nombreuses convictions ou croyances, mais qui ont en commun de comprendre que leur survie - en tant que « peuples » et « nations » - dépend du passage à un nouvel ordre économique de croissance partagée. John Kennedy, en son temps, avait conçu une « Alliance pour le progrès » et Charles de Gaulle « une Europe de l’Atlantique à l’Oural » : c’est de ces mêmes conceptions qu’il faut aujourd’hui s’inspirer, mais à l’échelle de l’économie mondiale. Nous voyons donc ici une « Alliance pour la paix par le développement mutuel, de l’Atlantique à la mer de Chine », fondée sur la construction d’un « Pont terrestre eurasiatique ») (cf. plus loin).
Cependant ; pour se lancer dans cette entreprise, il faut d’abord comprendre qui s’y opposera et pourquoi. Il faut pour cela démythifier la pensée unique de ces trente dernières années, en sortant « par le haut » du cul-de-sac financier et néolibéral.
L’on tente, depuis plus de trente ans, de nous faire croire qu’il existe une entité suprême appelée « marchés », à laquelle il faudrait se soumettre car ce serait l’état naturel de la société. Rien n’est plus faux : les marchés ont un visage. C’est celui de l’oligarchie financière et du « système britannique », avec son appendice « anglo-américain ». C’est celui de la City de Londres et de Wall Street, de la Réserve fédérale américaine et du Fonds monétaire international, des forces qui administrent le cancer, gèrent la bulle financière.
Les deux schémas suivants illustrent notre affirmation. Tout d’abord, la monopolisation de l’activité sur les marchés des changes :
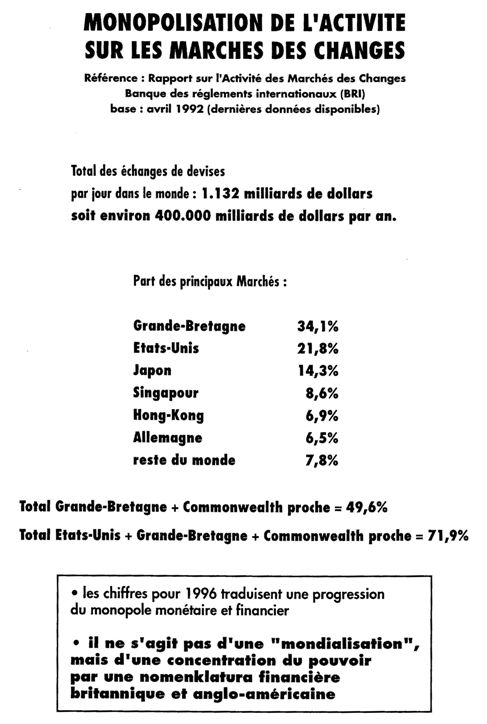
Ensuite, l’aveu fait dans la presse financière spécialisée : La Tribune Desfossés du 17 novembre 1994 :

Il faut ajouter que Londres est non seulement :
- le premier marché obligataire mondial,
- le premier marché des changes mondial,
- et le premier marché des actions étrangères,
mais qu’avec Singapour et Hong-Kong, c’est aussi :
- le premier centre mondial pour les opérations sur produits dérivés, celui dont les « innovations » ont inspiré les autres - le flûtiste de la fable, qui entraîne derrière lui les autres ;
- le premier marché mondial pour les transactions sur les métaux précieux, les minerais rares, le pétrole et le gaz naturel.
Ainsi se trouve là, en termes monétaires, financiers et de matières premières, le centre mondial de l’opposition aux intérêts du travail et de la production, mais aussi la première puissance mondiale actuelle. Non pas l’Angleterre en tant que pays, avec son allié américain, mais le « Commonwealth financier britannique », un empire financier anglo-américain dont le cerveau est à Londres et les principales métastases à Wall Street, Chicago, etc.
Ne nous y trompons pas, le « cerveau » de l’ennemi se trouve là. Ne le confondons pas avec les États-Unis en tant que nation, ni avec l’Angleterre en tant que pays : il s’agit d’un pouvoir oligarchique transnational, doté d’une tradition et d’une histoire qui se confondent avec celles de l’oligarchie britannique. Il opère dans le monde avec ses « collaborateurs » américains, mais aussi français, allemands ...
Chez nous, par exemple, le « relais » de son influence se trouve dans les principales banques d’affaires, à la Direction du Trésor, à la Banque de France et dans le petit monde plus ou moins incestueux de la finance, des cabinets ministériels et des plumitifs de Cour attitrés. Cette dictature financière - et non la « robotisation », « l’informatisation » ou encore la « psychologie des dirigeants français » - est la cause première du chômage.
Prétendre affronter le chômage sans combattre cette dictature, sans avoir un programme international de combat, est une tromperie. C’est aussi, ajouterons-nous ici brièvement, une dictature de l’esprit : elle prétend au monopole de la pensée et impose partout l’obsession du jeu et l’appât du gain immédiat qui avilissent et détruisent le travail humain.
Une simple statistique révélatrice de cet état de fait pour en revenir à la France : en pratique, les « étrangers » contrôlent les deux tiers de la Bourse de Paris. Cette estimation faite par les experts de Paribas dérive de deux chiffres. Les non résidents (britanniques et américains) contrôlent 33% du volume des actions, notamment sous forme d’investissements sur le MONEP (options). Mais comme ils possèdent tout sous forme de flottant et que celui-ci représente 50% de la capitalisation totale à Paris, on arrive en fait à une « position de force » de 33% sur le 50% qui bouge - c’est-à-dire à un contrôle à 66% ... Preuve de plus que nous avons, au sein du système dominant, perdu toute indépendance de décision.
Ajoutons que l’État français s’est donné jusqu’à aujourd’hui le bâton pour se faire battre, en s’adaptant toujours plus à un système pourtant contraire à son intérêt. Ainsi, par exemple, un décret paru au Journal officiel du 3 janvier 1996 précise les conditions dans lesquelles l’État pourra intervenir, s’il le souhaite, sur le marché des produits dérivés. Certes, la loi de finances pour 1995 l’autorisait chaque année à utiliser les produits dérivés de toute sorte (options, swaps, marchés à terme) mais aucun décret n’avait été jusqu’alors adopté pour préciser les modalités d’intervention du Trésor. C’est la preuve même que faute de s’opposer à ces marchés, l’État lui-même doit adopter leur loi. Certes, il n’a pas pour l’instant recouru concrètement aux produits dérivés, mais il a fait le premier pas juridique.
Ceci indique l’urgence qu’il y a à changer l’ordre des choses.
IV. La nature désastreuse des politiques monétaires actuelles
A. Aujourd’hui : l’abandon aux banques de la création monétaire
Avant d’entreprendre le combat pour rétablir l’ordre des choses, c’est -à -dire réorienter le crédit vers le travail et la production, il faut dissiper les mythologies propagées sur la monnaie, afin de partir d’une conception rigoureuse de sa nature.
L’argent est la chose la plus courante, mais la plupart des gens ignorent d’où il vient. Ils imaginent que c’est le gouvernement qui crée l’argent, car les billets de banque sont imprimés par la Banque de France.
La réalité, c’est que le système bancaire crée aujourd’hui la plus grande partie de l’argent en circulation. Les banques émettent en effet de la monnaie chaque fois qu’elles consentent des crédits dont le montant dépasse les dépôts qui leur sont confiés. Il s’agit bien entendu d’une monnaie scripturale (sur les comptes des banques) ou électronique et non de papier monnaie.
Parallèlement, chaque fois qu’un prêt est remboursé à la banque, c’est de l’argent qui n’existe plus : la monnaie émise est détruite chaque fois que les prêts sont remboursés, et cela diminue d’autant la quantité d’argent en circulation.
Dans ce circuit, il faut relever que l’argent créé par les banques engendre automatiquement de l’endettement : elles créent le capital qu’elles prêtent, mais ne créent pas l’intérêt qu’elles exigent en retour. En d’autres mots, les banques demandent aux emprunteurs de rembourser de l’argent qui n’existe pas.
Ainsi, au fur et à mesure que ce circuit s’est mis en place l’endettement des agents économiques a fatalement augmenté [2] : tout le système repose sur cet endettement, et le seul moyen de rembourser de l’argent qui n’existe pas, c’est d’emprunter de nouveau. C’est ce qui fait que tous les États du monde accumulent un endettement de plus en plus important et que, pendant longtemps, les entreprises ont accru elles aussi leurs dettes et vu diminuer leurs taux d’autofinancement.
Aujourd’hui, pour diminuer cet endettement, les États n’agissent pas sur la cause -la méthode fallacieuse de l’émission d’argent mais sur le symptôme en diminuant leurs dépenses publiques et, en particulier, les services sociaux nécessaires à la population. C’est cette politique absurde qui se trouve consacrée par les critères de Maastricht. Elle aboutit en fait à une aggravation constante de la situation : en diminuant leurs dépenses publiques, les États diminuent leur apport à l’économie dans son ensemble et réduisent donc l’assiette fiscale qui est le fondement de leurs recettes. Ceci accroît à son tour les déficits publics par défaut de recettes, que l’on compense par une nouvelle diminution des dépenses et ainsi de suite. Un cercle vicieux de destruction de l’économie se met alors en place.
Quant aux entreprises, dont l’endettement avait auparavant entretenu le système, elles se sont mises à ne plus investir pour réduire leurs charges financières et à licencier pour diminuer leurs charges sociales. Les plus grandes sont ainsi parvenues - en utilisant les moyens de l’informatisation et de la robotisation - à accroître leur productivité tout en diminuant leur main-d’œuvre et en endiguant la hausse des salaires. C’est cette attitude, imposée par la « logique » de l’endettement dans le système monétaire actuel, qui contribue à accroître le chômage et à réduire les revenus et la consommation de la population, donc à réduire ici encore l’assiette fiscale (impôts indirects perçus sur la consommation et impôts directs sur les revenus).
Ainsi s’est créé un mécanisme d’étranglement de l’économie physique, avec à côté d’elle la prolifération d’une économie de la rente.
Cette « rente », hors de toute logique physique ou productive, s’est constituée comme moyen parallèle de gain rapide relevant seulement de rapports de force sur les marchés ou d’informations privilégiées sur leur évolution. L’on peut parler ainsi d’une accumulation parasite de capital fictif, rendue possible au départ à la fois par l’abandon aux banques de la création monétaire et par la déréglementation généralisée. Les conséquences en sont ce que nous avons décrit ci-dessus dans notre troisième partie : une bulle financière de plus en plus cancéreuse se gonflant à l’échelle mondiale.
L’effet de cette rente a été encore aggravé par les taux d’intérêt réels (taux d’intérêt affichés moins taux d’inflation) les plus élevés de l’histoire : l’endettement étant au centre du système, il devenait « normal » qu’il soit profitable aux prêteurs titulaires de la rente et non aux emprunteurs-producteurs.
Et lorsque, comme actuellement, les taux d’intérêt ont été diminués, les emprunts n’ont pas été réalisés pour nourrir l’économie productive, mais pour « jouer » sur l’économie financière ou spéculative, plus rentable à court terme.
Deux exemples frappants de ces distorsions peuvent être mentionnés en France : une société industrielle aux technologies de pointe, comme Thomson, a pendant longtemps effectué ses principaux gains en gérant sa trésorerie de façon risquée sur les marchés financiers, de même que les grandes surfaces (cf. ci-dessus). Ainsi, même les sociétés des secteurs productifs deviennent les participants au jeu financier, vers lequel elles contribuent à orienter la monnaie.
Il est donc clair qu’un tel système monétaire, cumulant l’endettement comme principe de départ, la domination des marchés par la rente comme mode d’opérer et la manipulation des taux d’intérêt sans réelle logique économique comme instrument, ne peut aboutir qu’au désastre.
B. L’évolution depuis 1945 : l’adaptation aux marchés et le couplage création monétaire - spéculation financière
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’émission monétaire en France peut être divisée en quatre périodes principales, qui marquent une évolution inéluctable vers l’abandon à la loi des marchés.
- 1945-1966 : la création monétaire par l’État permet le financement de la production. Les crédits alloués sur les budgets de l’État, sur cette période, ont représenté en moyenne 75% de tous les crédits accordés à l’économie. Un réseau d’organismes financiers spécialisés a permis à l’État d’émettre ce crédit productif (Fonds de modernisation et d’équipement, FDES, secteur financier parapublic, Crédit foncier, garantie de l’État et bonification d’intérêts accordée aux banques privées pour le logement et l’agriculture ...).
Le FDES, en particulier. a été créé au sein du Trésor en 1955 pour prendre la suite du Fonds de modernisation et d’équipement (le FME, créé en 1948 pour assurer le financement de la reconstruction dans le cadre du plan Marshall) et contribuer au financement des projets prévus par le Plan. - 1966-1979 : le système de création monétaire est abandonné aux banques.Les pouvoirs publics transfèrent en effet l’initiative de financement au secteur privé, tout en gardant un secteur administré réduit. Le secteur bancaire privé va bénéficier d’un certain nombre d’avantages hérités du système de financement public (intérêts fiscalement déductibles, nombreux crédits préférentiels à taux bonifiés ...) sans être tenu à une orientation productive des crédits (contrepartie légitime des avantages donnés). Les établissements bancaires et de crédit font tourner à plein la « machine à faire des prêts » sans autre préoccupation que de faire du chiffre.
C’est en effet de leur offre de crédit que les banques tirent l’essentiel de leur chiffre d’affaire. Elles cherchent à développer au maximum l’activité de crédit clientèle, dans un but de profit commercial, en incitant leurs clients à emprunter, dans des proportions parfois injustifiées, tant au niveau de projets financés que des montants accordés (prêts aux entreprises, aux ménages et aux États, dans le secteur en voie de développement surtout, se traduisant au final par un surendettement généralisé). Ce crédit abondant (dans les années 70, les crédits des institutions financières représentent 80 à 90 % des financements, le solde concernant les valeurs mobilières) se traduit par une demande de réescompte auprès de la Banque centrale, qui y répond en faisant de la création monétaire. La moitié des crédits accordés par les institutions financières est alors financée par création monétaire [3]
L’autre moitié est le résultat de la transformation des dépôts à court terme des ménages et des entreprises en prêts à moyen et long terme. Le financement par émission d’actions ou d’obligations reste quant à lui peu attractif (coût élevé des émissions, forte imposition de dividendes, rentabilité comparativement inférieure des actions).
Ce système favorisait une création monétaire à tout va, sans orientation économique précise et aboutissant à un cycle endettement-inflation. Mieux valait alors, en effet, emprunter qu’épargner : il était plus intéressant de voir l’inflation rogner les échéances de remboursement d’un emprunt que les intérêts de placement d’une épargne. Tout concourait donc à développer un cycle inflationniste par répercussion sur les prix des hausses des taux décidées par le gouvernement pour tenter de limiter l’ampleur de la création monétaire.
- 1979-1986 : un marché des capitaux est créé en vue d’un financement croissant à partir de l’épargne et des dépôts.
La montée brutale des taux d’intérêts décidée aux États-Unis casse le cycle d’endettement et d’inflation que nous venons de décrire. Avec une inflation réduite et des taux d’intérêts nominaux oscillant entre 15 et 20%, le coût réel du crédit devient insupportable pour beaucoup d’entreprises qui ne peuvent plus investir de ce fait.
Les pouvoirs publics ont voulu répondre à la demande de crédit non satisfaite en faisant succéder au crédit par création monétaire un crédit à partir de l’épargne disponible.
Une bonne part de l’épargne existante (rendue abondante par la création monétaire) étant attirée dans les circuits destinés à approvisionner l’économie à bas taux d’intérêt, il faut décider de la réorienter en priorité vers les marchés boursiers. Il s’agissait officiellement de permettre aux entreprises de trouver les fonds nécessaires à leur investissement à un coût accessible :- par réduction des avantages liés à l’épargne et aux dépôts dans les secteurs administrés ;
- par la création de moyens simples et avantageux d’investir en Bourse pour tous les épargnants : développement des OPCVM (voir ci-dessus) et octroi d’avantages fiscaux (loi Monory de 1978 qui détaxe les revenus en actions).
La mesure la plus spectaculaire afin de détourner l’épargne du réseau bancaire pour l’amener sur les marchés boursiers a été prise par un arrêté du 3 septembre 1981, ramenant autoritairement de 17% à 3,5% la rémunération des dépôts à terme inférieurs à 500.000 francs dans les banques. Celles-ci durent donc diminuer leurs taux et affronter la récrimination des clients qui se plaignaient d’être spoliés, puisqu’une inflation de 14% rongeait la substance de leur épargne.
Les OPCVM [4] devenaient dans ces conditions des placements bien plus attractifs que les produits purement bancaires. Les banques se convertirent rapidement à l’offre de produits boursiers, jouant simplement le rôle de mandataire pour le compte de leurs clients.
Au nombre de 4577 en France fin 1993, « les OPCVM ont vu le stock total de leurs actifs être multiplié par 27 entre 1979 (50 milliards de francs) et 1993 (2856 milliards de francs). C’est dire si leur développement a été fulgurant (Olivier Piot, Finance et économie, la fracture, Le Monde éditions).
Les ménages ont réagi dans le sens voulu en diminuant leurs placements immobiliers et leur épargne liquide au profit des valeurs immobilières. Ainsi, « la part des valeurs mobilières a doublé en pourcentage du total des actifs financiers bruts des ménages sous la double influence des déductions fiscales accordées depuis 1978 et au développement des OPCVM offrant aux petits épargnants des instruments de placement diversifiés et d’un accès dont la commodité est comparable à celle de l’épargne liquide remboursable au guichet. » (ibid.)
De leur côté, les entreprises épargnantes ont utilisé le marché des capitaux pour la gestion de leur trésorerie et leurs fonds en attente d’investissement : « Elles ont substitué depuis 1981 les titres des OPCVM de trésorerie à leurs placements antérieurs en liquidités dans les banques (...) Les titres de l’ensemble des marchés des capitaux représentent en 1990 près de 67% de leurs créances contre moins de 25% en 1976. Corrélativement, les liquidités déposées dans les banques ont diminué de moitié. » (Ibid.)
Les entreprises ont donc pu faire appel à cette nouvelle source de fonds : la part du marché des capitaux pour le financement externe est passée de 38,9% à 63,5% des encours entre 1980 et 1990.
Les OPCVM ont permis de drainer l’épargne des ménages et des entreprises sur tous les types de marchés (actions, obligations, titres de créances négociables). La rentabilité y dépasse largement celle des placements traditionnels (de 10% l’an et jusqu’à 30% durant plusieurs années, dans un contexte de basse inflation).
Les différents marchés ont été progressivement réunis au cours des années 80 « dans le cadre d’un projet global de mise en place d’un vaste marché où tous les agents économiques émettent et souscrivent des titres négociables de toutes durées. » (Monique Béziade)
La suppression progressive du contrôle des changes entre 1985 et 1990 (suppression totale du contrôle des changes le 11 janvier 1990) va mettre ce marché unifié en ligne directe avec le marché international des capitaux. Désormais, la place de Paris sera partie intégrante d’un grand marché international déréglementé. Nous en avons vu les conséquences.
Pour faire ses placements, le grand public s’adresse aux banques et à différents intermédiaires financiers. Ceux-ci, à travers leurs conseils et leurs analyses, « font en quelque sorte le marché. Leur but premier est de maximiser le profit de leurs clients, notamment les plus gros d’entre eux. Le premier critère d’investissement reste le profit par titre, indépendamment de la profitabilité pour l’économie de l’activité financée.
De la création monétaire à l’épargne, le circuit financier national s’affranchissait ainsi de toute tutelle publique : Les pouvoirs publics se sont limités à assurer le « bon fonctionnement » du nouveau système. Il était désormais admis que, par nature, les marchés devaient échapper à toute intervention dirigée.
Mais en laissant agir les forces en présence, au nom de la liberté du marché, on a laissé s’instaurer la loi du plus fort. Les fonds d’investissement les plus importants ont cherché à conforter leurs positions acquises, l’argent allant à l’argent plutôt que d’aller à la production.
L’épargne des ménages, utilisée auparavant au nom de l’intérêt général, est maintenant orientée par chaque ménage au nom de son intérêt particulier et de la maximisation de son profit. Cependant, le profit individuel des ménages qui ont profité de la manne boursière (cela reste une minorité en déclin si l’on en juge par la baisse des titres récemment mis dans le public, pour ne pas parler des actions Eurotunnel ou Eurodisney ...) ne coïncide pas avec le profit collectif de la majorité et l’intérêt général.
Finalement, on en arrive, au début des années 80, à un « couplage » entre l’abandon de la création monétaire aux banques et la libération des marchés financiers. Son résultat « naturel » a été l’apparition d’une bulle financière.
- 1986-1997 : la bulle financière.
L’afflux de l’épargne a donné à la place de Paris la masse critique qu’on estimait nécessaire pour attirer les « gros » investisseurs étrangers. Les cotations n’ont dès lors cessé de monter, pour deux raisons principales :
-
- l’anticipation de profits rapides à venir ;
- la simple perspective d’un mouvement de hausse auto-entretenu.
Le mécanisme de fixation des cours des actions est ainsi devenu spéculatif et la création des nouveaux produits financiers (marchés à terme et produits dérivés) a accentué cette tendance. Dans cette logique spéculative, un titre est acheté dans l’unique perspective de pouvoir le revendre plus cher et ceux qui achètent le font uniquement parce que la tendance du marché est haussière. Leurs achats cumulés font monter le marché. D’autres acteurs, voyant cela, achètent à leur tour et font monter encore les cours. Une nouvelle impulsion accentue le phénomène et ainsi de suite : la bulle spéculative est en place, basée sur l’expansion du nombre de joueurs.
Dès lors, et c’est la situation extrêmement malsaine d’aujourd’hui, l’émission de monnaie par crédit bancaire se trouve orientée vers les marchés financiers et non vers l’économie physique, conduisant le système, dans sa phase ultime, à l’aberration américaine : on emprunte de l’argent aux banques pour investir en Bourse dans des produits de plus en plus risqués.
Un réajustement extrêmement brutal devient inévitable, d’autant plus que l’on a renoncé progressivement à tous les correctifs qui permettaient à un circuit d’argent productif de se maintenir.
C. La renonciation aux correctifs publics
Au cours de l’évolution ci-dessus, qui a commencé à se dessiner lors des années 60 et a abouti à la situation actuelle, tous les correctifs - les circuits de l’argent public orienté - ont été abandonnés un à un. Bien pire encore, les textes interdisent qu’on y ait désormais recours.
1°) L’autonomie de la Banque de France.
L’État a perdu le contrôle de son organe émetteur de monnaie et de crédit. Le principe suivant lequel la monnaie est le (bien commun » du pays et l’instrument des politiques décidées par sa majorité a été ainsi abandonné. La conception monétariste s’est imposée suivant laquelle la monnaie relève au contraire d’experts financiers. L’autonomie de la Banque de France apparaît ainsi comme une conséquence logique » de l’évolution que nous avons décrite ci-dessus.
Dès les années 70 (par la loi du 3 janvier 1973 et le décret du 30 janvier 1973), la Banque s’est vu reconnaître une autonomie statutaire de gestion. C’est toutefois en application du traité de Maastricht (article 109E) que les États membres de l’Union européenne ont dû entamer le processus conduisant à l’indépendance de leur banque centrale.
Le nouveau statut de la Banque de France a été ainsi fixé par la loi du 4 août 1993. L’article 1er de cette loi dispose que la Banque de France définit et met en œuvre la politique monétaire dans le but d’assurer la stabilité des prix. Elle accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique générale du gouvernement ». Le Conseil de la politique monétaire, institué à cet effet, bénéficie d’un statut d’indépendance par rapport au gouvernement et donc par rapport au Trésor.
2°) La suppression des avances du Trésor à la Banque de France.
Une loi de 1974, succédant au décret de 1973, a déjà posé le principe de l’interdiction des avances de la Banque de France à l’État.
Avant la période actuelle, en cas d’insuffisance du compte courant du Trésors alimenté par des correspondants du Trésors et l’émission de bons, le trésors pouvais recourir aux avances de l’institut d’émission. C’est la Banque de France, institut d’émission, qui apparaissait alors comme un précieux auxiliaire du Trésor.
Aujourd’hui, la suppression de ces avances apparaît comme la conséquence logique de l’évolution vers l’autonomie de la Banque de France et l’abandon de fait de l’émission de monnaie aux banques.
Une loi de 1974, succédant au décret de 1973, avait déjà posé le principe de l’interdiction des avances. Cependant, ici encore, c’est le traité de Maastricht qui a consacré la rupture.
Soucieux en fait d’éviter le financement monétaire du déficit. public, les négociateurs du Traité ont inclus dans l’accord une disposition (article 104 du Traité CE) interdisant aux banques centrales nationales d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux administrations centrales, autorités régionales ou locales, autres autorités publiques ou entreprises publiques des États membres de la Communauté. L’acquisition directe, auprès d’eux, par les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
Les concours de la Banque de France au Trésor ont donc disparu à partir du 1er janvier 1994, deuxième phase de l’Union économique et monétaire européenne. En outre, une convention entre l’État et la Banque de France, approuvée par la loi du 23 juillet 1993, a prévu que les concours jusqu’alors accordés - ramenés à 24 milliards en 1993 et rémunérés au taux de 5% - devraient être remboursés, à raison d’un dixième au moins par an, avant l’an 2003.
En outre, la Banque de France (article 104 A du traité CE) ne peut plus accorder de régime de faveur aux titres publics qu’elle achèterait, revendrait ou prendrait en pension.
L’on se trouve donc devant un tarissement quasi absolu de la monnaie Banque de France - sauf pour les billets de banque et pièces de monnaie. Les relations entre le Trésor et la Banque de France ont été banalisées, conformément aux exigences de l’intégration européenne.
3°) Le rôle bancaire du Trésor se trouve lui-même fortement réduit dans son ampleur.
Ce rôle peut traditionnellement prendre deux formes : tantôt le Trésor agit comme une banque de dépôts et même une banque d’affaires en fournissant des capitaux ou en adoptant certains avantages à des entreprises dont il veut assurer le développement, tantôt l’activité du Trésor peut se rapprocher de celle d’une banque d’émission, avec intervention dans le domaine de la circulation monétaire.
Le rôle du Trésor banquier d’affaires a été, dans la logique récente de désengagement de l’État en matière économique, fortement réduit.
Le compte du Fonds de développement économique et social (FDES), qui a longtemps été le plus important et a retracé la plus grande part des investissements économiques et sociaux financés au moyen de prêts sur fonds publics, a dans un premier temps dépéri (il n’avait été doté pour 1996 que de 2,6 milliards de francs de crédits) pour être ensuite dissous par arrêté ministériel du 29 novembre 1996. Il a été remplacé par un simple groupement ministériel pour l’investissement, dont le Secrétariat général est assuré par la Direction du Trésor. C’est dire que l’on a ainsi anéanti le dernier élément relevant de la « logique » du plan Marshall (rappelons qu’en 1955, le FDES avait pris le relais du Fonds de modernisation et d’équipement de 1948). Le libéralisme économique prôné au lendemain de l’alliance politique de 1986 et non remis en cause après celle de 1988 ne pouvait conduire qu’à cette conséquence économiquement désastreuse.
Ainsi, lorsque par une proposition de loi du 3 juin 1996, M. Jean Royer envisagea de permettre à la Banque de France de faire l’avance d’une masse de monnaie - par exemple, 500 milliards de francs, soit environ 10% de la masse monétaire dans son sens le plus large - en plusieurs années au FDES, pour consentir des prêts à un taux bas égal à celui de l’inflation, sur une longue durée correspondant à celle des amortissements techniques, on lui opposa les engagements pris à Maastricht (articles 104 et 109 susmentionnés), les orientations politiques décidées à Paris et même l’article 40 de la Constitution [5] (cf. plus loin, V- B. Illégalité de l’investissement productif).
C’est la preuve même que l’on ne peut « tourner » le système actuel, tant celui-ci s’oppose à l’ordre productif public, mais qu’il est devenu nécessaire d’en modifier les fondements mêmes.
Même désengagement dans le domaine des dotations en capital et des prêts publics. Avant 1981, l’État se consacrait à ces prêts. Après 1981, ayant nationalisé les grands groupes industriels et le secteur bancaire, il a dû se comporter en actionnaire et doter ces entreprises en capital. En contrepartie, il a décidé alors de ne plus être qu’accessoirement un prêteur de fonds, réservant cette fonction aux banques et institutions financières. Mais après les privatisations entamées en 1986, les dotations en capital ont largement diminué, sans que l’État reprenne pour autant son rôle de prêteur de fonds. Ce qui fait que le retrait a eu finalement lieu sur tous les plans.
En ce qui concerne la bonification d’intérêts, c’est-à-dire l’action menée pour permettre aux entreprises d’emprunter à des taux inférieurs à ceux du marché (notamment lorsqu’elles créent des emplois, économisent de l’énergie ou qu’elles accroissent leurs exportations), le Trésor a également drastiquement’ réduit son effort ! L’argument pour remettre cette politique a été double : son coût élevé et ses effets de distorsion de concurrence, entraînant souvent les réprobations de la Commission européenne.
Finalement, le Trésor agit sur la circulation monétaire par l’émission de bons du Trésor. Il participe à la création de monnaie fiduciaire lorsqu’il prélève sur les dépôts de ses correspondants et notamment sur les fonds des chèques postaux pour assurer ses règlements, mais ce rôle est relativement marginal par rapport à celui que jouent les banques dans l’émission monétaire (cf. ci-dessus).
Ainsi, l’État et la Banque de France se sont désengagés de la création de monnaie et de l’émission de crédit.
Il en résulte un système :
- de plus en plus spéculatif, pénalisant le crédit productif et arbitrant pour le court terme contre le long et moyen terme ; la conséquence en est la bulle financière ;
- sous contrôle de l’étranger, tant dans ses orientations générales (la déréglementation favorise la loi du plus fort) que dans la présence croissante sur les marchés financiers de fonds mutuels anglais et américains en Bourse, et de fonds « vautour » des mêmes pays sur le marché de l’immobilier ; la conséquence en est une croissante dépendance.
- opposé à la logique infrastructurelle. Le scandale d’Eurotunnel en a été le révélateur ; la conséquence en est l’absence de grands projets.
Il est clair qu’il faut changer de système, c’est-à-dire d’axiomes et de postulats monétaires.
D. Nécessité du retour à une monnaie « Banque de France »
Par l’émission monétaire, l’on ne fait que créer des chiffres, qui permettent au pays de faire usage de sa propre capacité de production. Sans la production de tous les citoyens, les « chiffres » du banquier ne vaudraient dans la réalité absolument rien.
Si l’émission bancaire aboutit, comme aujourd’hui, à une bulle financière qu’il ne sert à rien de continuer à nourrir, il revient à l’État de créer lui-même des « chiffres », représentant la production de la société, sans passer par le circuit bancaire et sans endettement. En fait, c’est le premier devoir de tout État souverain d’émettre sa propre monnaie, sans dette.
Le Premier ministre canadien Mackenzie King disait justement, en 1937 : « Tant que le contrôle de l’argent et du crédit n’aura pas été restitué au gouvernement et reconnu comme sa responsabilité la plus évidente, il est vain de parler de démocratie et de souveraineté du Parlement »
La seule solution pour arrêter la dérive de la bulle financière et de prévenir son implosion est donc que la Banque de France revienne à son principe d’origine. Sa « raison d’être » est d’émettre tout l’argent nécessaire pour la bonne marche de l’économie de la nation. Le gouvernement pourrait ainsi financer tous les développements infrastructurels et programmes sociaux que la population réclame et qui sont physiquement réalisables.
La limite à l’émission de monnaie et de crédit ne découle pas en effet de lois propres à l’ordre monétaire, mais est « physique ».
Manipulée par les intérêts financiers et leurs partisans, l’opinion publique est trop souvent persuadée que toute création de monnaie par les autorités monétaires publiques entraîne de l’inflation. C’est le fantasme de la (planche à billets ».
En réalité, un supplément de monnaie ne devient inflationniste que s’il déclenche un excès relatif de la demande par rapport à l’offre. C’est-à-dire une tendance trop forte à la consommation soutenue dans le temps, sans création de contrepartie productive permettant de l’alimenter.
L’on peut donc dire dans ce sens que c’est l’argent émis par les banques qui, intrinsèquement, est inflationniste. En effet, l’obligation par le gouvernement et les sociétés qui empruntent de ramener à la banque plus d’argent qu’il n’en est sorti (les intérêts au départ, et bien plus encore aujourd’hui, le service de la rente financière liée à la dette), oblige justement les sociétés à gonfler leurs prix et les gouvernements à gonfler leurs impôts, créant ainsi de l’inflation pour rembourser. Lorsqu’il n’y a pas inflation - comme c’est le cas actuellement - c’est, dans ce système, plus mauvais signe encore : l’absence d’inflation est obtenue au détriment des revenus du travail et des investissements productifs !
C’est l’émission de monnaie par le gouvernement qui, elle, n’est pas intrinsèquement inflationniste, à condition de respecter certains principes physiques.
C’est ici que l’exemple du plan Marshall est extrêmement révélateur (cf. Annexe 2), surtout si on le compare à la camisole de force du pacte de stabilité européen (Annexe l), type même du « pacte » qui réprime l’inflation visible mais en cassant la machine productive.
L’argent nouveau, bien entendu, ne doit pas être émis selon les caprices des gouvernements au pouvoir, mais en fonction des capacités d’équipement et de production mobilisables. Le « paiement en retour » sera en effet assuré par les gains de productivité.
Or, les « gains de productivité » supposent l’introduction et l’extension de technologies nouvelles. C’est dire qu’au couplage actuel argent bancaire - bulle financière, il faut en substituer un autre, argent public - technologie productive.
Le point qui reste à établir est comment choisir une technologie plutôt qu’une autre. C’est ici qu’apparaît la notion physique d’accroissement de production par tête, par ménage et par unité de surface : l’investissement technologique à choisir, et pour lequel il faut émettre du crédit, est celui qui permet d’obtenir cet accroissement.
L’État doit en particulier soutenir les infrastructures de base physiques et humaines (santé publique, éducation, recherche et développement) dont les « paiements en retour » se font sur la longue période.
L’argent deviendrait ainsi le reflet le plus exact possible des réalités de l’économie réelle, et l’investissement générateur de productivité serait une anticipation sur les paiements en retour des équipements et des technologies financées.
Ce qui fait en effet la valeur d’une monnaie, ce ne sont pas les engagements de remboursement (circuit de la dette), mais ce sont les biens économiques qui sont susceptibles d’être acquis avec elle (circuit de l’équipement et de la production).
Ces vérités élémentaires méritent d’être rappelées, tant les idées monétaristes imprègnent aujourd’hui les intervenants sur les marchés et les mentalités. Tout plan de relance doit s’en inspirer : il ne revient pas à l’État, comme à une ménagère, d’équilibrer ses comptes sous peine des pires ennuis, mais il doit par contre bien estimer les points d’impact par lesquels la monnaie qu’il émettra permettra d’enclencher un processus auto-cumulatif de croissance physique solide et durable.
V. La situation actuelle et ce qu’il faut faire
A. Relance et emploi
Nos propositions visent à financer l’avènement d’une troisième ère du développement économique ou ère des Ponts terrestres, qui ouvrira les régions continentales du globe jusqu’à présent sous peuplées et sous exploitées.
Elles pourraient créer en cinq années 1,5 millions d’emplois en France. Il n’est pas sûr que les réserves européennes d’emplois suffisent à cette mobilisation économique. Il faudra vraisemblablement une nouvelle vague d’immigration en Europe.
Pour l’heure le système financier, qui s’exprime à travers les contraintes posées par le traité de Maastricht du 7 février 1992, bloque toute initiative d’investissement. La réponse négative de M. Galland, ministre délégué au Budget, à la proposition de M. Royer illustre cette paralysie européenne.
La tenue d’un nouveau référendum, passage obligé pour revenir sur Maastricht, devra être l’occasion d’expliquer et de rallier le peuple français autour de nouveaux principes simples, concernant notamment le crédit productif. Nous en donnerons ici les éléments essentiels.
Une fois le verrou de Maastricht supprimé, les mesures à prendre demandent en effet un grand courage politique et une mobilisation forte des populations. Si la France s’engage, elle provoquera un effet d’entraînement en Europe et dans le monde. Il faut dès maintenant rallier les suffrages et s’approcher de nos alliés potentiels pour les mettre en œuvre.
B. Illégalité de l’investissement productif
Nous partons d’un constat : les propositions d’investissements productifs faites régulièrement dans notre pays sont dans l’ordre actuel des choses non seulement inenvisageables, elles sont illégales.
La proposition de loi déposée par le groupe République et Liberté en juin 1995, quoique pleinement justifiée, est triplement illégale si l’on s’en tient aux textes existants. Outre l’article 40 de la Constitution (voir encadré), qui interdit à un député de faire des propositions tendant à aggraver la charge publique, la mise à disposition de fonds par la Banque de France au FDES contrevient aux articles 140 et 109bis du traité de Maastricht ainsi qu’aux articles 1 et 3 du statut de la Banque de France.
A supposer en effet que l’initiative du Groupe République et Liberté soit reprise à son compte par le gouvernement, celui-ci n’est pas autorisé à se faire donner des avances ou des prêts par la Banque de France.

L’article 104 interdit spécifiquement aux banques centrales nationales d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux administrations centrales, autorités régionales ou locales, autres autorités publiques ou entreprises publiques des États membres de la Communauté. L’article 109bis leur interdit toute avance de trésorerie. Les nouveaux statuts de la Banque de France ont pris acte de cette interdiction.
La loi n °93-1444 du 31 décembre 1993 fait défense à la Banque de France « de solliciter ni accepter d’instructions du gouvernement ou de toute autre personne » (article 1). Il lui est notamment « interdit d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de crédit au Trésor Public ou à tout autre organisme ou entreprise publics » (article 3). De même, l’acquisition directe par la Banque de France de titres émis par ces entités est interdite.
C’est en substance ce qui a été dit par M. Galland, lors du débat sur cette proposition de Loi à l’Assemblée nationale : « la proposition de loi, dit-il, serait en contradiction avec nos engagements européens qui prévoient très clairement qu’il est interdit - et ce qui est vrai pour nous l’est pour les autres, nous y trouvons donc un intérêt direct - aux banques centrales des États membres d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. Un prêt de la Banque centrale au Fonds de développement économique et social entrerait évidemment dans le champ de cette interdiction ».
C. La mobilisation populaire
Parce qu’elles sont la clef de notre avenir, on ne peut plus laisser les questions monétaires entre les mains des seuls spécialistes. Le pouvoir politique et économique ne peut se concevoir sans pouvoir monétaire. Les populations peuvent et doivent comprendre à quel point leur souveraineté implique le contrôle du crédit et de la monnaie.
1°) Les enjeux.
La monnaie représente une dette dont l’État est en dernier ressort le garant. Le meilleur moyen d’assurer que cette dette sera honorée, donc d’assurer la valeur de la monnaie, est d’en contrôler l’émission et la gestion.
Les nouvelles émissions doivent se faire sous forme de crédits d’investissement qui augmentent la capacité productive de l’économie, c’est-à-dire sa capacité à produire avec le minimum d’efforts le maximum de travail.
Le privilège d’émettre la monnaie et de gérer la masse monétaire revient ainsi de plein droit aux autorités nationales. Comment en effet garantir la valeur d’une monnaie sans aucun regard sur la façon dont elle est utilisée ? C’est pourtant ce qu’implique le traité de Maastricht et l’autonomie de la Banque de France. Si les profits des établissements financiers restent privés, l’État - donc les contribuables - reste, en cas de perte, garant de la dette.
Les pouvoirs publics sont comme le chamelier qui doit garantir que la gourde soit toujours bien remplie d’eau fraîche alors qu’on a percé un trou béant par où elle est récupérée.
Les progrès actuels dans la transmission de l’information (monnaie électronique) et le fait que la création monétaire soit réduite à un jeu d’écriture informatique donne à l’instrument monétaire une efficacité, pour le bien ou pour le mal, d’autant plus redoutable.
Le pouvoir légal libératoire que les autorités publiques confèrent à la monnaie leur donne une obligation d’autant plus pressante de veiller à sa valeur. Plus on attendra, plus la facture à payer sous forme de dettes irrécouvrables sera importante.
Les intérêts financiers ne sont pas prêts, on le comprendra, à renoncer à ce privilège. La bataille est à l’échelle de l’enjeu : qui contrôlera l’économie mondiale au XXIème siècle, et pour quoi faire ? "
2°) Dire la vérité.
Comment les populations peuvent-elles, au travers des gouvernements "représentatifs qu’elles se donnent ou se donneront, reprendre en main le levier monétaire de l’économie abandonné aux « lois du marché » ?
La mobilisation se fera autour d’idées forces, simples sans être simplistes :
- Nous sommes dans une situation extrêmement grave. L’état réel de l’économie et les vrais enjeux sont restés cachés jusqu’alors. Le champ économique a été abandonné aux mains d’ « experts » en statistiques comptables plus soucieux de leur carrière que de la vérité. Il est temps d’expliquer les tenants et aboutissants de la crise actuelle.
- Il y a eu un démantèlement volontaire et systématique de l’environnement économique international depuis trente ans, notamment depuis la fin du système de Bretton Woods en 1971. Le traité de Maastricht est la suite logique d’une série de dérives. Des intérêts privés se sont attachés à faire perdre aux États le contrôle du crédit productif et donc de leur économie.
- La déréglementation de l’économie mondiale a pour but de faire lâcher prise aux nations, afin qu’elles abandonnent leurs prérogatives régaliennes (politique monétaire, politique de crédit, politique industrielle). Au principe fondateur de notre Constitution établi dans son article premier : gouvernement « par le peuple, avec le peuple, pour le peuple », l’on veut substituer un non-gouvernement « par les marchés, avec les marchés, pour les marchés ».
- Maintenant que les populations et les États sont en voie d’être dépossédés de la réalité de leurs pouvoirs, les prémisses d’une nouvelle organisation mondiale se mettent en place (ONU, FMI, OMC, Banque mondiale, etc.). Cette nouvelle organisation n’est plus basée sur la volonté commune des populations. Elle remet en cause, sous guise de mondialisation, la souveraineté militaire (capacité de défendre son territoire contre un ennemi quelconque), et économique (capacité de subvenir à ses propres besoins en produisant par soi-même ou en assurant la sécurité de ses approvisionnements extérieurs).
- Parce qu’elle est à la source de la force militaire et économique, c’est en dernière instance la capacité de production industrielle en profondeur que l’on cherche à atteindre. C’est le but de la société « postindustrielle », concept popularisé dans les années 70 par une série d’ouvrages et d’articles qui ont accompagné le mouvement de déréglementation financière.
- Or toute puissance industrielle nationale doit sa force à sa capacité d’investissement productif. A la base de toute indépendance, la clef de l’industrialisation en profondeur dérive de la capacité à orienter l’argent là où les pouvoirs publics l’estiment nécessaire.
Les intérêts financiers en sont persuadés. C’est la raison pour laquelle ils ont démantelé le système de Bretton Woods, prenant le contrôle du crédit international au travers des euromarchés, puis peu à peu des systèmes de crédits nationaux.
Source du pouvoir économique et politique, le crédit a été la cible prioritaire des ennemis de l’État-nation. C’est lui qu’il faut reconquérir en premier lieu.
- La remise en cause de l’ordre économique dominant équivaut dans les conditions actuelles à une déclaration de guerre. Le gouvernement devra éventuellement prendre des mesures de temps de guerre (contrôle des changes, contrôle des banques affiliées à ces intérêts). Les hostilités ont de toute façon déjà commencé. Cette guerre a déjà fait en France plus de trois millions de chômeurs. Il faut la mener et la gagner comme telle, le plus rapidement possible.
D. La relance par le crédit productif : nos propositions
En faisant a contrario d’un nouveau traité de Maastricht et d’une Banque de France réformée les instruments d’un grand dessein économique, nous passons de la défensive à l’offensive.
Nous avons besoin :
- d’un traité européen en remplacement de Maastricht, qui fixe les impératifs de croissance physique de l’économie ;
- de banques nationales pour financer les investissements physiques ; ce sera le nouveau rôle d’une Banque de la France.
Nous résorberons, au passage, l’inflation et les déficits.
1°) La transformation de monnaie en capital.
Le principe de transformation de la monnaie en capital est donné ici à travers l’exemple de la société BTP, entreprise de travaux publics.
Supposons que l’entreprise BTP veuille construire un barrage hydro-électrique. Elle ne dispose pas des fonds nécessaires. Elle s’adresse à sa banque, la BNP. Celle-ci vérifie si le projet de barrage en question fait partie des domaines prioritaires privilégiés par le gouvernement. Dans l’affirmative, la BNP va faire une offre de crédit à l’entreprise de travaux publics au taux de 5% sur vingt ans. La BNP sait que la moitié de la somme prêtée pourra faire l’objet d’un escompte ou d’une mobilisation auprès de la Banque nationale, au taux de 2%.
La Banque nationale avance les fonds en créant de la monnaie : elle anticipe, par un simple jeu d’écriture l’argent nécessaire à la construction du barrage.
Cet argent est utilisé pour payer les salaires, les fournisseurs, etc., et même s’il a été créé ex-nihilo, il donne lieu à travers le barrage à une réalisation tangible.
Une fois le barrage construit, la société BTP va pouvoir, dans notre cas d’école, vendre de l’électricité, et faire payer ses services concernant l’aménagement de l’eau. Elle pourra éventuellement recevoir de l’État des subventions d’exploitation en compensation de l’augmentation de la base fiscale qu’il aura induite (par l’installation d’entreprises consommatrices d’énergie à proximité). Avec les recettes correspondantes, elle pourra rembourser les échéances de l’emprunt à la BNP. Celle-ci à son tour remboursera ou paiera la banque nationale.
Quand le crédit a été totalement remboursé, la monnaie créée initialement se trouve détruite. Elle se sera transformée, entre-temps, en capital : capital physique à l’actif du bilan ; capital financier si l’entreprise BTP décide d’émettre des obligations pour rembourser son emprunt par anticipation.
La masse monétaire d’une économie à un instant donné correspond ainsi à l’ensemble des crédits en cours sur l’économie (créances sur le Trésor et créances sur les autres acteurs économiques) en plus de la contrepartie des détentions en devises et en or.
L’augmentation nette de la masse monétaire correspond donc à l’augmentation de l’encours des crédits sur l’économie. Plus cette économie est développée, plus les immobilisations physiques (équipements, machines, etc.) sont importantes (grande valeur ajoutée), et plus le flux : de crédits nécessaires à leur maintenance et à leur modernisation est important. Il y a donc - ou plutôt il devrait y avoir - un rapport direct entre la masse monétaire d’une économie et sa densité énergétique et technologique.
2°) La procédure à suivre.
Les propositions qui suivent visent à faire passer dans les textes cette notion de transformation de monnaie en capital. [6]
La procédure est la suivante : le Trésor émet de la monnaie et celle-ci est ensuite placée à la Banque nationale. Elle n’est pas utilisée pour des dépenses courantes ni utilisée en tant que telle par le gouvernement. Placée à la Banque, elle est prêtée. Le gouvernement prête l’argent qu’il a lui-même créé.
La monnaie créée est orientée dans deux directions :
- Prêts au secteur privé :
Une partie est prêtée (au sein de prêts mixtes argent public-argent privé) à des compagnies privées pour des investissements productifs servant à bâtir le tissu économique.
Comme il est défini dans le projet de loi ci-dessous, les banques commerciales ne pourront se financer auprès de la banque nationale qu’en faisant état d’un contrat de prêt d’un emprunteur potentiel pour un projet productif. Prenons l’exemple d’une aciérie. La banque nationale fournirait 50% du prêt demandé à la banque commerciale, en chargeant un intérêt de 2 à 4%. La banque commerciale devrait fournir le restant à partir de ses dépôts et prêter le total à la société sidérurgique à un taux d’intérêt régulé et bas, entre 4 et 6%.
- Prêts au secteur public
Une autre partie, la plus importante jusqu’à 60%), est prêtée à bas taux d’intérêt à des agences publiques ou parapubliques, au gouvernement, à des entreprises publiques, à des entreprises sous concession, etc.
Ces entreprises publiques utilisent l’argent pour créer de la richesse sous forme d’infrastructures. Les agences nationales ou régionales qui reçoivent ces prêts sont comme des maîtres d’œuvre, qui empruntent à la Banque de France à 2%, sur une durée de 10 à 20 ans.
On créé ainsi non pas une dette gouvernementale, mais une dette d’agence gouvernementale. L’établissement qui emprunte contribue à une production réelle dans l’économie physique, son endettement est adossé à des actifs d’exploitation physiques qui sont créés suite à l’emprunt. A terme, un tel actif vaut plus que la dette nette.
L’agence qui emprunte - par exemple une agence chargée de construire des projets d’aménagement de l’eau (comme le CNR pour le canal Rhin-Rhône) - a un statut public au niveau national ou régional. Ce peut être une agence locale passant généralement une convention avec l’État.
- La transformation de la dette en capital :
Sur la base du prêt initial de la Banque nationale, ces agences pourront obtenir d’autres crédits additionnels de prêteurs privés. Elles pourront également émettre des obligations. L’émission d’obligations sera de fait la capitalisation de la dette accumulée correspondant aux prêts de construction.
En vendant des obligations de la nouvelle agence publique au secteur privé, l’agence peut rembourser à l’État les sommes de l’investissement initial. L’agence peut alors être privatisée en partie, suite à la vente de ses obligations.
Revenons à l’exemple de la CNR. L’État prend le projet en charge et lance la construction. Une fois la construction achevée, un endettement obligataire est créée sur la CNR qui continue à fonctionner en tant qu’établissement nationalisé, avec une dette obligataire. Le gouvernement peut conserver la partie Trésor des obligations émises jusqu’à ce que les obligations soient vendues une à une. L’État payé initialement en obligations distribue en fait progressivement ces obligations vers le public.
Cette dette d’agence publique sera payée par deux types de revenus. Il y aura tout d’abord un repaiement provenant de la part d’impôt local ou régional qui revient éventuellement à l’agence publique. Une autre partie viendra de son revenu propre (droits de passages, recettes liées à l’aménagement de l’eau).
Cependant, dans tous les cas nous aurons un mélange de revenus d’exploitation et de subventions gouvernementales. Du revenu total encaissé par l’établissement une partie sera utilisée pour payer l’intérêt des prêts à 2% de la Banque nationale.
Ainsi, plutôt que de créer une dette publique sur les revenus courants du budget de l’État, plutôt que de taxer les revenus courants, comme c’est le cas avec les banques centrales actuelles, nous créons une dette sur un établissement économique productif public, à l’échelle nationale ou locale.
Pour cela, l’on doit avoir une économie réglementée : une régulation monétaire, financière et bancaire. Les tarifs doivent être réglementés. Le commerce doit être réglementé. En bref, l’économie doit être dirigée.
De tels investissements à partir d’une monnaie créée au niveau national, particulièrement s’ils intègrent le progrès technologique favorisant l’intensité capitalistique et l’intensité énergétique, amèneront le plein emploi, une prospérité relative, et une croissance économique continue. Et cela ne causera aucune dette d’État, exceptée la dette résultant des créances sur l’État qui soutiennent la monnaie. Si la monnaie est proprement investie, il n’y aura pas de problème à cet égard.
3°) Notre proposition pour la France et pour l’Europe.
- 300 milliards de francs par an de crédits productifs.
Un montant d’environ 40 milliards d’euros (300 milliards de francs) par an [7]
- Création d’un nouvel euro.
-
- Le nouveau Traité européen engagera les pays signataires sur une base commune d’émission de crédit productif, qui pourrait être le garant d’une monnaie européenne, un nouvel euro. La faculté d’émettre des euros sera exclusivement réservée aux Banques nationales des pays ayant ratifié le présent traité. Les autres pays membres de l’Union européenne qui n’auront pas signé ce traité conserveront leur monnaie nationale.
- Un nouvel organisme monétaire européen sera créé afin de vérifier que l’émission monétaire en euros des différents adhérents répond bien aux conditions spécifiées au titre IV. L’originalité de cette proposition réside dans le fait que chaque pays reste souverain sur les domaines de financement qu’il veut privilégier. Les bases de l’émission monétaire étant les mêmes dans chaque pays signataire, la valeur de l’euro restera liée à des investissements productifs.
- 1,5 millions d’emplois en cinq ans, le plein emploi à l’horizon 2010.
Des 40 milliards d’euros émis par année, environ un tiers, soit 13 milliards (environ 100 milliards de francs) seront dépensés par le Trésor lui-même pour des projets d’infrastructure menés par des établissements publics nationaux, régionaux ou locaux ou leurs filiales.
L’objectif est de créer 100.000 emplois annuels directs à partir de cet investissement, soit 500.000 emplois en cinq ans dans les secteurs de l’aménagement de l’eau, de la production et la distribution d’énergie, le transport, l’infrastructure urbaine, la construction et la réhabilitation des hôpitaux et des écoles, etc.
Les 40 milliards d’euros de création monétaire donneront lieu en vertu du multiplicateur de crédit à l’octroi de crédits par le réseau bancaire d’environ 600 milliards d’euros correspondant aux besoins d’investissements et d’achat des différentes entreprises impliquées de près ou de loin dans les projets initiaux.
Cela devrait créer au minimum 200.000 emplois annuels, soit 1 million d’emplois sur cinq ans. L’horizon devrait être le plein emploi vers l’an 2010.
Le Trésor recevra ainsi sous forme de paiement d’impôts et de taxes un montant supérieur à la somme avancée à l’économie.
L’avantage de concentrer tout le crédit de la Banque nationale à une fenêtre d’escompte est que cette fenêtre permet d’escompter aisément de gros montants d’effets de commerce. Ces effets, détenus par les banques en tant que prêts à des entreprises productives, sont des papiers qui représentent une production physique effective de biens et de services, garantissant que le crédit de la nouvelle banque nationale va à la création de richesse productive.
Cela constitue un système de crédit dirigé qu’on a pu appeler « système de crédit à deux étages ». Le secteur privé sera stimulé, mais les entreprises productives plus que les autres. Les entreprises cherchant à emprunter à la banque à des fins productives constateront que la banque leur escomptera facilement ces effets à un taux intéressant. Ceux qui chercheront à emprunter à des fins plus spéculatives constateront que leurs prêts sont escomptés à un taux plus élevé, voire pas du tout.
- Restaurer les réserves légales.
Afin de protéger le système bancaire et de limiter la capacité des banques à prêter et à créer de la monnaie sans contrepartie productive, il est rétabli l’obligation de réserves légales. Les réserves légales qui étaient destinées à assurer la solvabilité de la banque en cas d’impayés sur les prêts, créent une immobilisation financière. La banque n’est pas autorisée à prêter l’argent correspondant avec intérêt. Ces réserves ont progressivement disparu avec la régulation par les taux d’intérêts.
Les banques seront tenues à cette réserve en plus de l’obligation de maintenir 60% de leurs portefeuilles de créances pour des activités physiques productives. Pour chaque pour cent en deçà des 60% exigés, la banque nationale requerrera une réserve additionnelle de 1%, la dissuadant d’accorder des crédits non productifs.
4°) Le texte de la réforme.
La création et la gestion de la masse monétaire au cours des cent dernières années s’est faite d’une façon très empirique. Comme l’écrit M. Gaudemet dans son ouvrage sur les finances publiques : « parce qu’elle découle de mécanismes en partie automatiques et qu’elle se réalise fréquemment en dehors de toute action délibérée, la participation du Trésor à la création de monnaie est généralement mal connue et souvent mal comprise ».
Elle donna lieu à une succession de textes parfois complexes et de pratiques nées des contraintes et des objectifs du moment. Il n’y avait en la matière, jusqu’à l’abandon du système aux marchés, aucun corps de doctrine établi. C’est la raison pour laquelle on est passé aussi facilement d’un système administré à un système de marché. Les textes qui suivent visent à donner une base simple et compréhensible à tous pour le crédit national.
Chaque nation signataire s’engage à réformer son système financier national selon les éléments donnés ici pour la France. Cet engagement commun devrait constituer la base d’un nouveau système de Bretton Woods :
Titre 1 : La Banque de la France est placée sous l’autorité directe du Trésor et est dénommée Banque nationale. Elle continuera à fonctionner sous sa forme et avec ses effectifs actuels.
Titre 2 : Le pouvoir de la Banque nationale d’acheter ou de vendre des bons, des effets et des obligations sera limité aux fonctions suivantes :
- anticiper les revenus fiscaux dans un délai de moins d’un an à partir de la date d’achat des effets mentionnés, de façon à maintenir le flux des dépenses du Trésor ;
- maintenir un marché ordonné des bons, d’effets et d’obligations, et répondre aux besoins temporaires de liquidités de la Banque et des banques privées ;
- acheter des créances sur l’étranger.
Le Trésor n’est pas autorisé à monétiser par création monétaire la dette du gouvernement. Pour s’en assurer, le montant total de bons, de billets et d’obligations gouvernementales détenus par la Banque nationale ne devra pas dépasser un montant fixé à l’avance. La détention de ces effets pourra varier dans l’année mais devra rester identique en fin d’année, à compter du passage de cette loi, excepté en cas de rachat de bons du Trésor par des États étrangers.
Titre 3 : Toute branche de la Banque nationale peut escompter jusqu’à 50% de la valeur nominale des traites, effets et crédits mobilisables intervenus suite à la production de biens tangibles ou à l’amélioration du capital.
Ceci inclut l’achat de matières premières, de biens intermédiaires et de biens d’équipement, la construction d’infrastructures ou l’emploi de main-d’œuvre pour produire et transporter des biens manufacturés, des denrées agricoles et des matériaux de construction ; les frais d’exploitation dans les domaines miniers, industriels et du transport, pour produire et distribuer de l’énergie sous toutes formes ; pour construire et maintenir les infrastructures publiques de communication.
Tous les effets et prêts ne relevant pas des catégories d’achat et d’exploitation définies ci-dessus ne peuvent bénéficier de cet escompte, pas plus que les crédits correspondant à l’échange d’actions, d’obligations et autres titres d’investissement.
Toute branche de la Banque nationale est autorisée à escompter la totalité en valeur des effets à valoir sur l’exportation de biens, ou à hauteur de 50% pour les effets relatifs aux importations de biens rentrant dans l’énumération ci-dessus.
Toute branche de la Banque nationale répondra à toutes les demandes d’escompte ou de participation aux prêts, bons, obligations, effets émis par les banques agréés, après que la Banque nationale ait déterminé que le but du crédit répond bien aux restrictions ci-dessus. Il n’y aura aucune restriction sur ces escomptes.
Titre 4 : Les banques commerciales devront respecter un montant obligatoire de réserves. Ce montant s’appliquera dans le cas où les banques privées maintiennent 60% de leur portefeuille de créances sous la forme de prêts, bons, traites et avances à des emprunteurs créateurs de richesses tangibles, relevant de la liste spécifiée en section 4. A chaque fois que la proportion d’actifs correspondant à une création de biens tangibles descendra en dessous de 60% des actifs totaux, la Banque nationale exigera que les banques concernées placent en réserve un montant additionnel correspondant à 1 % des réserves existantes auprès de la Banque nationale.
Ce règlement s’appliquera avec effet immédiat aux actifs acquis postérieurement à la date de la présente loi. Les actifs acquis antérieurement seront soumis à une loi de réorganisation bancaire, fournissant un délai au terme duquel tous les actifs devront être conformes à cette règle.
E. Le financement de l’économie française de 1947 à 1997 : les leçons à tirer de la disparition du crédit productif
Nous décrivons ici les termes du débat, qui fait rage en France depuis la dernière guerre, entre partisans et opposants du crédit productif.
Les arguments des partisans du crédit productif n’ont sans doute pas été assez forts ni assez convaincants. Les moyens de persuasion des opposants ont été sans doute supérieurs à ce que l’on pouvait attendre.
D’où l’importance de bien comprendre et pouvoir défendre les grands principes exposés dans cette partie, qui devront toujours guider les mesures à prendre.
1°) Le retrait de l’État.
Le crédit productif a été supprimé dans une série de réformes entreprises à partir de la fin des années 60. L’esprit de ces réformes est condensé dans le rapport Marjolin, Wormser, Sadrin commandé en 1968 par M. Maurice Couve de Murville. On y décrit le passage d’une économie de crédit dirigée à une économie financée par les marchés monétaires. Le désengagement progressif de l’État à partir de cette période et jusqu’à aujourd’hui s’est avéré en tous points conforme aux propositions de ce rapport.
A cette époque, le Trésor dictait les conditions du crédit pour ses propres émissions monétaires comme pour celles des autres, notamment à travers le mécanisme de réescompte de la Banque de France, qu’il avait sous son contrôle. Comme l’exprime François Bloch-Lainé, « traditionnellement banquier du budget, le Trésor devint banquier de l’économie ». L’idée sous-jacente est que la monnaie et le crédit doivent être au service du développement économique organisé par l’État.
Plus rien de tel aujourd’hui. L’État emprunteur est un acteur parmi d’autres sur le « marché de l’argent ». En cas de besoin d’argent, le Trésor s’adresse directement « aux marchés » par l’intermédiaire des banquiers spécialistes de valeurs Trésor (SVT). Ces derniers achètent les effets émis par l’État au terme d’adjudications qui se font aux conditions standard du marché monétaire.
Les autres acteurs de l’économie (entreprises, ménages) s’adressent également au marché, notamment aux banques, pour leur financement.
2°) Les banques se voient confier l’essentiel de la création monétaire.
Prêteuses à l’État, prêteuses aux entreprises, les banques sont devenues les principaux émetteurs de crédit à l’économie, donc de la création de monnaie. Cette évolution a été rendue possible notamment par la réforme bancaire de 1966-1967, qui visait à développer le financement privé des investissements (cette réforme lancée et mûrie par Valéry Giscard d’Estaing a permis aux banques de dépôts d’augmenter leurs prêts à long terme et moyen terme, et aux banques d’affaires d’accroître leurs ressources).
Il n’y a plus à ce jour de limites à l’octroi de crédit par les banques [8], si ce n’est la rentabilité de leurs activités de crédit, c’est-à-dire la différence entre le coût des ressources et les recettes de leurs prêts.

La plupart des établissements financiers ont ainsi pu se lancer à partir des années 70 dans des opérations qu’ils estimaient lucratives. Ils ont eu recours au marché monétaire, donnant lieu à création monétaire. Même si la ressource leur coûtait cher, au final le différentiel entre le rapport du prêt et le coût de l’argent restait intéressant.
Les plus importants d’entre eux (Crédit Lyonnais, Société Générale, BNP, etc.) ont participé à des opérations spéculatives de grande ampleur, notamment sur le marché de l’immobilier. Les pertes enregistrées sur ces opérations ne sont pas encore totalement reconnues, tant elles sont importantes. Celles du Crédit Lyonnais ont été successivement évaluées à 50 milliards de francs, puis 70, puis 100, puis 130 ou 150, et l’on parle aujourd’hui de 170 milliards.
Nous avons franchi une nouvelle étape dans les années 90 avec le lancement des produits financiers hautement spéculatifs (produits dérivés) dont la Société Générale est présentement l’un des leaders mondiaux. Les banques cherchent maintenant à financer des opérations à haute rentabilité. Elles veulent renflouer leurs bilans mis à mal par les pertes enregistrées sur les précédents paris spéculatifs (notamment immobiliers) et sur les prêts traditionnels à l’économie réelle.
La seule façon d’assurer des crédits rémunérateurs dans cette situation est de mener des opérations illégales (trafic de drogue ou autre), ou de démanteler le tissu productif, ce qui se passe quand on cherche à comprimer les coûts par tous les moyens (délocalisation, vente d’actifs, obligations pourries, etc.). Il y a un effet d’entraînement pervers.
Dans le même temps, les entreprises productives créatrices de richesse doivent se battre d’arrache-pied pour obtenir un prêt bancaire.
3°) Le chômage est préféré à la réforme du système financier.
La dérive du crédit ne donne pas lieu à inflation pour trois raisons :
- l’augmentation des crédits à but spéculatif est compensée par la baisse des crédits à but physique (provoquant le chômage dans les secteurs productifs) ;
- la masse monétaire spéculative à tendance à tourner sur elle-même dans une série de paris spéculatifs successifs qui ne touchent pas l’économie réelle ;
- au nom de la stabilité monétaire, les autorités préfèrent, dans ce contexte de crédits inflationnistes, l’augmentation du chômage à celle de l’inflation.
Le fonctionnement cancéreux de l’émission de crédit et de la création monétaire correspondante se traduit par une augmentation parallèle et délibérée du chômage.
La monnaie qui circule aujourd’hui représente une part croissante de crédits à court terme et à hauts taux d’intérêts, contrairement à la masse monétaire de l’après-guerre qui correspondait à des crédits à long terme et bas taux d’intérêt.
Les banques dans cette affaire n’ont fait qu’utiliser à fond, bien maladroitement il est vrai pour certaines d’entre elles, la faculté qui leur était donnée par les pouvoirs publics de faire des crédits de tous ordres avec de moins en moins de contrôle.
L’intérêt général exige que l’on rétablisse un système où l’économie puisse s’approvisionner en crédit abondant à bon marché pour des investissements longs.
4°) Maastricht : la camisole de force.
Il fallait, pour imposer le choix du chômage aux gouvernements et aux populations, un instrument particulièrement puissant. Sous le prétexte de lutter contre les déficits, le traité de Maastricht est une machine de guerre contre la croissance de l’Union européenne.
La démarche s’est faite en deux temps : d’abord, inonder les économies industrielles de crédits improductifs générateurs de déficit et d’inflation ; ensuite, les obliger à couper leur investissement, donc à casser leur croissance, au nom de la réduction du déficit et de l’inflation.
L’émission anarchique de crédits improductifs, cause ultime du déficit et de l’inflation, n’est jamais relevée par les attendus, pas plus que le transfert du pouvoir d’émission de crédit des autorités nationales à des intérêts privés. Les textes actuels s’attaquent aux symptômes sans jamais envisager la cause.
En interdisant le financement monétaire des déficits publics, Maastricht interdit certes les mauvais financements sources d’accroissement de la dette, mais aussi les bons financements, susceptibles de dégager les ressources nécessaires à la résorption de la dette. En jetant le crédit, Maastricht jette donc le bébé avec l’eau du bain.
En conclusion, Maastricht n’a jamais été conçu pour lutter contre les déficits ou l’inflation comme il est prétendu. C’est une arme de guerre contre l’Europe et elle s’avère efficace.
- Le déficit, comme tout crédit, peut être productif.
La façon dont le déficit est envisagé par les autorités publiques est révélatrice du basculement des années 70 évoqué plus haut, qui a vu le retrait de l’État. Dans les années 60, on n’a pas peur du déficit et il y en a peu. Avec Maastricht, le déficit est devenu un épouvantail et l’on se montre toujours incapable de le résorber.
Les déficits, au même titre que les autres crédits, peuvent en effet être productifs ou non. Dans les années 50, l’État finançait une large partie de ces investissements en créant un déficit, suivant la théorie de l’impasse budgétaire.
L’État prenait alors en charge 70% de l’investissement de l’économie, le chiffre est inversé dans les années 70 où l’investissement est pris à 90% en charge par les banques commerciales sur des critères de rentabilité privés.
Le compte budgétaire spécial du FDES, qui a permis de financer les grands travaux de reconstruction de l’après-guerre, était ainsi largement financé par le déficit budgétaire. D’années en années, les recettes générées par ces investissements faisaient plus que résorber les déficits correspondants.
Les déficits des années 60 étaient ainsi volontaires et temporaires. On s’efforçait parallèlement de mobiliser l’épargne à des fins d’investissement productif.
Les déficits des années 70-80 représentent surtout un excès des dépenses courantes sur les recettes courantes. La mauvaise orientation des crédits a fait rentrer l’économie dans une phase de contraction physique, qui s’est traduite par une moindre croissance des rentrées fiscales.
Les nombreuses entreprises qui se sont créées dans le domaine des services - conçues en tant que telles et non plus comme services à une économie physique - n’ont pas compensé le manque à gagner sur l’économie physique.
- Devenus incapables de générer la croissance, les pouvoirs publics gèrent administrativement la décroissance et tombent dans les filets de Maastricht.
Sans capacité de crédit productif, l’État perdait l’essentiel de son pouvoir de direction de l’économie. Il a dès lors essayé de lutter contre les symptômes de la crise qui en a résulté, avec un regain d’interventionnisme. D’instigateur de la création de richesse au niveau national, il est devenu pompier social : une bonne partie de ses dépenses est devenue improductive : indemnités de chômage, traitement social, aides à la reconversion, etc.
Étant donné l’ampleur de la crise, les autorités publiques ont repris en main des pans entiers de l’économie (nationalisations de 1981), ce qui n’est pas leur rôle. Les adversaires de l’intervention de l’État dans l’économie, dont les thèses sont pourtant à l’origine des problèmes actuels, ont eu alors beau jeu de dénoncer le « tout État » et de demander son retrait de la vie économique.
L’État s’est parallèlement adapté à la dérive du système financier international, faute d’avoir tenté de l’empêcher. La politique de bonification des taux d’intérêts dans les années 80 a ainsi coûté fort cher. Elle avait pour but d’amortir la hausse brutale des taux d’intérêts imposée par la Réserve fédérale américaine.
Durant toutes ces années, une partie des déficits a été comblée par des emprunts publics, puis sur les marchés internationaux [9] (emprunts Barre, notamment), avec ultérieurement rémission d’obligations à long terme, ce qui est très coûteux dans le temps.
De la sorte, des déficits improductifs ont été comblés par des emprunts à leur tour improductifs, venant alourdir les déficits. Le dérapage vertigineux auquel pouvait aboutir ce cumul de dettes (on emprunte pour combler les trous, augmentant encore les déficits à venir, sans création de richesses), devait donner lieu au coup de rein imposé par les mesures de Maastricht.
- Reprendre la direction de l’économie.
En se réappropriant les prérogatives essentielles relatives au crédit et son orientation, l’État n’aura plus besoin d’intervenir à tout bout de champ pour tenter de colmater les brèches (forte inflation, chômage, endettement, etc.) dues à une utilisation abusive du crédit.
La croissance physique résultant d’investissements productifs génère en effet des recettes supplémentaires et diminue les dépenses improductives liées au sous-emploi et à la crise. L’État et ses services en sont allégés d’autant. Il peut se concentrer sur sa mission essentielle : l’éducation, la santé publique, la recherche, les équipements lourds ; en même temps qu’inciter, rassembler les énergies, donner vie à un grand dessein national.
5°) Les deux principes du crédit productif.
Premier principe : le profit individuel doit correspondre à une production ou un service utile collectivement.
Les profits réalisés par les différents acteurs de l’économie sont, dans une économie saine, le résultat d’activités productives conformes à l’intérêt général de l’économie physique.
La tâche du législateur consiste dans ce contexte à faire coïncider l’intérêt privé avec l’intérêt général. C’est aux pouvoirs publics, et non à la profession bancaire, de juger de l’opportunité et de la rentabilité d’investissements qui ont une portée collective. L’État initie les crédits à finalité collective, fait participer les banques privées et contrôle. Cela n’empêche pas, au contraire, de rémunérer salariés et actionnaires à un niveau raisonnable.
Les théories d’Adam Smith et de l’école libérale en général défendent une thèse rigoureusement inverse. Adam Smith ne voit rien de bon dans l’intervention de l’État au nom de l’intérêt public.
Les lois qui régissent actuellement l’allocation de la monnaie suivent strictement cette orientation ultralibérale : les fonds iront se placer là où cela leur rapporte le plus.
Comme nous l’a affirmé M. Tardignac, de l’OFCE, pour qui la création monétaire n’existe pas, « la frontière entre la monnaie et les actifs financiers n’existe plus. Tout est rémunéré. Soit une activité est financièrement rentable, soit elle ne l’est pas ».
Rappelons donc ici que la rentabilité du capital n’est en aucun cas le seul critère à retenir ; la somme des profits financiers individuels ne fait pas le profit global physique de l’économie, bien au contraire. Le placement dans une entreprise de trafic de drogue peut s’avérer hautement rentable (profit local), il en résultera néanmoins une perte sèche pour la société (perte globale). S’il est évident que celui qui place son argent dans un fonds en attend un retour, il ne l’est pas moins que la nature de ce placement aura des conséquences pour l’économie dans son ensemble.
D’où la nécessité de développer une science de l’investissement public.
Deuxième principe : pour être productif, un investissement doit augmenter la rentabilité globale du tissu économique.
Les investissements de l’État doivent se concentrer sur les secteurs à même d’augmenter la productivité du tissu économique. Il faut pouvoir satisfaire à moindre coût aux besoins intérieurs et accroître la compétitivité à l’exportation.
Ce type d’investissement productif n’est pas inflationniste parce qu’il augmente les capacités de l’appareil productif (moindre risque de tension de l’appareil productif) et ses performances (rapport qualité/prix). Les percées technologiques permettent à effort égal ou moindre de produire mieux et plus.
C’est cette vision dynamique investissement-progrès technologique-augmentation de la productivité, qu’il faut réintroduire dans la pensée économique et dans l’économie publique. Les missions de productivité envoyées aux États- Unis dans le cadre du plan Marshall n’avaient pas d’autre but. De même, le général de Gaulle donne résolument la priorité à la modernisation de l’économie française, pour accroître sa productivité, dans la réforme de 1958.
Les différents entretiens que nous avons eus avec des responsables de la Banque de France et du Trésor confirment que les modèles économétriques aujourd’hui en vigueur (au Trésor, à la Banque de France, à l’INSEE et ailleurs) ont complètement écarté cette donnée. Ils n’intègrent pas l’augmentation de productivité dans leurs calculs.
Ne tenant compte ni de l’augmentation de la capacité de production ni de la productivité, les spécialistes qui font tourner ces modèles en viennent à dissuader l’État d’investir.
Leur raisonnement est le suivant : un investissement de l’État (comme l’envisage Keynes) crée une demande sous forme d’investissements publics. Si l’appareil de production ne fonctionne pas à plein, cela peut donner lieu à une certaine reprise et à de l’embauche. Il y a cependant des fuites : la demande de l’État va se traduire par des importations puisque l’économie est ouverte. Les importations seront d’autant plus importantes que l’appareil de production sera à pleine capacité. Cela relancera l’inflation et neutralisera les bénéfices de l’investissement. Ces arguments sont avancés pour expliquer l’échec relatif des plans de relance keynésiens au cours de ces dix dernières années.
De fait, il y a des domaines où l’investissement entraîne des importations. A titre d’exemple, pour produire plus de biens d’équipements, nous avons besoin de machines-outils ; or, nous n’avons pratiquement plus d’industrie de machines-outils en France (à part dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique).
Une liste des goulets d’étranglement de notre économie devra ainsi être établie avec les mesures à prendre :
- secteurs où il faut rebâtir d’urgence une capacité de production nationale ;
- secteurs où il faut faire des partenariats avec un pays dont l’économie apporte des atouts complémentaires (France/ Allemagne, par exemple).
Quant aux biens de consommation qui sont importés des pays à main-d’œuvre bon marché, nous pouvons au moins en partie les produire nous-mêmes en :
- accroissant notre productivité avec un savoir-faire technologique supérieur ;
- aidant les pays exportateurs, qui sont généralement des PVD où la plupart des équipements essentiels font défaut, à concentrer leur effort productif sur l’approvisionnement de leur propre marché plutôt que sur l’exportation de produits basés sur l’exploitation de la main-d’œuvre. On combinera les exportations d’équipements et les mesures douanières sélectives pour limiter les importations incluant de la main-d’œuvre à bon marché. Cela devrait permettre de redonner vie à certains secteurs sinistrés de notre économie et d’équiper les PVD qui en ont le plus grand besoin.
VI. Changer les règles du jeu internationales
A. Les mesures d’urgence :
Nous l’avons établi, le système monétaire et financier international se trouve en état de faillite virtuelle et atteint son point de rupture. L’implosion monétaire et financière sera, lorsqu’elle se produira, extrêmement brutale et changera les règles du jeu. Les mesures que nous proposons visent à éviter que l’économie productive ne soit affectée par cette implosion. Elles paraissent très novatrices ; cependant, ce qui paraît aujourd’hui inconcevable aux dirigeants en place devra être rapidement mis en œuvre.
Il faut sans attendre :
1°) Taxer les flux spéculatifs.
La France doit se battre pour que soit adoptée une taxe d’au moins 0,2% sur toutes les transactions financières à caractère spéculatif. Outre qu’elle permettra de faire rentrer des fonds dans les caisses de l’État, cette mesure obligera les spéculateurs à s’identifier ; elle alourdira tant financièrement qu’administrativement leurs opérations. A ceux qui affirment qu’une telle taxation aurait un effet immédiat sur les Bourses et risquerait de provoquer une chute brutale des cours, avec risque d’implosion du système, on peut répondre deux choses. D’une part, cette taxation doit être décidée dans un nombre de pays aussi élevé que possible, afin que joue l’effet de protection mutuelle par la masse. D’autre part, que cette taxe soit appliquée ou non, le système est condamné, par sa propre logique, à imploser. La taxe est une manière d’en limiter temporairement les conséquences néfastes, avant que la nécessaire mise en règlement judiciaire soit entamée.
2°) Organiser une procédure internationale de mise en règlement judiciaire.
Il faudra alors procéder à une réorganisation en bon ordre du système financier en le mettant en règlement judiciaire. Comme dans le règlement judiciaire d’une entreprise, il s’agit d’arrêter le processus d’endettement et de faire un tri entre les dettes. Il y a les dettes correspondant au fonctionnement réel d’une entreprise productive, qu’il faudra ré échelonner et étaler afin d’éviter un processus de faillites en chaîne. Il y a ensuite les dettes qui correspondent à des crédits spéculatifs ou improductifs qui ne seront pas remboursées. Les faillites que cela déclenchera toucheront essentiellement des entreprises dont l’apport à la contribution de richesse est minime.
3°) Reconstituer simultanément les masses monétaires par l’investissement productif.
L’effet dépressif de ce choc systémique sera d’autant plus atténué qu’en même temps seront coordonnés les investissements productifs décrits dans les propositions du chapitre précédent. Une vague de nouveaux emplois productifs viendra rapidement résorber la vague de licenciements pour faillites ou pour motif économique.
4°) De nouvelles règles monétaires et commerciales.
Dans l’environnement assaini qui sera ainsi créé, il faudra établir des nouvelles règles :
- sur le plan financier : un nouveau Bretton Woods.
Les nations volontaires devront rétablir un nouveau système de Bretton Woods, établissant le retour à des parités fixes et à la référence à un étalon non monétaire (en principe l’or). On veillera particulièrement à ce qu’aucune monnaie ne prenne le pas sur les autres en devenant monnaie de réserve.
- sur le plan commercial : remplacer l’OMC.
Les accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux devront remplacer l’OMC actuelle, afin de laisser aux pays de niveaux de développement différents la possibilité d’un certain protectionnisme, qu’ils puissent développer par eux-mêmes une base industrielle. Le libre-échange absolu n’est que la liberté du renard dans le poulailler ; il faut lui substituer la perspective de marchés organisés par accords mutuels entre États.
B. Le grand dessein : l’Europe moteur du codéveloppement et continental
Les moyens de transport et de communication modernes ne nous permettent plus d’ignorer le sort des pays proches ou éloignés qui sont encore sous-développés.
Les XIXème et XXème siècles ont vu le développement de la vie en commun au sein des nations républicaines. Le XXIème siècle verra l’entente entre des nations, pour former une sorte de République de nations.
Il y a cent ans, il était inconcevable d’envisager le développement de la France en laissant en arrière la Bretagne ou la Corse. Il en sera de même à l’échelle des continents : on ne peut laisser des régions entières du globe s’enfoncer dans une crise sans fin. Pour autant que les nations développées ne fassent rien pour contrer cette dérive, comme c’est le cas actuellement, elles en seront les victimes à leur tour.
La solution au chômage et à la crise en France passe donc ultimement par un grand dessein européen pour développer l’Est et le Sud. C’est ce qu’exige la période actuelle.
1°) L’ère des Ponts terrestres.
Les conceptions qui suivent sont actuellement développées par le gouvernement chinois et intégrées dans la planification à long terme de ce pays (voir notre dossier sur le Pont terrestre eurasiatique, nouvel horizon industriel de l’Atlantique à la mer de Chine). Même si aucun média occidental ne l’a évoqué, cette nouvelle politique basée sur la coopération des nations le long du Pont continental eurasiatique offre une alternative de grande ampleur à la mondialisation (voir encadré). Le projet de Pont terrestre met l’accent sur la coopération plutôt que la compétition, alors que la mondialisation met l’accent sur la compétition plutôt que la coopération. Étant donné que les trois quarts de la population humaine vivent sur les territoires du Pont eurasiatique, il serait irresponsable de n’en pas tenir compte. D’autant plus que la politique chinoise, basée sur l’investissement productif, est en matière d’investissement à l’opposé de la politique européenne.
La civilisation moderne s’est développée en deux grandes ères, affirme M. Rui Xingwen, le Président de la Commission chinoise au développement et à la promotion du nouveau Pont continental eurasiatique. L’ère des fleuves et l’ère maritime se sont succédés jusqu’au XIXème siècle. A la fin du siècle dernier, le chemin de fer a permis le développement de nouvelles étendues continentales (conquête de l’Ouest aux États-Unis, conquête de l’Est avec le transsibérien en Russie). Depuis lors, très peu a été fait pour désenclaver les masses continentales qui constituent pourtant l’essentiel de la surface terrestre. La troisième ère du développement économique, l’ère du Pont continental, n’en est donc qu’à ses débuts. Cette ère verra à la fois la conquête du système solaire (industrialisation de la Lune et de Mars) et le véritable peuplement du globe, qui passera de 6 milliards d’habitants aujourd’hui à plusieurs dizaines de milliards.
- L’ère des fleuves et des cours d’eau.
Les conditions naturelles offertes par les fleuves et rivières pour l’énergie, le transport et les échanges culturels, ont permis un premier développement de l’espèce humaine le long des cours d’eau. La civilisation égyptienne, par exemple, a atteint très tôt des sommets en raison notamment des conditions naturelles exceptionnelles offertes par le Nil. Cette première ère, qui continue encore aujourd’hui, a vu bâtir de grandes capitales (Paris sur la Seine, Londres sur la Tamise, Lyon sur le Rhône, Moscou sur la Moskva, Prague sur la Vlatva, Budapest sur la Duna, etc.).
- L’ère maritime.
L’ère maritime apparaît ensuite avec les grands échanges de la Renaissance. Les villes se développent le long des fleuves toujours mais plus à leur embouchure, à la conjonction de la terre et de la mer. La mer offre des étendues sans obstacles qui permettent de relier plus facilement les points du globe que par la terre. La Méditerranée a été emblématique de ce type d’échange. Elle a constitué à partir de l’Égypte (via la Grèce) le principal point d’ancrage de la civilisation moderne, avec le rayonnement de ses grands ports : Athènes, Alexandrie, Marseille, Beyrouth, etc.
Dans ces deux civilisations, le milieu naturel -l’eau des fleuves et de la mer - est utilisée pour produire et échanger.
- L’ère des Ponts terrestres.
Dans la civilisation du Pont terrestre, les conditions du développement économique auparavant offertes par le milieu naturel sont reconstituées de main d’homme.
Les technologies modernes permettent non seulement de créer des vrais fleuves artificiels (en dessalant l’eau de mer et en la pompant), mais aussi des voies terrestres nouvelles équivalentes aux fleuves, à l’image des voies ouvertes par les chemins de fer au XIXème siècle.
Construites autour d’une architecture de transport (voies ferrées rapides, voies magnétiques), et d’énergie (oléoducs, gazoducs, énergie nucléaire), de nouveaux axes de pénétration continentales ou corridors de développement permettront notamment de mettre en exploitation les ressources naturelles nombreuses que recèlent des régions souvent inhospitalières ou enclavées (Sibérie, Afrique, Asie centrale) et mettront en relation par les voies intérieures plutôt que maritimes des régions qui jusque là communiquaient essentiellement par la mer. Ces axes de développement d’un bord à l’autre des continents seront comme autant de lignes de production et d’assemblage, à l’échelle continentale cette fois.
Il ne s’agit pas ici de se substituer à ces pays pour produire ce qu’ils pourraient produire eux-mêmes, mais de leur donner les moyens de produire par eux-mêmes. Les besoins et l’ampleur internationale des projets sont tels qu’un levier technologique est nécessaire. Les ressources en hommes et en équipements des pays en question ne sont pas suffisantes pour produire en amont les biens d’équipements nécessaires. Nous songeons ici particulièrement aux deux secteurs évoqués plus haut :
- Au cœur de l’application industrielle des nouvelles recherches et des nouvelles technologies, les machines-outils, les machines qui fabriquent des machines, conditionnent les productions en aval. En substituant à un principe de production un autre plus efficace (par exemple, découpe par laser au lieu de découpe traditionnelle), on affecte toute l’économie.
- Infrastructures : il faut apporter le savoir-faire et les capacités de production en série nécessaires à des équipements de grande ampleur.
2°) Le Triangle productif européen.
Seule l’Europe et surtout son cœur productif (la région située entre Paris, Berlin et Vienne) est en mesure de procurer et d’exporter en quantité et en qualité suffisante les biens d’équipements correspondants à ces deux secteurs stratégiques.
Au centre de l’effort européen, l’alliance franco-allemande présente les caractéristiques de puissance industrielle et de complémentarité requise, la France avec son savoir-faire en matière d’infrastructures ; l’Allemagne avec son savoir-faire en matière de machines-outils.
La conception d’un Triangle productif européen (Paris-Berlin-Vienne) implique aussi une nouvelle vision de l’Europe et de la France, avec une autre forme d’organisation économique.
Il ne peut être question de développer les capacités d’exportation requises en Europe avec l’infrastructure actuelle : c’est pourquoi le projet de Triangle productif est avant tout un projet de réseaux de transport modernes permettant de relier un quelconque point du Triangle en trois heures pour les passagers et en 48 heures porte à porte pour les marchandises.
Au sein même des villes existantes, de grands travaux sont à prévoir notamment en sous-sol pour les transits.
Le déclin économique en France s’est traduit paradoxalement par un afflux accru vers l’agglomération parisienne et les grandes agglomérations pour les personnes en quête d’emploi.
Outre la conception architecturale déplorable des villes nouvelles, la période a voulu qu’elles restent en grande partie des villes dortoirs en marge de l’agglomération parisienne. Il faut en particulier, pour la France, revoir de fond en comble l’aménagement de l’agglomération parisienne et, plus généralement, le développement des villes. On atteint actuellement un point critique où le nombre d’heures perdues dans les transits inter et périurbains devient insupportable pour la population et l’économie.
La densité de population et de transport ne doit en aucun cas être synonyme de mauvaise qualité de vie. A une exceptionnelle densité démographique, l’Allemagne allie par exemple un aménagement homogène du territoire.
Comme tout plan vigoureux de construction et de reconstruction économique, le plan de relance par le crédit productif évoqué au long de ce rapport repose sur la libre adhésion de chaque nation au dessein commun. Il implique une mobilisation populaire. Des décisions importantes qui doivent être prises souverainement. D’où la nécessité d’un double référendum, pour rejeter la logique destructrice de Maastricht et adopter dans la foulée la logique productive du Pont terrestre.
VII. Conclusion
Nous avons vu, tout au long de notre démarche, que la question d’un plan de relance par le crédit productif et de la transformation de la monnaie en capital n’est pas une question technique mais implique - comme nous l’avons dit dans notre introduction - un choix de société.
A une société malthusienne et fondée sur le court terme, comme celle dans laquelle nous vivons, doit succéder une société fondée sur l’homme producteur, pensant en termes d’un horizon long : le développement de l’Est et du Sud, l’espace, les révolutions technologiques à venir (fusion thermonucléaire, supraconductivité, lasers et faisceaux de particules, informatique ...). L’argent qui y est investi est « payé en retour » par les retombées de productivité qu’elles engendrent.
Nous devons retrouver une pensée procédant par hypothèses, c’est-à-dire par innovations, et non par simple extrapolation de données du passé, par déduction ou par induction. En ce sens, l’émission de monnaie et de crédit doit être ce qui prépare le type de société à laquelle on désire parvenir ; ce que Louis Armand appelait un « pari sur l’avenir ».
La France doit s’inscrire dans cette conception, suivant laquelle le présent est défini par l’avenir, et non l’inverse : une France « aux frontières », décollant à partir de ses acquis et non repliée sur eux.
Pasteur, dans son discours à l’Académie française du 27 avril 1882, décrivait le pouvoir du mot « enthousiasme », qui en grec veut dire « dieu intérieur ». Puisse ce rapport réintroduire dans le débat monétaire un peu de cet enthousiasme.
ANNEXE 1
Juin 1997 - l’impasse « européenne »
Avec « le pacte de stabilité » adopté à Amsterdam
une camisole de force est imposée à l’Europe
Après la réunion des ministres de l’Économie et des Finances des quinze membres de l’Union européenne, qui s’est tenue le samedi 21 septembre 1996 à Dublin et le Conseil européen tenu également à Dublin en décembre 1996, il est clair que la logique désastreuse de Maastricht a été poussée à bout. Cette « logique » s’est vue consacrée par le sommet d’Amsterdam, réuni les 16 et 1 7 juin 1997, qui a adopté le pacte de stabilité de Dublin. S’il est vrai que ce dernier se trouve accompagné d’un pacte pour la croissance et l’emploi, les deux « pactes » étant dotés d’un chapeau commun, il est néanmoins clair que les dispositions du pacte de stabilité sont précises et contraignantes, tandis que celles du pacte pour la croissance et l’emploi demeurent des généralités.
Une camisole de force monétaire et budgétaire se trouve ainsi imposée à l’Europe, soumettant les Quinze au pouvoir absolu de la Banque centrale européenne (BCE) et engendrant pour tous une austérité suicidaire. La réalité est que les intérêts financiers anglo-américains nous imposent, pour maintenir un peu plus longtemps leur bulle spéculative, le pillage de notre capacité d’investissement et de travail.
La mesure de ce désastre doit être prise dans toute son ampleur, la pire hypocrisie étant que l’on détruit ainsi l’Europe au nom de l’Europe et grâce au fonctionnement des institutions européennes elles-mêmes. Un sursaut est nécessaire et son urgence est telle que les pays, les opinions et les peuples européens doivent tout de suite réagir, sans attendre un miracle institutionnel ou des négociations qui arriveront de toute façon trop tard et qui n’ont donc désormais pour objet que de faire gagner du temps aux ennemis de l’Europe.
La gravité et la nature de la situation ne peuvent être comprises d’un point de vue strictement « franco-français » ou « intereuropéen » ; il faut se placer dans la perspective mondiale d’un système monétaire et financier international condamné et qui cherche à survivre comme un cancer, au détriment du corps -l’économie - dont il se nourrit. Dans les années 30, les politiques Brüning- Laval ont imposé une déflation généralisée pour maintenir les structures financières d’endettement résultant de la Première Guerre mondiale, en jouant contre la capacité d’investir et les actifs de leurs pays, puis les niveaux de vie de leurs populations. Aujourd’hui, après une déflation qui ruine la capacité d’investir et les prix des actifs, c’est également le filet de protection sociale qui est visé à son tour.
Écoutons le rapport semi-annuel sur les perspectives économiques mondiales publié le 25 septembre par le Fonds monétaire international (FMI). Il souligne le retard des pays européens « en matière de réforme des marchés du travail » et place ses « réformes » dans le contexte de l’Union monétaire : « Une flexibilité accrue du marché du travail sera nécessaire pour remplacer la perte de l’instrument du taux de change lorsque des pays font face à des besoins d’ajustement exceptionnels ». En clair, le FMI suggère quelques mesures : réduction en termes de montant et de durée des indemnités de chômage qu’il juge « trop généreuses », baisse des salaires minimaux, baisse des charges sociales pour les entreprises, suppression de toute entrave au licenciement. Les adeptes de la société du Mont Pèlerin, comme l’américain Gary Becker -. conseiller économique de Bob Dole - ou le français Pascal Salin renchérissent de propositions dans ce domaine.
Sous la coupe des critères de Maastricht, des pays européens s’imposent les « cures d’austérité » et les « plans de rigueur » correspondant précisément à ces choix, de l’Allemagne, qui annonce un budget très sévère et enterre son modèle d’économie sociale de marché, à la France qui multiplie les mesures restrictives, en passant par l’Italie qui crée un « impôt pour l’Europe » (sic) sur tous les revenus et par l’Espagne qui gèle les salaires de ses fonctionnaires.
I. Une police monétaire, financière et bancaire
Le sommet de Dublin a consacré cette approche jusqu’au délire comptable.
Les pays participant à « l’euro » à partir du 1er janvier 1999 s’imposent une rigueur perpétuelle en s’engageant à suivre des « programmes de stabilité » consacrés par un « pacte ». Ce pacte de stabilité prévoira des sanctions pour les pays défaillants, c’est-à-dire ceux dont le déficit des finances publiques sera revenu au-dessus de la barre des 3% du Produit intérieur brut (PIB). Ces sanctions seront infligées après un délai d’environ un an : un déficit budgétaire excessif en 1999, constaté en mars 2000, devrait conduire le pays « coupable » à adopter les mesures de correction avant la fin de l’an 2000.
S’il ne le fait pas, il sera pénalisé. Le montant des sanctions reste à préciser, mais un accord est apparu sur le schéma suivant : elles comporteraient un élément fixe égal à 0, 1 % ou 9,2% du PIB, auquel s’ajouterait un élément variable, par exemple 0 ;1 % du PIB par point de dépassement du « seuil » de 3%. La sanction prendrait la forme d’un dépôt ne produisant pas d’intérêt et qui serait transformé en amende dans l’hypothèse où, un ou deux ans plus tard, le pays en cause n’aurait pas modifié sa politique. Certes, la France a obtenu que ces sanctions ne soient pas appliquées de façon automatique, mais décidées après discussion au sein du Conseil européen. Cependant, chaque pays, pour en être exonéré, devra faire la preuve qu’il a subi des « circonstances exceptionnelles » [10]
Les pays qui ne feront pas partie du premier cercle de l’Union monétaire - de l’euro - devront, eux aussi, être soumis à un pacte de stabilité monétaire. C’est au sein de ce « système monétaire européen-bis » (SME-bis) que seront organisées les relations de change entre ce groupe et celui qui aura choisi l’euro. Les masses de fluctuations monétaires autorisées n’ont pas encore été fixées à ce stade, mais resteront « relativement larges », c’est -à -dire d’environ 15% de part et d’autre des taux pivots.
Pour se prémunir contre tout risque de dérapage des politiques économiques, ces pays, dits du « pré-in » en argot bruxellois (c’est-à-dire pré-candidats à l’euro), devront, comme ceux participant à l’euro, présenter des programmes de convergence plus détaillés et plus précis que ceux exigés aujourd’hui. Ils seront conçus, pour les uns comme pour les autres, avec les mêmes motivations et les mêmes méthodes : quel que soit le degré de progrès vers l’Union économique et monétaire, chacun devra pratiquer la maîtrise de l’inflation, un bon équilibre budgétaire ainsi que la stabilité monétaire. La seule différence entre participants à l’euro et « pré-in » est que, pour ces derniers, une défaillance ne comportera pas de sanctions juridiques. Cependant, en cas de turbulences affectant l’une des monnaies du nouveau SME, la BCE sera habilitée à déclencher, si elle l’estime nécessaire, le processus de concertation devant conduire à un ajustement des taux, alors qu’aujourd’hui, seul l’État dont la devise est menacée peut demander un réalignement.
Un certain nombre de choses sont donc désormais claires dans ce dispositif :
- Une camisole de force budgétaire et monétaire se trouve imposée à l’Europe. Un pays en crise ne pourra plus, pour relancer la machine, jouer de sa parité monétaire. En outre, on lui interdit également d’accroître ses dépenses publiques et son déficit. Les dérogations ne seront accordées que dans des conditions très restrictives et uniquement en cas de « déficit exceptionnel et temporaire ».
- Aucune solidarité n’est prévue dans le « pacte de stabilité » : les pays éventuellement bien portants n’ont aucune obligation de venir au secours des plus faibles.
- La BCE est seule juge de son action et deviendra le maître de la conjoncture européenne, sans être soumise au moindre contrôle d’institutions relevant de mandats électifs. C’est aller bien au-delà du statut actuel, chez nous, de la Banque de France, qui est « autonome » mais agit en principe « dans le cadre de la politique du gouvernement ». La BCE pourra ainsi manier les taux d’intérêt sans se préoccuper de savoir si cela risque de peser sur la croissance des pays membres. Pis, elle pourra exercer des pressions sur ceux dont la politique économique lui déplaira en les menaçant d’une hausse des taux. Certes, la « coordination des politiques économiques » a été obtenue par la France à Amsterdam pour faire pendant au pouvoir de la Banque centrale. Cependant, ce « pôle économique » n’a pas reçu de contenu concret.
- Seuls des critères strictement financiers et comptables ont été retenus pour l’appartenance à l’euro. Des pays avec des situations économiques très différentes (par exemple des taux de chômage très différents) partageront donc la même monnaie, au risque d’aggraver la situation des plus faibles.
- Les gouvernements nationaux ayant perdu la maîtrise de leurs politiques monétaire et budgétaire n’auront plus qu’une indépendance nationale symbolique, soumise à une institution financière multinationale non élue.
II. Une politique opposée aux intérêts du travail et de la production
Le résultat est clair : il s’agit d’un totalitarisme des marchés financiers mondiaux qui n’a rien, absolument rien à voir avec l’idée d’Europe.
Trois preuves peuvent en être immédiatement données :
- Ayant constaté que l’approche suivie prive l’Europe de l’arme monétaire et budgétaire, l’ancien président de la Bundesbank, Helmut Schlesinger, a proposé sans coup férir la solution de rechange : le marché du travail ! C’est absolument la logique du FMI, elle-même relais des intérêts malthusiens anglo-américains.
En clair, l’ajustement, qui ne pourra plus s’effectuer en manipulant les taux d’intérêt ou les budgets des États, se fera sur le dos des salariés et du travail, en jouant plus encore qu’actuellement sur les salaires et les effectifs. - En même temps que le travail, ce sont les investissements européens qui continuent d’être bloqués. Jusqu’à présent, les grands travaux de Jacques Delors ont été sacrifiés sur l’autel de l’austérité budgétaire et monétaire de Maastricht.
Certes, le nouveau gouvernement socialiste a réaffirmé son engagement en faveur de ces grands travaux, tant à la réunion des socialistes de Malmô (Suède) qu’au sommet d’Amsterdam. Cependant, si la France a obtenu à Amsterdam une résolution du Conseil européen sur la croissance et l’emploi, si elle a obtenu aussi la réunion d’un conseil extraordinaire sur l’emploi à l’automne 1997 et la préparation pour le Conseil de Luxembourg, en décembre, d’un rapport de la Commission et du Conseil sur l’amélioration de la coordination des politiques, et si en outre la Banque européenne d’investissements (BEI) examinera ce qu’elle pourrait faire pour financer des actions favorisant l’emploi, aucun moyen financier nouveau n’a été prévu pour financer les projets à venir. L’Allemagne et l’Angleterre ont refusé toute idée de « programme de création d’emplois » à l’échelle européenne et ont abondamment dénoncé -en privé- la remise en cause de la philosophie générale du traité de Maastricht par le « nouveau discours français ».
La France a dû renoncer au fonds européen de croissance « dont le but sera de faciliter le financement des projets de haute technologie » qu’elle entendait obtenir.
Certes, une nouvelle dynamique a été enclenchée à Amsterdam, mais « plaquée » sur l’ancienne « statique ». La contradiction éclatera nécessairement, dès cet automne 1997. - La Commission, pour imposer à tout prix l’euro et l’UEM, couvre les turpitudes comptables des États membres destinées à afficher le respect des critères : c’est ce à quoi ils se soumettent qui importe, non la façon plus ou moins élégante dont ils le font.
Ainsi, les collègues de notre ministre de l’Économie et des Finances et le commissaire Yves-Thibaut de Silguy ont laissé entendre que la Commission approuvera l’opération montée par l’ancien gouvernement français : le versement, en 1997, sur un compte spécial du Trésor, des 37,4 milliards de francs provenant des ressources de France Télécom, rassemblées pour garantir le versement de leur retraite à ses employés avant sa privatisation. L’objectif était, grâce à ce hold-up légal, d’afficher une limitation des déficits publics à 3% du PIB - le critère de Maastricht. Il reste à savoir si le nouveau gouvernement français endossera le recours à une telle acrobatie ; ce qu’il faut cependant retirer, c’est la complaisance des autorités européennes à condition qu’on veuille bien rentrer dans leur jeu.
Face à cette situation, devenue évidente aux yeux de tous et inacceptable pour la majorité, une « fuite en avant » vers une Europe fédérale et politique se manifeste de plus en plus fortement, opérée par M. Jacques Delors lui-même.
III. Une fuite en avant institutionnelle
Le raisonnement, tel qu’il a été développé par la majorité des orateurs au colloque du Nouvel Observateur et de l’association « Notre Europe » de Jacques Delors aux semaines sociales de France du 15 au 17 novembre (« Entre mondialisation et nations, quelle Europe ? ») est le suivant : puisque le problème est la présence de la BCE sans contrepartie politique, et l’absence de « social », il faut faire « un saut qualitatif vers le pouvoir politique » et imposer le social au menu.
Face au pouvoir de la BCE et de l’obsession monétaire qu’elle ne pourra qu’amplifier, il faut - disent ces « pro-européens » - un gouvernement européen capable de répondre pour l’ensemble de l’Europe. Pour que la monnaie unique ne devienne pas « le cheval de Troie de la mondialisation », selon l’expression de Jacques Delors, il faudrait une autorité politique s’exprimant au même niveau que la BCE et capable de la contrôler, un gouvernement européen capable de définir une politique économique commune. Des « impératifs sociaux » devraient être introduits pour contrebalancer « les critères purement économiques ». Par exemple, un « comité d’emploi » devrait être créé parallèlement au Comité économique et monétaire.
Nous partageons ici entièrement le souci de Jacques Delors et de ses amis et nous pensons comme eux qu’il faut faire l’Europe et que si l’obsession monétaire l’emporte sur tout le reste, le principe de solidarité - fondement du modèle social européen - sera sacrifié.
Cependant, nous ne partageons pas du tout la « fuite en avant institutionnelle » qu’ils préconisent. Pour deux raisons majeures, l’une de fond et l’autre d’opportunité.
Sur le fond, il est en effet clair que le problème n’est pas institutionnel, mais directement politique : l’on veut imposer à l’Europe une politique autodestructrice, et ce sont les intérêts financiers anglo-américains, et particulièrement britanniques, qui tentent d’utiliser - jusqu’ici avec un grand succès - le levier institutionnel européen pour y parvenir. Il faut donc partir d’une politique opposée à ces intérêts financiers dont le centre d’opérations est à Londres, et non d’une construction institutionnelle impuissante en raison de l’objet même du problème.
Avant de construire des châteaux en Espagne, les pays européens doivent reprendre le contrôle de leurs leviers politiques - budgétaire et monétaire - et coordonner leurs efforts autour de politiques communes, de grands projets. Les grands travaux de Jacques Delors doivent être commencés tout de suite, ici et maintenant, avec les moyens budgétaires et monétaires repris en main par les États eux-mêmes, et c’est à partir du développement de ces travaux que se construira physiquement l’Europe, et que les bases de ces futures institutions se trouveront jetées. Vouloir mettre la charrue des institutions ou du « gouvernement européen » avant les bœufs d’une politique de grands projets et de combat contre les intérêts financiers anglo-américains, c’est se condamner à une impuissance administrative, politique et économique.
Il faut agir tout de suite, et pour cela reconnaître ce qui est : la monnaie unique de Maastricht est au mieux un leurre, au pire un levier de politiques monétaires et ultralibérales qui ne sont pas dans l’intérêt de l’Europe. Les grands travaux de Jacques Delors ne sont pas compatibles avec l’Europe de Maastricht. C’est le fonctionnement de l’Europe de Maastricht elle-même qui l’a prouvé, et jusqu’à l’absurde à Dublin.
Il faut donc rejeter une fois pour toutes l’Europe de Maastricht et bâtir ensemble une vraie Europe, autour de réalités productives et non de virtualités monétaires, autour de politiques désignant clairement l’ennemi et non de compromis douteux.
Ce n’est pas de « gouvernement européen » ou de « plus de social » dont l’Europe a besoin ; c’est de se débarrasser du cancer financier qui lui a été imposé et qui se trouve transmis par les critères de Maastricht. Et pour cela, il n’est pas de solutions administratives, bureaucratiques ou institutionnelles ; il faut des hommes politiques de caractère qui ne transmettent pas de contraintes, mais définissent des horizons et se battent pour y parvenir. Faire un gouvernement européen et rêver à des institutions politiques communes sans prendre par les cornes le taureau britannique et anglo-américain, c’est perdre son temps et se condamner à l’impuissance.
La preuve de ce que nous affirmons est la manière même dont se déroulent les négociations au sein de la conférence intergouvernementale (la CIG) européenne. Solennellement ouverte le 29 mars 1996 à Turin, la CIG, tout le monde en convient, n’a cessé de piétiner lamentablement. L’échec du sommet d’Amsterdam sur la réforme des institutions en fournit la preuve.
Les divergences de fond sont extrêmes, comme l’a bien montré le séminaire diplomatique « pour rien » qui s’est tenu entre la France et l’Allemagne le mercredi 2 octobre 1996 à Paris. Pour sauver la face, les ministres des Affaires étrangères Hervé de Charette et Klaus Kinkel ont lancé un appel « à tous les États membres à réussir la conférence intergouvernementale », mais aucun progrès concret n’a été enregistré depuis.
Trois réformes seraient vitales (même si beaucoup d’autres ont été entassées sur la table de négociations par les quinze délégations) :
- modifier la pondération des voix entre États membres, de manière que les plus peuplés et les plus riches ne puissent être minorisés par les « petits » et par les « pauvres » sur des sujets essentiels comme la défense, la politique étrangère ou le budget ;
- élargir l’usage du vote à la majorité qualifiée, pour plus d’efficacité et de rapidité dans les décisions communes ;
- réduire le nombre de commissaires, puisque plus on élargit l’Union européenne, plus le conseil des ministres devient une assemblée et que, face à ce conseil empêtré, il faut « un pouvoir restreint, cohérent et sûr de lui ».
Or nous en venons ici, après les considérations de fond, à l’argument d’opportunité : même si l’on voulait aller dans ce sens, ce serait impossible tant des divergences sont grandes entre États. La paralysie ne peut être levée pour construire ce gouvernement européen sans un projet politique commun qui balaye les oppositions et les obstacles, sans un « souffle » que seul un combat politiquement défini permet de faire se lever.
Il y a urgence, car la crise éclatera bientôt, avec l’effondrement du système monétaire et financier international actuel. Continuer à négocier en vue d’un « gouvernement européen », c’est se condamner à l’utopie d’un parcours lent et semé d’embûches face à cette urgence. C’est en somme comme si des États ayant déjà perdu de fait tous leurs pouvoirs - monétaire et budgétaire en particulier - se battaient non pour les reprendre, mais pour prétendre partager ceux dont ils ne détiennent plus que les symboles extérieurs.
IV. Renverser l’ordre des priorités en partant de la production et du travail
Je sais bien que l’on va nous dire à ce stade : alors, c’est une dévaluation du franc que vous préconisez, voire un conflit frontal avec l’Allemagne ?
Le chantage qui pèse aujourd’hui sur le débat de fond pourrait se formuler ainsi : vous n’avez qu’un seul choix, entre l’euro - même avec tous ses défauts - et la dévaluation du franc.
Certes, une dévaluation du franc « sèche » ne mènerait nulle part, si ce n’est à un désastre politique. Elle nous coûterait beaucoup plus cher à moyen et long terme qu’elle ne nous rapporterait dans l’immédiat.
En effet, si l’on mettait le franc « en congé du système monétaire européen », le gain de compétitivité que fournirait un « franc faible » aiderait alors dans l’immédiat nos entreprises, qui gagneraient des parts de marché tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation.
La croissance créerait sans doute des emplois et des richesses, mais au mieux à très court terme.
A moyen terme, cependant, l’effondrement de l’Entente franco-allemande provoquerait une désarticulation des marchés européens, nous privant de toute possibilité de politique coordonnée de développement continental, seule voie possible pour retrouver une croissance physique durable. Notre croissance serait donc courte et spéculative, et qui plus est rapidement arrêtée par une hausse des taux d’intérêt, à long terme comme à court terme. En effet, nous n’aurions pas d’alliés face aux marchés financiers et ceux-ci, craignant une dévalorisation de leurs actifs due à la faiblesse de notre monnaie, ne prêteraient qu’à des taux plus élevés afin de compenser ce risque de dévaluation. Dès lors, le coût du crédit pour les entreprises, les ménages et l’État en serait renchéri d’autant, ce qui bloquerait à moyen terme la croissance immédiate. Cette tendance se trouverait aggravée par les contre-dévaluations compétitives que notre propre dévaluation déclencherait, provoquant à la fois une insécurité des marchés « physiques » en Europe - en raison de l’instabilité des prix et des monnaies - et une multiplication des spéculations financières, pour la même raison.
Bref, alors que « l’euro » nous livre avec d’autres monnaies européennes à une politique d’austérité financière, une dévaluation du franc nous y livrerait tout seul. Le dénominateur commun est que nous y serions donc livrés et, dans les deux cas, nous serions également touchés de plein fouet par un effondrement du système financier et monétaire international, accéléré par des spéculations sur les devises européennes à la veille de l’euro, dans un cas, ou au moment du détachement du franc, dans l’autre ...
La question qui se pose est, dès lors, que faire pour que notre économie et notre modèle social et culturel ne soient pas d’abord victimes des politiques d’austérité et ensuite entraînés dans la chute du système monétaire et financier international. La réponse est de dépasser le débat entre « euro » et « dévaluation du franc », en définissant un projet d’ordre supérieur.
Il faut pour cela renverser l’ordre des priorités : il ne devrait plus être ni budgétaire ou monétaire, ni institutionnel, c’est-à-dire relevant d’instruments d’une politique, mais au contraire toucher à la réalité physique du projet politique. En un mot, au lieu de partir de Maastricht, il faudrait repartir des grands travaux de Jacques Delors, prolongés par un nouveau plan Marshall vers l’Est et le Sud.
Le temps est maintenant trop compté pour définir un nouveau traité européen à partir de ce socle ; il faudrait tout de suite que nous jetions sur la table européenne cette proposition d’un renversement de l’ordre des priorités.
Partant ainsi d’une substance réelle, productive et infrastructurelle, nous proposerions à nos partenaires de réaliser les grands travaux de Jacques Delors et d’autres grands projets économiques communs vers l’Europe de l’Est, le Proche-Orient et l’Afrique afin de recréer les bases d’un décollage économique et assurer la paix par un développement économique mutuel.
Le monétaire - l’argent - devrait être soumis à cette substance réelle, à l’opposé de la logique de Maastricht : pour financer ces projets communs, chaque pays européen doit retrouver le contrôle de l’émission de monnaie et de crédit, c’est-à-dire établir partout un service public de banque et d’investissement. Il s’agit pour les Banques nationales d’émettre du crédit à long terme et faible taux d’intérêt pour ces « investissements non rentables â court terme et pourtant indispensables à la prospérité des générations futures » - ces projets infrastructurels défendus par Lionel Jospin à Malmô.
A nous, en France, de donner l’exemple, en nationalisant la Banque de France et en retrouvant notre tradition de planification qui, au-delà de leurs divergences politiques, rassembla dans le même engagement de service public et d’équipement collectif, Jean Monnet, Pierre Mendès-France et Charles de Gaulle. A nous de redonner un projet à notre pays et à l’Europe, montrant que la monnaie unique selon les critères de Maastricht a tué les projets communs, alors que l’alliance de projets communs créera au contraire des monnaies fortes et unies par des parités fixes autour d’un instrument de référence économique commun.
Les pays européens dans la perspective de ces grands travaux et de ces grands projets, doivent s’associer aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, aux pays méditerranéens et à ceux du Proche-Orient : il faut une politique étrangère qui corresponde à notre politique intérieure, créant avec elle les conditions de sortie du libéralisme monétariste et de la concurrence suicidaire pour tous.
L’euro et le franc faible sont deux choix menant droit au mur ; il s’agit au contraire - avant de penser monnaie ou institutions - de sauver l’économie productive de l’effondrement monétaire et financier qui nous attend.
Aujourd’hui, les États européens s’épuisent à gérer la crise, et la gérant, ils l’aggravent ; il faut mettre fin à la crise en coupant les racines du libéralisme financier - à la City de Londres, à WaIl Street et partout où il s’est implanté chez nous.
C’est un défi politique pour des hommes de caractère, non pour des hommes politiques qui transmettent des contraintes et gèrent des bilans. C’est aussi une question de vie ou de mort pour « une certaine idée de la France » et pour l’avenir des Français.
ANNEXE 2
Juin 1947 - le plan Marshall,
une méthode d’émission de crédit productif
et de capitalisation physique des économies
I. Eléments essentiels de la méthode
C’est le 5 juin 1947, dans un discours prononcé à l’université de Harvard, que le général George Marshall, alors secrétaire d’État américain, a défini les bases de l’European Recovery Program (« Programme pour la reconstruction de l’Europe »). Retenu par l’histoire sous le nom de « plan Marshall », son objectif était, en reconstruisant l’Europe, de « défendre une certaine forme de civilisation qui nous est commune ». L’aide proposée s’adressait à tous les États d’Europe ayant subi la guerre, y compris l’Union soviétique et les pays de l’Est. Staline, on le sait, la refusa et entraîna dans son refus les États d’Europe orientale.
Quelles qu’aient été alors les arrière-pensées politiques de Washington, il apparaît aujourd’hui évident que cette « aide Marshall constitue un modèle extrêmement audacieux de coopération internationale, tant par son ampleur que par sa méthode.
Pendant quatre ans, de 1948 à 1951, les États-Unis fournirent, pour l’essentiel sous forme de dons, quelque 14 milliards de dollars d’aide, soit environ 170 milliards de dollars actuels.
Cela permit, en France, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans douze autres pays, la reconstruction des grands secteurs stratégiques de l’après-guerre : énergie, sidérurgie, travaux publics et transports.
Cela plaça l’Europe occidentale sur les rails des trente années de la plus forte croissance de son histoire, les « trente glorieuses ».
Aujourd’hui, alors que les responsables politiques ne jurent que par les « forces du marché », s’arc-boutent sur une politique de « devises fortes » aux mêmes effets déflationnistes que dans les années 1934-1936 et demeurent aveugles face à la crise financière et monétaire qui vient, ce qui nous intéresse ici est la méthode suivie par le plan Marshall.
« Le plan Marshall, affirme Jacques Delors, exprimait l’idée qu’un rattrapage économique fondé sur les seules forces du marché devait s’accompagner d’un dispositif volontariste d’aide et d’assistance, de nature à surmonter les principaux obstacles structurels ».
Nous allons plus loin que Jacques Delors.
Notre conviction profonde est que, malgré un certain empirisme, le plan Marshall a touché au fondement de la création de monnaie et de crédit « productifs », c’est-à-dire que le dispositif volontaire d’aide et d’assistance qu’il établit ne fut pas un « accompagnement des marchés », mais le cœur même de la reprise mondiale de l’après-guerre.
L’on oublie en effet que les années 1945-1948 virent une relative récession aux États- Unis, car la « loi des marchés » s’y substitua à la mobilisation technologique de guerre, et que c’est l’effet de levier du plan Marshall qui, dans les années cinquante, entraîna la croissance partagée de l’ensemble Europe/États-Unis.
La politique de cet ensemble, dirigée principalement par des commandes publiques dans l’ordre civil et militaire, fut orientée sinon dirigée par les autorités des divers pays, vers un objectif commun de croissance technologique à moyen et long terme, et non comme aujourd’hui abandonnée au « court terme » des marchés.
Regardons donc de plus près la « clef » du secret, c’est-à-dire la méthode de « l’aide Marshall ». Nous découvrirons au passage que cette « clef » est susceptible d’ouvrir aujourd’hui les portes d’une nouvelle reprise mondiale, à condition qu’à nouveau « notre politique soit dirigée contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos » (Foreign Affairs, New-York, mai-juin 1997).
Le point de départ est la primauté non d’une monnaie reflétant des rapports de force à court terme, mais de la création de biens immédiatement nécessaires à l’homme, de la mise en place d’une infrastructure permettant un décollage d’ensemble et de l’ouverture de grands chantiers.
Réexaminer aujourd’hui la logique du plan Marshall est ainsi d’une extrême importance. En effet, l’argument le plus fréquemment utilisé pour justifier le blocage des investissements productifs et l’ouverture de grands chantiers est que l’argent fait défaut. Or le plan Marshall, à la fin des années 40 et au début des années 50, a instauré un circuit de l’argent, avec effet de levier, dans lequel le retour sur investissement a permis de « rembourser » les sommes avancées et bien au-delà.
Certes, à l’époque, ce sont les excédents budgétaires américains qui ont permis d’amorcer le mécanisme de l’aide. Cependant, la création de monnaie par les banques nationales se substituant aujourd’hui aux excédents budgétaires d’alors remplirait les mêmes fonctions et n’aurait aucun effet de nature inflationniste si les mêmes conditions que celles du plan Marshall étaient respectées :
- Des biens seraient d’abord achetés par l’administration publique du pays A avec de la monnaie qu’elle émettrait en faveur de ses propres producteurs pour le compte du pays B. La seule condition est qu’un excédent de ces biens existe au départ.
- Ces biens seraient ensuite donnés par le pays A à l’administration du pays B, cette dernière les revendant sur son marché et dans sa propre devise. La seule condition est qu’une demande existe en faveur de ces biens.
- Le produit total de ces ventes, contre-valeur en B des sommes réglées dans la devise de A au sein de A, serait bloqué dans un compte du pays B.
- Le pays B, avec l’accord ou le concours au cas par cas du pays A, « tirerait » sur ce compte pour permettre à ses entreprises de procéder à des investissements.
- L’argent ne « sortirait » du compte qu’après constatation que ces investissements sont possibles. La seule condition est une double disponibilité : en équipements mobilisables et en main-d’œuvre formée au niveau de l’utilisation de ces équipements.
La limite n’est plus ici monétaire mais physique. La coexistence de deux « circuits productifs », l’un en A (pays donateur) et l’autre en B (pays bénéficiaire) permet de déclencher un processus de développement sans « fuite » dans le spéculatif, à condition que les sommes allouées aillent toujours aux investissements prévus ce qui suppose un suivi rigoureux et permanent de ces investissements. Il ne peut y avoir « inflation » -circulation de monnaie sans contrepartie productive - si les biens produits en A existent au départ, et si les fondements physiques (équipements et travail) de l’investissement existent en B.
Il est évident qu’il s’agit ici du fonctionnement d’une économie dirigée et réglementée, non du marché néolibéral dans lequel l’arbitrage se fait - au contraire - toujours en faveur de l’investissement à court terme. Ce type d’économie ne peut fonctionner que si au moins un pays A et un pays B s’entendent pour y participer et se protègent des autres pays qui en refusent les règles. Nous sommes à l’opposé de « l’esprit de Maastricht ».
II. La reconstruction de l’Europe hier et aujourd’hui
A. L’intérêt stratégique américain
L’une des qualités principales des responsables américains engagés dans l’élaboration du plan Marshall fut leur capacité d’anticiper, puis de définir l’intérêt stratégique réel des États-Unis, et de développer la volonté d’agir en conséquence. Beaucoup d’historiens ont eu tendance à définir cet intérêt stratégique de façon réductionniste, notamment en fonction de la Guerre froide. Il est évident néanmoins que les dirigeants américains de l’époque considéraient généralement le développement économique national et international comme faisant partie intégrante de leur sécurité nationale, ce que peu d’hommes politiques sont en mesure de comprendre aujourd’hui.
Il était notamment dans l’intention de Franklin Roosevelt d’utiliser ses pouvoirs, en tant que Président des États-Unis, pour mettre la puissance de son pays au service du démantèlement des empires coloniaux. Alors que les milieux financiers anglo-américains prévoyaient de former, à l’issue de la guerre, une nouvelle « relation spéciale » leur permettant de mieux dominer le monde, le président Roosevelt et le général MacArthur entendaient s’allier les Philippines, l’Australie, le Japon, la Chine, la Corée, l’Inde, l’Afrique et l’Europe contre le colonialisme britannique et accessoirement français.
Les colonies françaises et anglaises devaient, selon sa vision stratégique, être placées sous l’autorité provisoire d’une agence dont le mandat serait de mettre en œuvre, en accord avec un calendrier précis, la décolonisation. Il prévoyait un plan de développement ambitieux, non seulement d’ordre européen, mais mondial, caractérisé par des transferts de technologie vers le tiers monde, par des apports de capitaux aux secteurs productifs de ces nations, et par de grands projets d’infrastructure. Sur les instructions de Roosevelt, des études étaient en cours, portant sur la construction de chemins de fer transafricains et eurasiatiques, reliés aux futurs ports régionaux en Palestine et dans le Golfe persique ; l’on étudiait aussi des projets d’irrigation pour l’Afrique du Nord et un réseau de canaux et d’infrastructures hydroélectriques pour l’Europe et l’Asie.
Pour Roosevelt, l’intérêt stratégique des États-Unis commandait de contrer les intérêts financiers anglo-américains et britanniques. Il pariait sur le ralliement de la Russie à cette vision, plutôt que d’accepter d’être isolée. Roosevelt disparu, son approche fut pour l’essentiel abandonnée et même trahie ; le plan Marshall en fut le dernier vestige, dont même les aspects les plus positifs s’inséraient dans le contexte de la Guerre froide.
B. Le plan Marshall dans le contexte européen
L’originalité du plan Marshall fut de concevoir la reconstruction européenne comme un tout. A la fin de la guerre, les dirigeants américains s’étaient d’abord ralliés aux vues du département d’État, connues sous le nom de « Relance équilibrée ». C’est dans les mêmes cercles que l’on avait élaboré le plan Morgenthau, selon lequel l’industrie allemande devait être entièrement et à tout jamais démantelée. Jugé trop radical, ce plan fut écarté.
Les milieux du département d’État voulaient en effet borner l’intervention américaine à une action de déstabilisation, d’où, selon eux, allait venir la reprise économique. Pour cela, l’équilibre devait être maintenu entre la France et l’Allemagne, ce qui nécessitait d’imposer à l’Allemagne une limite à sa capacité industrielle, ainsi que le démontage d’une partie des usines allemandes et leur transfert physique vers la France (et aussi la surveillance internationale des dépôts de charbon de la Ruhr).
Le Fonds monétaire international, créé lors de Bretton Woods en 1944 pour être le porte-parole des intérêts financiers anglo-américains, penchait pour que l’on donne la priorité à une prétendue stabilisation monétaire. En opposition à l’approche globale, le FMI proposait que les prêts aux nations européennes soient accordés sur une base bilatérale. C’est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) qui, dans ce contexte, devait avoir le droit exclusif de décider de l’allocation des crédits pour le financement de la reconstruction, les États-Unis ne jouant aucun rôle actif.
Suite à la détérioration soudaine des conditions économiques sur le continent, l’Administration Truman comprit qu’une autre approche s’imposait. Au département de la Défense, les responsables avancèrent d’abord l’idée de reconstruire l’économie allemande le plus rapidement possible, au risque de froisser les susceptibilités franco-britanniques. La France et l’Angleterre s’étaient en effet engagées, lors de la signature du traité de Dunkerque en mars 1947, à combattre toute tentative américaine de revoir à la hausse les limites à la production allemande et à alléger les réparations de guerre. S’alignant sur les coalisés de Dunkerque et prétendant satisfaire leurs exigences en matière de sécurité, certains au département d’État avancèrent un projet de Fédération européenne, arguant qu’un tel schéma permettrait de mieux encadrer et contrôler l’Allemagne.
Quoique le projet eût obtenu le soutien de certains dirigeants français, l’Angleterre comprit vite qu’elle aurait été, dans cette nouvelle Fédération, rabaissée au niveau des autres partenaires européens. A la tête d’un vaste Empire, elle ne s’intéressait nullement au processus pénible de la reconstruction de l’Europe, mais au seul soutien financier américain, avec lequel elle comptait continuer à régner sur la zone sterling. Face à ces réticences, et pour rompre le blocage, les responsables du département de la Défense reprirent l’idée d’un projet unique de reconstruction globale du continent, au-delà du seul cas allemand, mais sans encadrement par un organisme fédéral européen. Cette approche plus réaliste exigeait un financement à court terme plus important, ce qui n’était pas pour plaire à Wall Street, partisan d’une austérité (sous le vocable de stabilisation monétaire), et d’une rigueur budgétaire généralisées.
Cette conception cependant prévalut.
C. La reconstruction de la France : le plan Monnet
On ne peut ignorer les velléités d’ingérence américaine (en grande partie causées par la pression des élus Républicains au Congrès, obsédés par l’anticommunisme et la rigueur budgétaire). Il n’en reste pas moins qu’une coordination étroite entre les États-Unis et les pays bénéficiaires au niveau de l’utilisation des fonds se trouvait pleinement justifiée. La vocation du plan Marshall était de lancer dans la bonne direction l’ensemble des économies européennes, par effet de levier, ce qui exigeait un contrôle attentif de l’orientation des fonds par les parties intéressées. Cela représentait un effort budgétaire significatif de la part des États-Unis (15 % des revenus fiscaux annuels pendant une période de quatre ans, entre 1948 et 1952), qui ne couvrait cependant que 5 % des besoins en aide et en investissement des européens. Ce « 5% », poisson-pilote pour le reste, s’avérait crucial. On ne pouvait, dans ces conditions, se permettre aucune erreur, ce qui impliquait une approche dirigiste et une mobilisation coordonnée des fonds.
Le programme français de reconstruction avait été défini en grande partie en 1946 par Jean Monnet, premier Commissaire général au plan. L’effort d’investissement devait se concentrer sur l’infrastructure et sur la modernisation des équipements des grandes entreprises nationalisées, qu’il voyait comme le moteur de la reprise dans les domaines des transports, de l’énergie et des matières premières.
Mais au cours du deuxième semestre 1947, survint une crise qui empêcha la mise en œuvre du Plan de reconstruction. La balance commerciale de la France vis-à-vis des États-Unis était fortement déficitaire et l’État n’était plus en mesure d’importer les produits de première nécessité des États-Unis. Afin de stabiliser la monnaie française très ébranlée, toutes les ressources furent mobilisées et le plan de Monnet, en conséquence, fut paralysé. Le plan Marshall allait débloquer la situation. Il allait en effet permettre à la France, ainsi qu’aux autres nations européennes dans la même situation, de s’approvisionner gratuitement auprès des États-Unis en produits alimentaires de base en pétrole et en machines-outils. Le gouvernement américain s’engageait à payer directement et en dollars tous les fournisseurs, en grande majorité eux-mêmes américains, pour le compte des gouvernements européens. Ces derniers revendaient les produits ainsi acquis sur leurs marchés intérieurs, et plaçaient la contre-valeur en francs provenant des ventes dans un fonds spécial, ultérieurement débloqué au fur et à mesure qu’étaient effectués des choix d’investissement.
Ainsi, pour chaque dollar de produits fournis par les États-Unis et vendus sur le marché français, le gouvernement français s’engageait à placer la contre-valeur en francs dans un compte administré par le représentant des autorités américaines en France (Fig. 1)

Par la suite, le gouvernement devait négocier le déblocage de ces fonds par tranches, en fonction des investissements discutés et approuvés. L’utilisation des contre-valeurs de la vente des produits fournis au titre de l’aide Marshall permettait de couvrir les investissements définis par le plan Monnet.
Du côté français, la mise en marche des mécanismes administratifs ne se fit pas sans heurts. Jean Monnet espérait diriger les négociations avec les autorités américaines et obtenir que le Fonds de modernisation des équipements (FME) qu’il avait créé, soit sous la coupe du Commissariat Général au Plan. Le directeur du Trésor, François Bloch-Lainé, voulait quant à lui garder le contrôle des fonds, alléguant la rigueur budgétaire ; il espérait en fait en utiliser une partie à des fins de stabilisation monétaire. Un compromis aboutit à la mise du FME sous la tutelle de la Commission aux investissements, elle-même une création du Trésor. Jean Monnet et le Commissariat Général au Plan conservaient néanmoins un rôle de consultant auprès de la Commission et du FME. Il est intéressant de noter au passage que Jean Monnet et Charles de Gaulle, en dépit de leur opposition politique sur l’avenir de l’Europe, s’accordèrent pour défendre une économie dirigée et donnant priorité aux équipements et à l’investissement productif, contrairement aux choix britanniques. Cette orientation eut pour incarnation institutionnelle le Commissariat Général au Plan (CGP) et pour instrument son Commissaire Général, Jean Monnet, qui parvint à faire en sorte que le FME soit le destinataire de plus des deux tiers des fonds de contre-valeur (Fig. 2)

Dans le but de s’assurer que les fonds de contre-valeurs soient utilisés pour financer l’effort de reconstruction, Jean Monnet souhaitait que le CGP puisse directement négocier leur déblocage auprès des autorités américaines et coordonner leur allocation, au bénéfice du FME, qu’il voulait garder sous son contrôle. (voir ligne grise) Le directeur du Trésor, François Bloch-Lainé, préférait confier les négociations au CICEE et placer le FME sous l’autorité du Trésor, reléguant le CGP au rôle de consultant auprès de la Commission des investissements. A la suite d’un compromis entre les deux hommes, les deux tiers des fonds de contre-valeurs furent versés au bénéfice du FME, le reste ayant été utilisé par le Trésor à des fins de stabilisation monétaire, versé à la CAREC, et mis à la disponibilité des grandes banques pour le financement des entreprises privées. (Fig. 3)
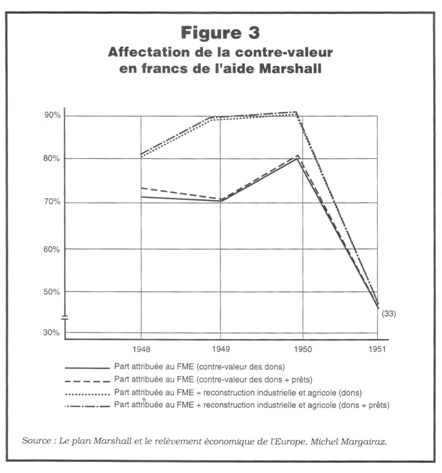
Jean Monnet avait clairement exprimé sa philosophie lors d’un passage à Washington en 1946, où il avait déclaré qu’il entendait « moderniser d’abord, et libérer ensuite ».
La majorité des fonds de contre-valeur a été versée au bénéfice des entreprises nationalisées. L’impact global de ces fonds sur l’activité de reconstruction peut être apprécié dans la mesure où 10% des investissements réalisés au total en provenaient. De plus, les entreprises privées bénéficiant de l’effet d’impulsion, avaient quant à elles accès à l’épargne auprès des banques privées, et les administrations locales pouvaient s’approvisionner en crédit auprès de la Caisse Autonome de Reconstruction et de Développement, placée sous la responsabilité du Trésor (Fig. 4).

Même si la stabilité monétaire n’avait pas été une priorité absolue du gouvernement français lors de la reconstruction, contrairement à ce qui s’est passé en Grande-Bretagne, à moyen terme la devise française et les autres devises européennes s’avérèrent plus solides que la livre sterling, quand, en 1957, celle-ci fut soumise à de fortes pressions. Avec l’effondrement de la livre et l’inauguration subséquente du marché des eurodollars par les banques anglaises, les milieux financiers et le gouvernement anglais avaient décidé d’asseoir leurs activités sur .le dollar américain. En ce temps-là, le franc était devenu « fort » en raison de la base économique qui le soutenait.
Le succès incontesté de la stratégie d’investissement française s’est aussi manifesté à travers l’augmentation spectaculaire de la productivité au cours des deux ou trois décennies suivantes. Nombre d’observateurs se sont évertués à comprendre quelle était la véritable raison de cet accroissement, le plus élevé de tous les pays industrialisés. Ils ont scruté l’organisation des missions de productivité, qui avaient été mises en place à la demande des États-Unis ; le but de ces missions était d’assurer que les investissements soient aussi performants que possible.
Le caractère malthusien et hostile au progrès technologique de la société française, tant au niveau des milieux d’affaires que des syndicats, n’avait pas échappé à certains experts américains, qui nous ont laissé leurs observations écrites sur les traits « féodaux » des industriels français ; ces derniers insistaient sur le fait que seule une intensification du travail pouvait augmenter la productivité, car ils répugnaient à faire les investissements considérables qui auraient permis une meilleure productivité grâce au progrès de la technologie. Quant aux syndicats ouvriers, ils voyaient trop souvent le progrès technique comme une menace à la sécurité de l’emploi. L’exemple américain avait pourtant bien démontré que les progrès techniques non seulement allégeaient l’aspect pénible du travail, mais permettaient une meilleure productivité, et donc un taux de profit plus élevé. Ces profits étaient ensuite redistribués, permettant aux travailleurs américains de jouir du niveau de vie le plus élevé du monde.
Entre 1950 et 1953, plus de 300 missions françaises, auxquelles ont participé plus de 2700 délégués, se rendirent aux États-Unis afin d’y visiter les usines, les centres de recherche, les universités, et de profiter d’un échange de vues avec les industriels, les ingénieurs et les travailleurs de ce pays.
Si nous ne pouvons mesurer l’impact matériel de ces missions sur la productivité de l’économie française, il est clair cependant qu’elles ont contribué à changer les mentalités. Très vite, la population devint acquise aux progrès technologiques « à l’américaine », et les syndicats ouvriers et patronaux, bien qu’en désaccord sur la répartition des fruits de la croissance, partagèrent une perspective « productiviste ». En outre, étant donné le poids très élevé du coût des transports et de l’énergie dans le processus de production, l’effort d’investissement consenti dans l’équipement et dans les infrastructures aura joué un rôle déterminant dans l’accroissement de la productivité. C’est un facteur qui tend à s’affirmer dans le moyen et le long terme.
Moins pondérable, mais tout aussi réel, a été l’épanouissement des facultés créatrices des individus ; l’amélioration de l’instruction publique, de l’accès aux soins médicaux et aux activités culturelles, rendue possible par une hausse du niveau de vie, a été déterminante. De plus, l’importance que l’on accorde au financement de la recherche scientifique influe énormément sur la capacité d’une société à accomplir des percées fondamentales, qui ont un impact marqué sur la productivité.
Cependant, et quoique Jean Monnet fût le partisan fervent des investissements lourds pour relancer l’économie française, il faut aussi reconnaître que cette relance était, pour lui, le point d’appui d’un tout autre objectif, le fédéralisme européen. Subordonnée comme elle l’était à ces projets politiques, la vision de Monnet était, en fin de compte, pragmatique, celle des Américains aussi, puis¬qu’eux aussi concevaient le plan Marshall en fonction d’une vision étroite de leur « intérêt stratégique ». C’est cela qui en a diminué la portée, ce qui est d’autant plus regrettable que la conjoncture historique était extraordinairement favorable à tout leader qui aurait voulu, comme Roosevelt l’avait envisagé au départ, mettre définitivement fin au sous-développement et au colonialisme.
D. Urgence d’un nouveau plan Marshall
Aujourd’hui, la dépression économique et la chute vertigineuse du niveau de vie qui touche presque toute la planète, font que la reconstruction des capacités productives est devenue une question de première urgence. Une telle entreprise est impossible dans le cadre des structures financières actuelles et, de toute façon, ces structures sont condamnées à s’effondrer d’un instant à l’autre. Nous savons que le keynésianisme, qui a inspiré à la fois le New Deal de Roosevelt et le plan Marshall, est une solution parfaitement illusoire dans le contexte actuel, car l’état d’endettement des nations fait que la mobilisation de ressources fiscales ne peut se faire et ne se fera pas.
Seule la refonte complète des structures financières internationales, accompagnée d’une réorganisation globale de la dette, permettra un programme sérieux de reprise. Un tel programme devra mettre l’accent sur la production industrielle, l’infrastructure physique et le niveau de vie. La spéculation sera pénalisée. Les nations souveraines devront reprendre le contrôle de l’émission de la monnaie et du crédit, afin d’orienter les investissements vers la production réelle.
C’est sur ce dernier point que cette stratégie diverge de celle du plan Marshall qui, lui, reposait en grande partie sur la mobilisation du crédit à partir des revenus fiscaux de l’État et d’eux seuls. Ceux-ci sont aujourd’hui ridiculement insuffisants par rapport aux investissements nécessaires pour assurer une reprise, car l’assiette fiscale est devenue beaucoup trop étroite. Il faut donc créer une institution, qui émette du crédit en anticipation des revenus à venir engendrés par de grands projets mobilisateurs, au-delà des recettes fiscales actuelles. Il s’agit d’une Banque nationale de type « hamiltonien » [11], structure permanente capable de mobiliser les crédits nouveaux émis sur ordre du Trésor en les jumelant aux ressources financières déjà existantes et dans le but de maximaliser l’investissement productif (figure 5).

C’est ainsi que nos gouvernements doivent affirmer l’autorité des États-nation sur les marchés financiers, et imposer les priorités du développement national.
ANNEXE 3
Financement par déficit : les précédents historiques
Dans une proposition de loi organique diffusée le 11 août 1981 et visant à permettre une nouvelle politique économique assurant la résorption du chômage et l’indépendance énergétique, M. Vincent Ansquer, avec un certain nombre d’autres députés, cite les expériences passées de création monétaire qui ont relancé l’économie :
« En 1932, l’Allemagne est en récession avec plus de deux millions de chômeurs. Dix ans plus tôt, une masse monétaire formidable avait été créée par le crédit et avait provoqué l’inflation la plus célèbre, celle de la République de Weimar. En 1932, la situation s’est inversée, il n’y a plus assez de monnaie et l’endettement paralyse les entreprises.
« Un économiste, Emst Wagemann, propose un plan qui sera accepté, bien que combattu par 35 professeurs d’économie. Le gouvernement passe alors commande à des entreprises pour la réalisation d’investissements d’intérêt général : usine de liquéfaction de houille, de caoutchouc synthétique, construction d’autoroutes ... En même temps qu’une monnaie d’État est introduite, les dettes sont résorbées.
« La même opération s’est déroulée pendant l’application de la loi prêts-bails aux États-Unis. Une monnaie fédérale introduite par voie de commande d’État à l’industrie a chassé l’endettement et la reprise s’est organisée (...)
« A la fin des années 60, une récession apparaît au Japon. L’inflation atteint 11% l’an, le chômage progresse, le P.N.B stagne. Manifestement, l’endettement des agents économiques est devenu paralysant. Le choc pétrolier vient aggraver cette situation en 1974, le P.N.B décroît. Le gouvernement va réagir ; contrairement à toutes les théories admises, il va augmenter chaque année le déficit budgétaire au point qu’en 1977, 1978 et 1979, celui-ci atteindra 40%, 42% et 37% du budget. Pour la France, un tel déficit représente 240 milliards de francs. La moitié des bons du trésor vendus sont rachetés l’année suivante par la Banque centrale. Par ce mécanisme, le Japon a littéralement changé sa monnaie, les dettes ont été remboursées et la monnaie crée par ces dettes a donc été détruite, alors qu’une monnaie à contrepartie d’État remplaçait celle qui avait circulé auparavant ».
Dans un éditorial du Washington Post du 20 avril 1997, Richard Striner, professeur associé d’histoire au collège Washington, affirme que la dette, investie dans des projets créateurs de richesses, est profitable à l’économie. Il cite à cet effet l’exemple de la Seconde Guerre mondiale :
« Combien de citoyens réalisent-ils que notre système économique moderne est basé sur une pensée audacieuse ? On a investi de l’argent emprunté dans des projets productifs et l’on a graduellement élevé le niveau de vie de la majorité des Américains d’une façon remarquable. C’est pourquoi il existait un consensus dans les années 50 et 60 en faveur de dépenses soutenues via un déficit budgétaire par le gouvernement : les gens y voyaient un moyen de générer de nouveaux investissements puissants dans l’économie. Les adultes comparaient l’intenable pénurie du temps de la dépression avec l’abondance générale de l’économie d’après-guerre. Ils savaient que c’était la Seconde Guerre mondiale - et pas le New Deal - qui avait fait la différence. Le chômage ne fut pas résorbé avant que les entreprises ne commencent à produire pour la guerre. La nation passa du statut de pays malade à celui de superpuissance. Le tour de force économique fut le résultat de dépenses sur déficit à une échelle telle que les comparaisons sont difficiles. En 1945, la dette nationale totale (l’accumulation année après année des déficits) était devenue plus grande que le PNB.
Si cela était le cas de nos jours, la sagesse populaire en conclurait probablement que la fin du monde approche. Mais rien de semblable n’est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Au contraire : l’Amérique investit plus d’argent que jamais dans des investissements à long terme et dans de grands travaux ».
Striner cite David Aschauer sur la valeur des investissements publics dans les infrastructures : « les études suggèrent que l’investissement dans les infrastructures publiques créerait 50 cents de dépenses dans le secteur privé pour chaque dollar fédéral investi ».