[sommaire]
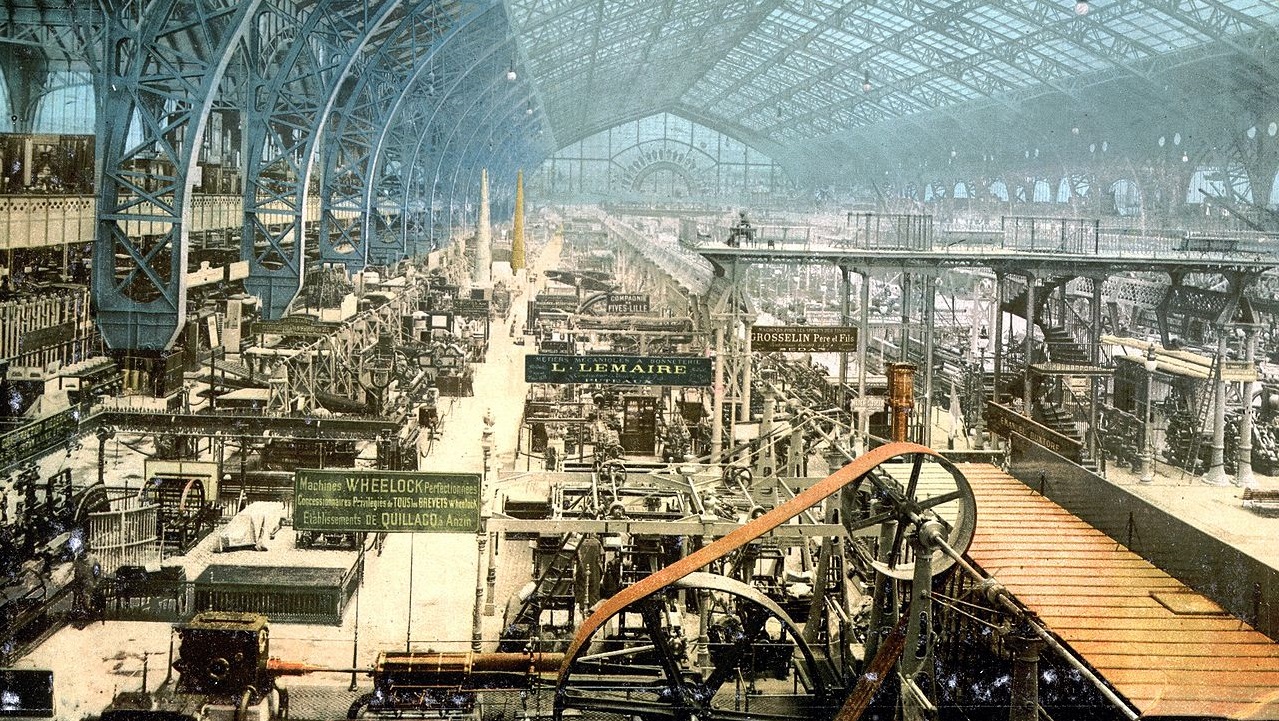
Le protectionnisme serait-il en train de retrouver les faveurs de la gauche ? C’est cependant de façon bien timorée que la Convention du Parti socialiste, confrontée à la perte de 750 000 emplois industriels en France depuis 2002, a rejeté, le 9 octobre, le « libre-échange », appelant plutôt à un « juste échange » européen.
Pourtant, au XIXe siècle, « protectionnisme » était synonyme de bouclier pour défendre les populations contre les pratiques brutales de pillage financier de l’Empire britannique, au nom justement du « libre-échange ». Comme aujourd’hui, un conglomérat supranational de banques privées exerçait sa dictature absolue sur les flux monétaires à partir de la City de Londres et cassait les productions nationales grâce aux prix plus bas des produits provenant de ses colonies.
C’est depuis les États-Unis que la lutte contre la « mondialisation » britannique de cette époque fut lancée, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par des héritiers de la Révolution américaine, Abraham Lincoln et son principal conseiller économique, Henry Carey. A partir de 1879, l’Allemagne adopta le protectionnisme de Carey. La France l’a suivie à partir de 1892, date à laquelle elle adopta le tarif Méline, auquel Jean Jaurès, bien que d’un bord politique opposé, apporta son appui. Ces politiques se traduisirent partout par une croissance économique réelle, et non financière, fulgurante.
Nous présentons ci-dessous les conceptions de deux partisans français du protectionnisme, Jean Jaurès et Paul Cauwès, un héritier intellectuel de Friedrich List, qui inspira la politique de Méline. Aux mêmes problèmes, les mêmes remèdes aujourd’hui !
Le tarif Méline de 1892, Friedrich List et Paul Cauwès
Par Jacques Cheminade
Ce texte est tiré de « Fachoda, quand les nuées portent l’orage », paru pour la première fois en 1991.
La clé du ministère Méline
Revenons maintenant au ministère Méline (…) habituellement dépeint comme celui du « plus petit commun dénominateur ». Certes, on lui reconnaît l’ambition d’avoir voulu « la défense du travail national », mais c’est immédiatement pour ajouter que le tarif protecteur instauré par Méline constitua « une rente de situation pour les industriels et les agrariens français ».
Et si c’était faux ? Ne serions-nous pas en train de répéter, en traitant Méline avec commisération, toute l’argumentation des libre-échangistes du parti financier ? (…) le ministère Méline n’aurait-il pas été, potentiellement, un bien plus grand danger pour l’Angleterre qu’on a voulu le dire ? (…)
Regardons de plus près qui était Jules Méline. (…) A lire ses discours, l’on voit apparaître un homme très au fait des problèmes de l’industrie, et en particulier de la concurrence étrangère – notamment britannique. Examinons, par exemple, le discours qu’il prononça le 19 mai 1893 au palais des Consuls à Rouen. C’est un plaidoyer vigoureux et documenté contre le libéralisme et le libre-échange ! (…)
Il montre ensuite comment, au nom de la production nationale, lui-même et ses amis industriels et agrariens viennent de réussir « à arrêter la marche toujours ascendante du libre-échange ».

En effet, pour « sauver l’agriculture nationale d’un désastre irréparable », ils ont fait passer d’abord une loi protectrice sur l’industrie sucrière, puis en 1884 le relèvement des droits sur le bétail et en 1885 celui du droit sur le blé.
En 1892 ils sont parvenus à mettre en place un nouveau « tarif de sauvegarde » qui a fait pour l’agriculture et l’industrie la même chose que « précédemment vis-à-vis du sucre, du blé et du bétail ».
Le tarif de 1892 opère en effet « une majoration d’environ 25 à 30 % du tarif minimum sur les tarifs conventionnels antérieurs ».
Et qui résiste (…) ? Léon Say et Raynal, les deux hommes de la haute banque, l’un servant quasi-officiellement les intérêts des Rothschild, l’autre ceux des compagnies de chemin de fer, l’homme qui organisa en 1882 la chute de Gambetta !
A Rouen, Jules Méline dénonce virulemment « l’état-major du libre-échange qui est à Paris. Il se compose des gros bonnets de la finance, des grands importateurs et des spéculateurs qui opèrent sur les produits étrangers. » (…)
Ecoutons encore le Méline de 1893 : (…) « Les maîtres du marché financier, les libre-échangistes (…) se sont emparés de la grande presse pour opérer sur l’opinion publique (…) C’est leur force (…) Notre association de l’Industrie française se trouve en revanche dans un état misérable. » Il propose alors de créer un grand organe quotidien, politique et économique, capable de défendre « l’économie nationale », une « République de travail et de progrès ».
Ses paroles nous rappellent quelque chose : (…) Méline et le parti industriel qui l’entoure ont bel et bien repris les idées du grand économiste allemand Friedrich List. Leur inspirateur est un professeur d’économie politique, Paul Cauwès, dont le souvenir a été effacé. Cauwès est président de la Société d’économie politique nationale dont Jules Méline est le président d’honneur.
Loin d’être des esprits arriérés, « agrariens », comme disent péjorativement les financiers de la City, il s’agit des hommes de l’époque pensant et voyant le plus loin, à qui la France doit en grande partie son essor – relatif – du début du XXe siècle. Ils sont aussi les pires ennemis du libéralisme britannique, et sans doute parmi ceux qui le comprennent le mieux en Europe.
L’œuvre de Paul Cauwès, son Cours d’Economie politique, ses notes dans la Revue d’Economie politique, en portent le témoignage. (…)
« L’économie nationale » de Paul Cauwès

Dans sa note publiée par la Revue d’Economie politique du 12 janvier 1898 – au moment du ministère Méline – Cauwès situe brillamment les idées de List dans le contexte européen et français.
Il attaque d’emblée le « doctrinarisme » qui nous vient d’Angleterre, pour qui « l’économie politique est une science des choses et non de l’homme ». Cette « école libérale », continue-t-il, a commis l’erreur « d’appliquer le raisonnement purement logique à la science de l’économie ». Il voit son origine dans les œuvres de Quesnay et d’Adam Smith, avec une tonalité optimiste au départ, lorsque la rente foncière ou financière est bonne. Puis, nécessairement, cette manière de penser devient « pessimiste » car elle ne prend pas en compte la création de biens, la vie, mais le revenu sur des choses déjà existantes, qui nécessairement diminue avec le temps. Cauwès, avec un sens très clair de l’histoire, voit deux écoles « pessimistes » naître de la matrice initiale. L’une plus proprement libérale et financière, celle de Ricardo et de Malthus, conduisant directement au « malthusianisme contemporain » [de la fin du XIXe siècle, Ndlr]. L’autre part également de l’analyse de Ricardo et de Smith et aboutit à un combat pour la possession des choses, qui détruit la solidarité entre producteurs ; c’est « l’école de Proudhon, de Lassalle et de Marx ».
A ces deux écoles apparemment opposées, mais en fait rameaux d’une même branche, il oppose au XIXe siècle les efforts de « Carey et de List ». C’est le « principe d’union et de solidarité des forces productives », et « en même temps celui que les gouvernements ont la mission de les protéger contre tout péril du dedans ou du dehors ». Cauwès souligne que cette « école de l’économie nationale » a pour nom « mercantilisme, tenu aujourd’hui en si médiocre estime », bien qu’il soit « à la source de l’existence de nos industries et de notre agriculture ».
Dans un siècle où Jean-Baptiste Say a tellement vulgarisé le libre-échangisme et le libéralisme en France qu’il en a fait « la seule doctrine possible » – comme c’est le cas aujourd’hui pour « l’économie de marché » – Cauwès montre que notre tradition, la vraie, se situe à l’opposé, précédant et alimentant l’œuvre de Friedrich List : « L’économie politique nationale est, en effet, la reprise d’une tradition bien française. La France est le pays de Sully et de Laffemas, de Henri IV, de Richelieu et de Colbert. » Il cite ensuite Galiani et l’enquête d’Antoine de Montchrestien sur les diverses branches de la production, soulignant que cette démarche prend appui sur deux notions :
- « l’unité économique nationale », la perception de la nation comme une entreprise productive unique ;
- et la « nécessité de l’intervention de la puissance publique dans l’intérêt de la production du pays ».
Car, pour Cauwès :
Les initiatives libres et l’action gouvernementale ne sont pas antagonistes. Il restera un rôle toujours assez large à l’Etat, celui d’arbitre et de modérateur entre les intérêts opposés, celui de protecteur de nos industries contre les concurrences inégales, de centralisateur des informations économiques, de créateur d’organes complémentaires propres à stimuler et à soutenir les courages entreprenants.
C’est cette conception qui est fondamentale – celle d’un État « défenseur du travail national » et qui doit « maintenir les travailleurs dans un état continuel d’entraînement » – car elle s’oppose totalement à la thèse libérale, cette « école libérale qui a semé chez nous l’idée que l’État est un mal nécessaire. »
Le débat était particulièrement vif à l’époque, rappelons-le, sur la question des chemins de fer. Raynal, Rouvier et Say les livrèrent aux compagnies, les concevant comme un « service » ponctuel, comme le transport tarifé de marchandises et de passagers d’un lieu à un autre, revenant « naturellement » à des intérêts financiers.

Cauwès va au fond du débat, même si pour cela il doit contredire Carey, à qui pourtant il reconnaît « le titre de meilleur économiste du travail ». Pour lui, « l’industrie des transports » n’est pas un « service », mais bel et bien une « industrie productive », car « la production consiste dans toute action dont l’effet est de mouvoir la matière ». Il assimile en cela le transport aux industries extractives, qui vont chercher le minerai au sein de la terre et le « transportent » vers l’usine.
Aussi, pour lui, les transports ne doivent pas être abandonnés à la finance qui ne peut en comprendre la « rentabilité » à long terme, l’impact infrastructurel. Dans une chronique de novembre décembre 1895, Cauwès précise que « la nationalisation d’une branche déterminée d’industries » peut devenir nécessaire à condition que « se trouvent en elle les caractères d’un service d’intérêt collectif ». Lorsqu’il y a menace de contrôle financier, l’Etat doit donc intervenir pour assurer la priorité industrielle, diffusant ses effets dans toute l’économie. Nous retrouvons ici les raisons de fond qui justifièrent l’attitude de Gambetta en 1882. Sa chute consacra donc bien le règne du « parti affairiste » lié au capital bancaire et à la coopération avec la City de Londres.
Cauwès conclut en proclamant son opposition absolue à « l’école de Smith » : « L’économie nationale a d’autres perspectives et d’autres prévisions que le programme d’acheter au meilleur marché et vendre le plus cher possible. »
Dans son Cours d’Economie politique, imprimé en 1893, il définit l’objet de son étude comme « la science ménagère des particuliers et des Etats » – la notion de Volkswirtschaft que l’on retrouve chez List. Le but de cette science est de réaliser « la puissance productive du travail » qui « n’est pas la conséquence des qualités inhérentes aux choses », mais « varie non seulement d’après l’état de l’art industriel, l’avancement des procédés mécaniques, mais aussi d’après l’énergie individuelle, les mœurs de famille, les traditions nationales, enfin d’après les combinaisons sociales – division du travail, association – tout ce qui peut resserrer ou renforcer les rapports industriels. »
C’est du point de vue de cette notion active, qui n’identifie pas l’économie à une « science des choses », à une logique morte, mais à une science de la production des choses, de la « création humaine », que Cauwès attaque H. Spencer, Huxley et Bagehot, « les chefs de cette nouvelle école en Angleterre dont les précurseurs furent Cabanis et Gall ». Il montre que la théorie de Spencer – l’idéologue du « darwinisme social » victorien – se ramène à une « sociologie biologique », à un pur « déterminisme social » qui « ne fait aucune part au libre-arbitre ». « Une théorie moderne, dit-il, qui se rattache d’un côté à la doctrine utilitaire de Bentham et de J. Stuart Mill, de l’autre à la thèse darwinienne de l’évolution, assimile la science sociale à la biologie, ce serait une simple science naturelle régie par les lois de la matière. » Il constate alors simplement que cette école britannique en vient, quoi qu’elle en dise, à assimiler le comportement humain à celui des animaux.
Cette critique – lorsqu’on pense aux ravages faits aujourd’hui par la sociobiologie de Wilson et le néo-malthusianisme social américain – est d’une absolue actualité.
Cauwès montre la mauvaise foi des malthusiens suivant leurs propres termes :
La doctrine absolue du libre-échange se rencontre chez les mêmes économistes que la théorie de la population de Malthus, si étroitement nationale… Pour les échanges, les limites territoriales des Etats ne comptent pas, tandis que pour les moyens de subsistance, l’on doit trembler devant la menace de l’over-population.
Finalement, analysant l’antinatalisme systématique de Stuart Mill, il va droit au but, dévoilant tout le fondement du système britannique : « Pénaliser la croissance de la population (…) est une opinion excentrique, si l’on admet que la population n’est plus réglée par les volontés libres, il n’y a logiquement qu’une seule institution qui puisse en contenir ou en activer le mouvement, c’est l’esclavage ! » (Tome II, page 63 de son Cours d’Economie politique, 1893, Larose et Forcel, éditeurs).
A l’opposé de ces conceptions « fixistes », esclavage entre êtres humains ou entre pays, Cauwès élabore sa conception auto-développante des nations :
Les nations sont en continuel travail de transformation, de développement, il est donc inexact de les supposer passives et immobiles (…) Les nations normales (au sens dans lequel List emploie cette expression) sont des organisations complètes, leur système économique ressemble à la physiologie des êtres animés les plus parfaits, les parties multiples qui les constituent, ainsi les cultures, les fabriques et le commerce, sont intimement associées et soumises à une loi de croissance intérieure (inters susception) : comme les organes d’un même corps, elles languissent ou se fortifient en même temps.
Le but du dirigeant est de « développer d’une manière harmonique les forces productives » et « de garantir l’indépendance nationale » en « augmentant les emplois productifs au profit du travail national ». Il y a donc un travail généralisé à organiser, une « grande fabrication nationale » qui n’est jamais réalisée à un moment donné, mais qui est « création continue » ; et « elle ne peut naître sans protection ».
Nous en venons donc maintenant à la nécessité et à la justification du protectionnisme tellement attaqué par les libéraux, qui prétendent n’y voir que la « sauvegarde malsaine d’intérêts », le désir de maintenir des entreprises « artificiellement », « sans concurrence ». Cauwès leur retourne l’argument en partant de l’essentiel c’est-à-dire de la nécessité de produire, de la nécessité économique et morale de ne pas laisser une population sans emploi : « sans doute, les nations doivent s’enrichir par le commerce réciproque, mais avant tout elles ont à vivre et à progresser, or, dans ce but, il faut arriver au moyen de développer les forces productives dont la nature les a douées. La vraie question est donc de déterminer quel est le régime d’échange le plus favorable à la croissance industrielle des sociétés. » Or la « liberté commerciale » risque de « dépeupler les pays dont les industries ne sont pas en état de soutenir la concurrence parce qu’ils deviennent tributaires de l’étranger ». Alors, inéluctablement, « le libre-échange aboutit à la ruine des concurrents » moins forts ou trop neufs, « donc au monopole ».
Les libre-échangistes, sous leurs théories « généreuses » et leur version fallacieuse de la liberté, ne sont donc que des hypocrites désireux de « tenir les marchés ».
Cauwès n’est cependant pas un partisan absolu de la protection opposé aux absolutistes du libre-échange ; il conçoit la « protection » comme un moyen nécessaire et non une fin ; la fin est le développement des forces productives, l’essor du travail. « La protection des industries nationales, souligne-t-il, ainsi comprise, n’est pas le plus souvent perpétuelle, c’est un régime de transition propre à favoriser l’éducation industrielle, c’est une tutelle qui doit cesser naturellement à l’âge du plein développement économique… »
Cauwès dénonce enfin, du point de vue qu’il a défini, la voie dans laquelle s’engage l’économie française à la fin du XIXe siècle : « Un dernier mot, dit-il, sur l’illusion qu’il y aurait à vendre l’enrichissement en capitaux pour l’équivalent d’un accroissement de puissance ».
Il est erroné, insiste-t-il, de juger l’influence du commerce sur la richesse nationale au seul point de vue de la valeur en échange et de l’accumulation des capitaux. « Les nations ont d’autres visées que de faire fortune par la voie la plus directe ; or, un accroissement de richesse serait peu de choses s’il devait être acquis au détriment du développement progressif de la puissance industrielle. »
Rappelons que la France, grand investisseur dans le monde entier en 1914, pays dominé par la « rente » et l’idéologie du rentier, pays dont entre 3,6 % et 5,2 % de la fortune privée s’était, en 1908, transformée en « front russe », a vu sa part dans la production industrielle mondiale passer de 9 % en 1880 à 6 % en 1913…
Cauwès, en défendant « un système de tutelle et d’éducation industrielle progressive », définissait donc bien la voie juste, celle qui permet d’éviter les guerres – qui aurait dû être suivie par la France, et par l’Europe à la fin du XIXe siècle, et qui devrait être suivie aujourd’hui, à l’opposé du « néo-libéralisme » des Jeffrey-Sachs, des Allison ou de leurs semblables. Le drame est que les mêmes causes nous portent vers les mêmes effets…
L’importance de relire Cauwès, à la lumière des tendances profondes de l’économie et de la politique mondiale qui se sont malheureusement définies à la fin du XIXe siècle – dans le moule auparavant construit par la Sainte-Alliance – se trouve là dans la conscience qu’il donne qu’une perspective différente, opposée, existait alors, comme elle existe aujourd’hui.
Protection et démocratie
Par Jean Jaurès
Extrait d’un article paru dans La Dépêche (16 avril 1890). Au moment où Jaurès écrit, le gouvernement s’apprête à adopter des tarifs douaniers destinés à protéger la production nationale de vin.
Ainsi, l’œuvre de protection du vignoble français commencera dès maintenant ; elle se complétera en 1892 par l’élévation de droits sur les vins étrangers ; le mouvement de reconstitution, encouragé, s’accentuera, et nous pourrons assister d’ici quelques années au plein réveil de la richesse viticole de notre pays. Nulle part la protection n’aura été plus légitime, car la vigne a succombé à un de ces fléaux naturels que la société considère toujours comme un devoir de combattre par des mesures législatives. Nulle part aussi, elle n’aura été plus efficace, car elle aura permis aux viticulteurs, non seulement de retrouver quelques revenus dans les années difficiles, mais de reconstituer leur capital même et la richesse foncière de notre pays. Nous nous associerons de même, dans la juste mesure et en évitant les excès, à toutes les propositions qui auront pour objet de réparer la fortune agricole de la France, qui est la base nécessaire de la richesse mobilière et de l’activité industrielle.
Il y a quelques semaines, un journal conservateur d’Albi, Le Nouvelliste , me reprochait d’être passé du libre-échange à la protection ; c’est une erreur absolue. Tout ce que j’ai écrit dans ce journal depuis quatre ans, tout ce que j’ai dit à la Chambre est dans le sens de la doctrine protectionniste. Comment en serait-il autrement, puisque j’ai combattu partout dans l’ordre social, comme dans l’ordre économique, la doctrine du laissez faire, laissez passer ? Le mouvement protectionniste doit être secondé dans la limite de la raison et de l’équité, par tous ceux qui, comme nous, ont fait entendre les revendications sociales de travailleurs et des humbles et qui se proposent, comme le but supérieur de la vie, de concourir à l’œuvre d’égalité et de justice.
Nous devons prouver en effet que nous ne nous intéressons pas seulement à la répartition des richesses, que nous nous intéressons aussi et passionnément à leur production et qu’ainsi, dans l’organisation du travail plus équitable, plus sensée, plus humaine que nous poursuivons, nous n’affaiblirons jamais les ressorts de l’activité individuelle et l’énergie productrice de la nation.
De plus, le problème social sera beaucoup plus facile à résoudre dans un pays où la fortune publique aura repris son essor et où un commencement de bien-être partout répandu substituera les fraternelles recherches de la raison aux dures rencontres de la haine.

Dans tous les pays qui nous entourent et où le socialisme se développe, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre même, la misère de certaines parties du prolétariat est plus sombre qu’en France ; aussi, la question sociale y est-elle toujours enveloppée, comme dans les lamentables faubourgs de Vienne, d’un grondement d’émeute. Lorsque l’agriculture française, suffisamment encouragée, aura retrouvé toute sa vie, il y aura en France une sorte d’aisance générale, et le problème social, au lieu de s’aigrir de colère et de désespoir dans les profondeurs de la misère, pourra se développer dans une lumière tranquille. (…)
Enfin, quel argument la bourgeoisie française, qui est presque tout entière protectionniste à l’heure actuelle, pourra-t-elle opposer à la démocratie ouvrière et paysanne, réclamant dans l’intérêt des travailleurs l’intervention des pouvoirs publics ? Quand nous demandons des lois de protection et d’émancipation pour les classes laborieuses, on nous répond : c’est du socialisme d’Etat. Mais qu’est-ce donc, je vous prie, que le protectionnisme, si ce n’est du socialisme d’Etat ? L’Etat, quand il se fait protectionniste, n’abandonne pas à eux-mêmes les intérêts en présence, il intervient dans le conflit des forces productrices et des industries. Vous, par exemple, propriétaires viticulteurs, vous lui demandez de supprimer en somme, par une loi, cette industrie des raisins secs qui est, pour quelques-uns de vos compatriotes, une source de bénéfices. Vous, propriétaires de maïs ou de betteraves, vous voulez que l’Etat, par des droits élevés sur les maïs étrangers, vous protège, mais vous supprimez les distilleries d’alcool de maïs au profit des distilleries d’alcool de betterave. Il y a là pourtant des capitaux engagés, des industries qui, en elles-mêmes, sont parfaitement légitimes.
Vous invoquez l’intérêt national, la solidarité nationale qui ne doit pas permettre un intérêt restreint de compromettre un grand intérêt, et, à mon sens, vous avez raison, en principe. Mais nous parlerez-vous encore de la loi de l’offre et de la demande ? Nous opposerez-vous le socialisme d’Etat, lorsque nous aussi, à notre tour, nous invoquerons cette même solidarité nationale en faveur de ceux des membres de la famille française qui n’ont pas eu leur part d’héritage et qui sont comme des étrangers grelottant loin du foyer où se chauffe notre égoïsme ?
Ainsi, par son ardeur protectionniste, la bourgeoisie française se condamne, sous peine de la plus odieuse contradiction, à tendre la main à la démocratie sociale. C’est une raison de plus pour nous de rester attachés, dans la juste mesure, à la doctrine protectionniste. Nous n’avons qu’une ambition, c’est de recueillir jour par jour, dans tous les événements, dans tous les mouvements d’opinion, des arguments nouveaux, des raisons nouvelles, des titres nouveaux en faveur de l’immense foule subordonnée et souffrante. Il est bien curieux de voir comment les questions se transforment avec le milieu politique et social où elles se produisent. Sous Louis Philippe, le protectionnisme était la doctrine des oligarchies industrielles et territoriales ; il avait ouvertement pour but de fortifier encore les puissants. Pour le légitimer, le comte Jaubert disait en propres termes : « Toute monarchie doit reposer sur une aristocratie ; la monarchie nouvelle, ne s’appuyant pas sur une aristocratie de nom, doit s’appuyer sur une aristocratie d’argent et créer cette aristocratie. » Aujourd’hui, dans notre société républicaine, pénétrée de liberté politique et d’aspirations démocratiques, le protectionnisme devient un argument et une force de plus aux mains du socialisme. Le vieux monde tombe décidément en ruines, puisque nous pouvons combattre avec les pierres mêmes dont ses forteresses étaient bâties.
